- Accueil
- Suggestions de lecture
- Henri MONGIS
Henri MONGIS
Henri MONGIS, Ontologie du tragique et question de Dieu. De Heidegger à Thomas d’Aquin,
« Coll. Recherches », Paris, Presses universitaires de l’IPC, 2015, 1 vol. de 711 p.
L'ouvrage d'Henri Mongis est la somme réfléchie d’un itinéraire personnel, et une réponse à l’injonction heideggérienne de rouvrir la question oubliée de l’être qui aurait été à l’origine de la métaphysique.
L’A. se présente dans son Avant-propos comme « un philosophe qui, venu de la phénoménologie et demeuré fidèle à son esprit – retour aux choses mêmes ! – a été amené à reprendre radicalement des questions posées, assumées, mais pour une part aussi rejetées par celle-ci » (p.14). L’ouvrage est l’explicitation conceptuelle et la justification argumentée du « cheminement personnel de l’auteur qui, parti de la critique heideggérienne de la métaphysique, longtemps convaincu de la finitude irréductible de l’être, c’est-à-dire aussi bien de la manifestation, de la vision en général – ‘‘même pour Dieu’’ disait Husserl dans ses descriptions de la connaissance – a été amené à reconsidérer ce que signifie être après que cette conviction eût été brisée, et à la lecture de Thomas d’Aquin. Ce cheminement sera aussi passé par les thématiques d’Emmanuel Levinas et de Michel Henry, deux penseurs qui, sur des lignes différentes, et bien qu’ayant contesté le primat de l’être heideggérien, ont maintenu la thèse d’une finitude irréductible de l’être assimilé à la phénoménalité du temps comme hors-de-soi pur. Pour l’essentiel, c’est cette thèse qui est ici remise en question. Elle est repoussée en faveur de l’affirmation d’un esse infinitum et de son auto-manifestation elle-même infinie : l’unique Savoir absolu, absolument intérieur, qui ne soit pas inscrit dans la dimension du temps-à-la-mort selon Heidegger » (p. 13).
L’ouvrage d’Henri Mongis s’enracine dans une connaissance directe et complète de la pensée de Heidegger, qui lui fit l’honneur d’une lettre-préface pour son premier livre : Heidegger et la critique de la notion de valeur. La destruction de la fondation de la métaphysique (La Haye, Nijhoff, 1976, 221 p). Comme l’A. le signale, c’est pour une part de l’intérieur même de cette pensée qu’il a été conduit à en sortir, tout en montrant qu’elle fut traversée par un questionnement inamissible auquel, en dépit de son indubitable puissance spéculative, elle n’a jamais donné des réponses qu’elle semblait pourtant appeler, et que l’A. a trouvées chez Thomas d’Aquin.
La connaissance de l’œuvre de ce dernier, que l’A. doit notamment à l’enseignement du P. Maurice Paissac (1906-1994), lui a donné, avec la doctrine de l’acte d’être, les moyens de penser philosophiquement ce que la pensée heideggérienne avait mis hors-jeu : la création de l’étant – de ce qui a l’être sans l’être absolument – et le « retour à Dieu au plus intime » (p. 597), soit l’expérience mystique telle que l’ont relatée des auteurs comme Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, ou Maître Eckhart.
C’est manifestement la lecture de Thomas qui a rendu l’A. lucide sur le sens et la portée de la pensée heideggérienne, plus encore qu’une connaissance directe et aussi complète qu’elle pouvait l’être de celle-ci. Thomas a été lu à partir de Heidegger et non pas l’inverse, et c’est pour autant chez le premier que l’A. a trouvé des réponses aux questions laissées pendantes chez le second.
Ontologie du tragique : telle est bien la réponse heideggérienne à la Seinsfrage, réponse dont la première partie de l’ouvrage – « Éléments pour la problématique » – est comme un récapitulatif et déjà une mise en question. Cette partie s’achève sur un beau commentaire du fameux distique de la « rose » d’Angelus Silesius, commentaire plus complet et plus fidèle que celui de Heidegger. En effet, dans le Pèlerin chérubinique, la rose « sans pourquoi » est aussi dite « rose de Dieu » et « rose mystique » (p. 76). Alors que le poème exhorte le « chrétien » à rechercher « l’union intime de l’âme à Dieu » (ibid.), Heidegger a ignoré ce thème en raison de sa critique de la théologie traditionnelle, censée avoir toujours envisagé Dieu à titre d’Étant suprême (p. 30-32), et parce que sa propre pensée de la temporalité de l’être, comme l’avait dit Édith Stein à propos de Sein und Zeit, « verrouille toute ouverture sur l’éternité » (p. 54). Cette temporalité avait d’abord été thématisée comme celle de « l’existence humaine » (p. 36), de l’« avoir-à-être » de l’homme au titre de « la temporalité originaire », temporalité « finie » de l’« être-à-la-mort » (p. 37). Ensuite, « après ce que Heidegger a appelé son « tournant » (Kehre), l’être est resté pensé comme temps, en stricte continuité là-dessus avec l’ouvrage de 1927, mais au titre d’une pure transcendance à laquelle l’homme est ouvert » (p.39). Cette transcendance n’est pas absolue, inséparée de l’homme (p. 40), l’être requérant l’homme pour ses manifestations ou dévoilements chaque fois finis. Une « histoire de l’être » (p. 42) foncièrement tragique, car l’être « comme tel » se voile en chacun de ses dévoilements, ceux-ci paraissant absolus, alors même qu’ils relèvent du Trauerspiel temporel de l’être, de cet originaire et irréductible « jeu-du-deuil » ou « jeu-à-la-mort » (p. 11). À chacune de ses époques, qui sont aussi bien les époques de l’être, la métaphysique se serait ainsi crispée sur la présence ou la présentation de l’être qui ne lui accordée que pour un temps, méconnaissant que l’être « est chaque fois présentation sur fond d’absence, éclaircie sur fond d’irréductible nuit » (p. 42)
L’ontologie heideggérienne a ainsi exalté le tragique et « l’insécurité de l’être sur les hommes comme sur les dieux » (p. 64), critiquant la métaphysique qui, de Platon à Nietzsche, aurait « méconnu qu’il n’y a de présence qu’à l’homme, et que cette mise en présence est toujours temporelle » (p. 41). Le tragique tient ici au sans-issue de l’existence sous l’emprise d’un « négatif originaire terrible (urgewaltige Negative) » (p. 65) et du caractère originairement « combatif » de « l’être » (p. 66) déjà affirmé par Héraclite. Ainsi, non seulement « l’éternité » est « impossible » (p. 43) – impossibilité d’une « lumière éternelle », d’une « vision qui ne soit pas à distance », dans le « jeu » du temps ou « la distance phénoménologique » selon le mot de Michel Henry, (p. 44) –, mais il y a une inéluctable « co-présence du mal dans le bien et du bien dans le mal » (p. 66) qui fait que « le bien n’est que le bien du mal », proposition qui « exclut un bien absolu, une éternelle béatitude » (p. 67). L’A. relève à ce sujet la grande importance d’une lettre de 1929 de Heidegger à Elisabeth Blochmann rappelant leur venue à l’abbaye bénédictine Saint-Martin de Beuron et leur commune émotion durant l’office des complies. Comme l’explique l’A., pour Heidegger, « cet office à l’entrée de la nuit a figuré […] l’accueil résolu du néant. Les complies sont un symbole de l’existence authentique, qui, au lieu de chercher à refouler l’angoisse, à fuir le néant où elle se tient, l’affronte courageusement » (p. 65). « Ainsi donc, ce paisible office des complies, qui exhorte certes à ne pas craindre ‘‘les terreurs de la nuit’’ (Ps 90 5), mais parce que le Christ a vaincu la mort et dans l’attente du Jour sans déclin, Heidegger l’aura vécu comme l’épreuve d’un négatif terrible de l’être, jusqu’à ce que se lève un autre jour voué lui-même au déclin, voué à retourner à sa nuit : car le jour n’est que le jour de la nuit » (p. 69).
Dès cette première partie, l’A. a multiplié les remarques critiques et les interrogations, à dessein de la suite. Après avoir expliqué le « ménagement ambigu de la foi chrétienne » à certains endroits de l’œuvre heideggérienne (p. 45) – lequel ne s’accorde guère avec ce qui a été rapporté par ailleurs, notamment par H. Buhr (p. 49) –, puis la thématique du « dieu divin » (p. 55) associée à la « critique du monothéisme » (p. 60), l’A. peut poser la question : « par quel étrange destin l’être fut-il ‘‘capable’’ du ‘‘Dieu’’ biblique, et quel rapport de celui-ci aux autres dieux ? Quel rapport notamment à ce dieu espéré pour dissiper la nuit de notre monde, un dieu censé seul pouvoir nous sauver ? À cet ensemble d’objections, nous n’avons pas trouvé de réponse dans l’œuvre » (p. 71).
« La proximité avec Hegel est patente » (p. 66) sur le thème de la négativité ou du « néantir d’un être litigieux ou combatif », bref d’une tragédie de l’histoire tenant à l’originaire. C’est pourquoi la deuxième partie – « Heidegger et le temps tragique : face à Hegel » – confronte les deux auteurs sous l’angle privilégié du thème de l’adikia que Heidegger emprunte à Anaximandre : dénonciation de « l’injustice » (p. 92) de la pensée qui, oublieuse de sa finitude, prétend être autre chose qu’un moment partiel et subordonné du « savoir absolu » (Hegel) ou un « dévoilement de l’être » (Heidegger), même si cette injustice est inévitable et requise en un sens pour l’histoire, histoire ici de l’Esprit, là de l’être. Aussi « maints traits dialectiques » de l’histoire de l’être selon Heidegger sont-ils scrutés (p. 118).
L’A. montre toutefois en quoi et pourquoi la pensée heideggérienne écarte la « résolution de l’injustice » (p.103) que Hegel avait mise en avant : réconciliation dialectique avec la « réalité », c’est-à-dire l’opérativité inhérente au devenir, dont le caractère rationnel permettrait le recueil de celui-ci dans un système totalisant. À l’idée hégélienne d’une autoproduction de l’absolu – de l’infini moyennant le fini – Heidegger a opposé une « finitude sans infinité » (p. 176) : « rien ne répugne aussi radicalement à l’ontologie que l’idée d’un être (Wesen) infini », avait-il écrit dès son Kantbuch (p. 177). L’A. examine cette « décision heideggérienne » jusque dans les écrits tardifs, notamment la conférence « Temps et être » de 1962 et le séminaire associé. Il montre que « l’appropriation » (Ereignis) donnant le temps garde le trait de la finitude, cette source du temps n’ayant « aucune aséité (Selbständigkeit), indépendamment de la dimension du temps et de la présentation finie de l’étant dans cette dimension. Ou encore aucune inséité, aucune intériorité infinie et absolue, indépendamment de l’advenue à l’étant » (p. 180). Il en va de même dans les textes des années 1950-1959 regroupés dans Acheminement vers la parole, où Heidegger ne fait état de la « parole originaire » de l’être que pour la lier à ses « ébruitements » (p. 164-167), par là-même une « parole-à-la-mort » (p. 171). En faisant ressortir cela, l’A. a déjà en vue le thème thomasien de l’Ipsum esse subsistens, de « l’infini sans histoire » (p. 305) qu’il rejoindra dans la cinquième partie de l’ouvrage. Un savoir absolu est impossible selon Heidegger, qu’il s’agisse d’une connaissance divine éternelle ou donc de la systématisation complète à laquelle a prétendu Hegel, qui surmonterait finalement la négativité en l’intégrant : « la négativité hégélienne a voilé la finitude irréductible », car « aucun savoir ne peut surmonter la négativité à partir de laquelle il s’affirme » (p. 162).
C’était assurément l’aporie-limite du hégélianisme que de mettre fin au temps dans le geste même qui le posait comme devenir du Concept. Mais une dubitatio analogue peut être suscitée à l’égard des positions de Heidegger, Certes, « en toute rigueur, la pensée heideggérienne ne peut se prévaloir d’une moindre finitude » (p. 171), « elle a trop insisté sur le voilement insuppressible de l’être, corrélativement, sur celui de sa propre limite, pour exclure la possibilité pour elle-même de l’adikia » (p. 184). Et pourtant, l’être-temps a été promu comme une forme d’absolu, « l’anhistorial heideggérien » (p. 189). Car la prépotence du temps n’a pu être énoncée qu’en la visant comme « la condition de possibilité universelle de la manifestation, en tout temps » (p. 187). Ainsi, « tout ébruitement est situé. Mais dire aussi cela, affirmer la co-appartenance finie de l’être et de l’homme, n’est-ce pas irrésistiblement absoudre cette co-appartenance du lieu historial où on l’affirme ? » (p. 187)
Pertinente dialectisation, en un sens aristotélicien plutôt qu’hégélien, du propos de Heidegger. Non pas en vue d’un geste purement négatif de répudiation, mais plutôt afin de relever la discrète persistance chez lui – comme la « résurgence » chez Levinas et Michel Henry, objet de « considérations critiques » qui terminent la deuxième partie (p. 191-199) – d’une « problématique de l’infini », laquelle paraît décidément incontournable : « Ultime, la condition du temps rendrait illusoire l’idéal métaphysique d’une complète lumière. Mais tout en se pensant insurmontablement située, la phénoménologie heideggérienne aura sans cesse recherché la manifestation la plus originaire ou la plus propre de l’être ; de cet Unique (das Einzige) qu’est l’être même, l’être comme tel. Tout en affirmant que l’indicible reste tu, Interdit rejetant les mortels sur leurs multiples voies, elle aura recherché le repos dans le silence de tout ébruitement, un Silence qui pourrait bien abriter ce qu’elle a appelé au moins une fois ‘‘le Mot unique’’ : ‘‘La langue devrait donc, pour nommer le déploiement de l’être, trouver un unique mot, le Mot unique» [‘La parole d’Anaximandre’, in Holzwege]. Trouver le Mot, la Parole unique, le Nom ou le Verbe enfin propre, voilà l’idéal qui rendait insatisfaite la recherche jusque dans ses pointes, qui rendait ‘‘insuffisant’’, déplorait-elle, son dire encore énonciatif » (p. 189). Dans la dernière partie de son ouvrage, l’A. reviendra sur ce qui serait un inconscient mais irrépressible désir du Verbe (p. 598-600).
La mise en question de la réduction de l’être au temps prépotent explique pourquoi l’A. a inséré dans son parcours une troisième partie étrangement intitulée : « Philosophie et astrologie (une analogie sur des indications pauliniennes) » (p. 201). Il ne lui a pas échappé que le thème dominant de la pensée heideggérienne ne va pas sans une « connivence majeure avec la vieille astrolâtrie » déjà soupçonnée par Levinas (p. 230). Saint Paul mettait celle-ci au compte d’une philosophie vaine, « adonnée au culte du temps », « selon les éléments du monde », en lui opposant la « philosophie (…) selon le Christ » (p. 210). Or, l’effacement de l’Éternel au profit de la « Ronde » du « monde » (p. 228) a conduit à une chronolâtrie dont la pensée heideggérienne est une sorte de consécration, couronnement du « jeu du temps comme le règne le plus originaire », « das Höchste und Tiefste, le plus haut et le plus profond» (p. 229). Le consentement résolu, ce qui est aussi dire l’attachement à la finitude, définit très exactement la vie pécheresse, mondaine ou charnelle au sens johannique ou paulinien de ces termes. Or c’est à celle-ci que se trouve ramenée en fait l’existence authentique du Dasein, l’anticipation de la mort ne le reportant qu’à sa finitude. Par ces considérations, l’A. peut finalement poser la question de savoir si le Christ est un dieu tragique dans le sens de Heidegger, ou si « la Tête de toute principauté et de tout Pouvoir », selon Col 1 18, est « une Origine à nulle autre pareille, irréductible au jeu du monde » (p. 231), bien que le Verbe se soit incarné, soit « né dans les éléments du monde » (p. 231). Par là est rejointe la « question de Dieu », question aussi bien d’une Lumière éternelle, sans ténèbres, non tragique, « ‘‘Lumière inaccessible’’ (1 Tm 6 16), rigoureusement fermée à ceux qui voient par opposition, et pourtant accessible » à celui « à qui elle donnerait d’entrer dans son immédiateté (Ps 35 10 ; 1 Jn 3 2) » (p. 231).
« Y a-t-il de cette immédiateté et de cette omniscience une annonce, voire comme une attestation dans certaines modalités […] de l’expérience de Dieu ? », demande en tout dernier lieu cette troisième partie de l’ouvrage (p. 231). Question essentielle en rapport à tout ce qui a été développé précédemment, et à laquelle répond à sa manière la quatrième partie intitulée « Le statut de la certitude dans l’expérience mystique chrétienne » (p. 233). On aurait mauvaise grâce à reprocher à l’A. de sortir ici du champ philosophique dont son ouvrage veut relever. Il pouvait à bon droit se réclamer des réquisits de l’école phénoménologique qui l’a formé, et dont s’est toujours réclamé Heidegger. La méthode phénoménologique ne saurait écarter la prise en considération de la teneur des expériences mystiques, attestée par la convergence des témoignages qu’en donnent des auteurs tels que Paul de Tarse, Maître Eckhart, Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Édith Stein : « La philosophie recherche l’Origine de l’étant. À moins d’être infidèle à sa vocation, elle ne peut pas ne pas s’intéresser à cette ‘‘sagesse mystique’’ ou ‘‘sagesse infuse’’ qui, si elle relève du surnaturel, témoigne aussi par là même, en rapport aux possibilités de la pensée, de ce que la théologie appelle classiquement les ‘‘vérités naturelles’’, et tout d’abord, selon la désignation commune, de ‘‘l’existence de Dieu’’ » (p. 236).
Il est difficile de résumer cette partie très dense, qui est aussi l’occasion d’un débat avec la pensée de Michel Henry, lequel a réhabilité une thématique de l’intériorité, mais en absolutisant le sentiment ou l’affectivité, tout en affirmant comme Heidegger la finitude irréductible du savoir. Citant surtout Thérèse d’Avila et Jean de la Croix au fil de sa description phénoménologique, l’A. indique que « l’oraison de quiétude » ou des « goûts de Dieu » donne à celui qui en bénéficie « la certitude que Dieu ‘‘connaît tout’’ (1 Jn 3 20). Il la reçoit du fait qu’il expérimente que celui qui le touche pénètre jusqu’au moindre mouvement et pensée de son cœur » (p. 261). Encore faut-il distinguer cette oraison où Dieu « donne à sentir les effets de sa présence » (Thérèse d’Avila) de « l’oraison d’union » où « Dieu s’établit lui-même dans l’intime de l’âme », « au centre de l’âme » (p. 264-265). Comment cela est-il possible, demande l’A. ? : « Comment concevoir une manifestation en personne de Dieu dans l’intime de l’âme compatible avec l’absolue transcendance ? » (p. 265).
Cette question assure la transition à la cinquième partie intitulée « Question de l’être, question de Dieu (une lecture de Thomas d’Aquin) », laquelle fait à elle seule presque les deux tiers de l’ouvrage.
Lorsqu’il révéla à son ami Engelbert Krebs sa rupture avec le catholicisme, Heidegger écrivit que celle-ci résultait d’une « approche de la théorie de la connaissance s’étendant à la connaissance historique » (p. 46). Cet aveu explique que l’A. aille puiser chez saint Thomas non seulement une décisive doctrine de l’acte d’être, mais aussi une théorie de la connaissance qui ne l’est pas moins, les deux offrant conjointement le moyen de penser l’articulation du temporel à l’Éternel, ainsi que la connaissance de ce dernier, connaissance naturelle et surnaturelle.
Cette longue cinquième partie comporte huit chapitres. Les chapitres I et II portent respectivement sur « L’être lui-même selon Thomas d’Aquin » (p. 269) et sur « L’être intime au fondement de l’en-soi en tant que pré-phénoménal et de l’en-soi en tant que substance » (p. 337), soit sur l’être comme « acte originaire qui donne à l’étant d’être comme tel » (p. 271), esse intimum et proprium grâce auquel l’étant – d’abord la substance, « l’intério-sistant » (p. 359) – se tient en deçà et au fondement de sa manifestation, c’est-à-dire aussi de la pensée et du discours humains, ce que l’A. appelle sa « sistance pré-phénoménale » (p. 337). Les questions de « la participation en modes multiples à l’être lui-même » (p. 310 sq.) et de « l’analogie de l’étant » (p. 316 sq.) sont reprises, comme celle du statut de la métaphysique (p. 331 sq.). L’A. ne quitte pas le terrain de la confrontation dialectique avec Heidegger, mais aussi avec Husserl (p. 344-354), en redonnant à la notion d’intentionnalité le sens réaliste qu’elle avait perdu dès les Recherches logiques, et plus encore après le tournant idéaliste qui a mené aux Ideen et à la Krisis. Le débat est en outre engagé avec Michel Henry à propos de la substance (p. 368-371).
S’imposait ici, pour faire pièce à l’idéalisme phénoménologique, rejeton de l’idéalisme transcendantal dont Heidegger est resté dépendant (p. 354-358), une exposition argumentée et détaillée du réalisme noétique thomasien. Il s’agissait, comme ce fut le cas depuis Platon, et à l’encontre des oblitérations heideggériennes, de penser ce qui rend possible le jugement vrai moyennant le « dévoilement de l’essence à l’intellect assisté de la cogitative et sa notification » (ch. III) : reprise à tout moment problématisante de l’approfondissement thomasien des thèses d’Aristote sur la connaissance intellectuelle de l’essence et ses « notifications orales et écrites » (p. 397 sq.). Se trouve ainsi réhabilitée une doctrine de l’abstraction conceptuelle qui lève les restrictions empiristes et criticistes quant à l’aptitude de l’intellect humain à rejoindre les choses dans leur intelligibilité intrinsèque.
Celle-ci se complète logiquement par une considération de ces actes que sont « Les trois verbes ou paroles » (ch. IV), selon la distinction héritée d’Augustin entre « le verbe intérieur ou verbe de l’esprit, le verbe extérieur ou verbe de la voix » et « l’image de la voix » (p. 409). Avec la question d’un verbe intérieur, purement mental, incorporel, l’A. pouvait reprendre la « problématique de l’âme spirituelle » (p. 412 sq.), tout en faisant valoir que, pour l’âme non séparée, animant le corps, il n’y a « pas de cogito sans langage » (p. 425), occasion encore de mises au point vis-à-vis de thèses de la phénoménologie, notamment celles de Merleau-Ponty (p. 419 ; 426-428).
C’est alors au croisement de l’ontologie et de la noétique thomasiennes – car il en va de la vie de l’esprit créé, cette fois considéré en tant que tel – que pouvait être reprise la « Question du temps. Temps du sensible, temps de l’esprit » (ch. V). Celle-ci mobilise, entre autres, de profondes et précieuses considérations sur l’intellection angélique (p. 452 sq), en rapport au temps de l’intellect humain, temps discontinu distinct du temps continu du sensible (p. 435-440, 455-457).
Le chapitre VI qui suit est central, à considérer l’ensemble du parcours de l’A. Posant la question : « Pourquoi le temps ? » (p. 459) – question qu’aurait refusée Heidegger, selon qui l’être-temps est « sans pourquoi » –, ce chapitre développe de profondes réflexions sur le « maintenant », soit sur l’instant s’il s’agit de l’étant temporel, et sur « le dire » du temps, dire qui peut être « libérateur » (p. 468). À partir de là sont reprises la question du tragique et, toujours en débat avec Heidegger, la question de la « justification » ou du « salut par le Verbe incarné » (p. 470 sq.). C’est parce que la nature humaine, assumée par ce Verbe divin, est unie à sa nature divine ou sa déité – « donc totalement ouverte à l’énergie infinie : l’acte d’être lui-même subsistant » (p. 521) – que le Christ a pu vaincre la mort et ouvrir l’homme aux « profondeurs de Dieu » (1 Co 2 10). Ainsi est surmontée l’aporie affirmée par Heidegger, « le sans-issue-possible de la mort » (p. 516), ce qui veut dire aussi « la finitude phénoménologique » (p. 516) : « Par le Verbe incarné, l’accès est dorénavant ouvert à la vision immédiate de Dieu, sans permixtio mortis, sans ‘‘mélange de mort’’ […] Impasse depuis la chute, la mort est devenue passage à la Vie » (p. 517). C’est dire aussi que la solution spéculative de Hegel est repoussée, la mort du Christ n’ayant pas été un moment de la nature divine, de Dieu lui-même (p. 516).
Ces chapitres attestent une lecture aussi complète, attentive et approfondie des textes thomasiens (près de 1000 citations !) que l’est celle des textes de Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, ou Derrida. On salue certaines trouvailles lexicales, telle la traduction du Ge-stell par « Con-sommation » (p. 25), ou, on l’a vu, la caractérisation réaliste de l’en-soi comme « sistance pré-phénoménale » (p. 337) et de la subsistentia comme « intério-sistance » (p.359). L’A. nous offre un thomisme complet et philosophiquement décisif par son rapport constamment dialectique aux pensées contemporaines, dans un style très marqué par celui de l’école phénoménologique, mais exempt de tout penchant pour l’hermétisme. Il atteste ainsi que les meilleurs acquis de la phénoménologie s’intègrent avec bonheur dans un réalisme métaphysique qui les libère des muselières idéalistes.
L’ampleur et la richesse de l’ouvrage, surtout de la cinquième partie consacrée à la pensée thomasienne, défient le résumé et ne se laissent qu’effleurer. L’A. a trouvé chez Thomas d’Aquin des instruments conceptuels encore efficaces, une fois décelées les impasses de l’immanentisme contemporain, pour le déverrouillage du rapport humain à l’Éternel auquel en appelait Édith Stein. Avant tout : le dépassement de toute forme d’essentialisme qui réduirait « ontiquement » l’étant à son essence, ou ne verrait dans l’être qu’un « horizon pur de manifestation » en rapport à l’homme. Décidément, Thomas ne pense pas Dieu comme un « super-étant » dans l’ignorance de la différence de l’être et de l’étant, mais comme Ipsum esse subsistens. L’être (esse) lui-même subsistant n’est pas seulement « plus étant que tout étant », mais « plus qu’étant » (p. 328), l’étant (ens) se caractérisant quant à lui par une composition d’essence et d’être dont son principe est absolument exempt, et ne pouvant donc être que par sa dépendance immédiate à ce dernier – sa création.
Comme on pouvait s’y attendre, la cinquième partie de l’ouvrage culmine dans les chapitres VII et VIII. L’importance de ce dernier– « Retour à Dieu au plus intime » (p. 597) – tient à la réhabilitation du thème de la scientia divina. Toujours en débat serré avec les phénoménologues tenants d’une finitude irréductible du savoir ou de la manifestation, l’A. montre que ni l’auto-connaissance de Dieu (p. 601 sq.), ni son omniscience du créé (p. 616) ne s’inscrivent dans « la distance phénoménologique », ce qui, annoncé dans l’expérience mystique, est philosophiquement pensable. C’est en lui, en sa pure intériorité identique à son esse, que Dieu voit sa création, « et non dans le hors-de-soi d’un milieu de visiblité conçu comme temps originaire » (p. 616) : « La science divine du créé n’est pas ekstatique » (p. 618). Et Dieu connaît aussi nos sentiments, ce que Michel Henry tenait pour impossible (p. 622 sq.).
C’est à la connaissance d’un tel Principe, plus intime au moi que lui-même, selon le mot d’Augustin, qu’est appelée la créature intellectuelle, moyennant d’abord l’approfondissement métaphysique de la condition qu’elle partage avec les autres étants, puis les états mystiques d’oraison unitive, tous orientés vers la vision béatifique. Cette vision de Dieu est bien une « vision immédiate », comme l’avait dit Thomas d’Aquin : « L’impensé de la phénoménologie : la vue d’une seule et même chose qui ne se produit plus dans la distance phénoménologique, et qui n’est pas non plus la vue, dite pure, de ce milieu de visibilité » (p. 681).
Cet aboutissement ultime, réhabilitation philosophique de l’espérance chrétienne, est préparé par le passionnant chapitre VII sur « L’être intime de l’étant ex nihilo dévoilé par le jugement » (p. 531). Appuyé d’abord sur les analyses du P. Pierre-Ceslas Courtès, il vise à attester que la vérité d’un jugement, en tant qu’elle est fondée en dernière instance sur celle du principe de contradiction, suppose précisément cette opposition absolue qu’ont ignorée Hegel et Heidegger, mais que l’Évangile a proclamée autant qu’Aristote : l’opposition entre être et ne pas être au sens absolu, explicite chez ce dernier, mais inexplorée quant à ses ultimes implications. De fait, le principe de contradiction, en tant qu’il porte avant tout sur le sens absolu de l’être, connote le nihil qu’est la négation absolue de celui-ci, et implique par suite cette connotation en tout jugement. Tant que l’ipsum esse est visé dans un jugement sur l’étant, et non pas connu tel qu’en lui-même dans la vision directe et béatifiante de l’Ipsum esse subsistens, ce qui est ne peut être énoncé en vérité sans que soit connotée l’exclusion de son propre néant, dont pourtant la possibilité est par là-même implicitement mentionnée, pour autant qu’il s’agisse d’un étant qui, à la différence de Dieu, n’est pas son acte d’être. L’A. explore encore plus à fond les implications du jugement en recourant aux profondes intuitions du P. M. Paissac sur « l’habitude de l’identité », thématique délicate que l’A. s’emploie à dégager de tout ontologisme (p. 566 sq.). Cette habitude de l’identité est justement celle de l’acte d’être, et de l’acte d’être pur, de Dieu, ce qui éclaire autrement le refus de la contradiction : « La division en pensée pour exclure le néant de Pierre traduit son état de créature, mais la réunion pour affirmer son identité répond à l’appel de l’Identité […] Pour synthétiser, disons que nous avons l’habitude et donc l’intention de l’être pur, mais nous l’exerçons ex nihilo, ce pourquoi le principe de non-contradiction est premier » (p. 573).
C’est assurément dans ce chapitre, l’un des plus personnels, que l’on trouvera des éléments susceptibles de relancer une interrogation et une discussion que l’A. clôt d’autant moins qu’il n’a d’autre visée que de rouvrir philosophiquement les intelligences au mystère.
On s’interrogera par exemple sur le refus d’étendre le caractère analogique du concept d’étant (p. 316), clé de la métaphysique thomasienne, à l’esse, voire sur l’affirmation que ce dernier « échappe au concept » (p. 676) : l’étant est pourtant conçu en tant que tel par l’attribution de l’esse, lequel ne serait pas attribuable s’il n’était un concept. L’analogie du premier n’implique-t-elle pas alors celle du second, et n’est-ce pas celle-ci qui permet de viser à travers l’étant, sous des formes propositionnelles assurément défaillantes et en tout cas irrémédiablement négatives, l’Ipsum esse qui est bien en lui-même, comme acte pur d’être, au-delà de toute attribution possible ?
Nul doute néanmoins que l’intuition abstractive de l’esse commune ne puisse équivaloir en aucune manière à l’intuition effective de l’Ipsum esse, fruit ultime de la grâce surnaturelle. La notion centrale sollicitée et méditée par Henri Mongis, bien que discrètement présente dans le texte de Thomas, est celle de l’esse intimum, acte d’être par lequel toute substance créée est participante de son Principe créateur. C’est parce que le Dieu donnant cet être intime est lui-même interior intimo meo que la créature douée d’intellect et de volonté a la possibilité de le rejoindre en soi-même, « condition naturelle pour ainsi dire de la manifestation surnaturelle de Dieu » (p. 598). Telle est la conclusion essentielle de l’ouvrage, qui débat aussi à plusieurs reprises avec E. Levinas : « L’homme n’est pas voué à l’errance d’un procès ekstatique assimilé à l’être, à une existence irréductiblement tragique en proie à un ‘‘négatif originaire terrible’’, jeu-à-la-mort que, si exceptionnelle soit-elle, la déférence à autrui n’abolit pas. Le ‘‘pouvoir-être total’’ de l’homme n’est pas être-à-la-mort, mais être-à-l’infini comme être-à-Dieu, pouvoir être Dieu par participation » (p. 643).
Le réalisme thomasien a donné à l’A. le meilleur moyen de viser conceptuellement le point d’articulation entre ces deux formes de « retour à Dieu » que sont la recherche philosophique et la vie spirituelle au sens mystique du terme. Tel qu’Henri Mongis le professe, ce réalisme est bien une philosophie chrétienne – non pas philosophique bien que chrétienne, mais chrétienne parce que philosophique. Dans le sens du vœu d’Édith Stein, la doctrine philosophique de l’actus essendi et de l’Ipsum esse subsistens rouvre l’existence humaine à l’Éternel, en lui offrant une issue à la gnose chronolâtre qui l’y fermait de Hegel à Heidegger, malgré la symptomatique persistance de ce dernier à chercher le « Mot unique » pour dire l’être.
L’A. aura ainsi fait preuve jusque dans sa lecture des textes thomasiens – notamment dans l’ultime confrontation entre Thomas et maître Eckhart (p. 662-676) – de cette qualité dont aucun philosophe ne saurait se départir : la désinvolture, entendue non au sens d’on ne sait quelle irrévérence, mais au sens italien autant que socratique d’une désimplication, soit d’une indépendance de l’esprit par rapport à ce qu’il se trouve convoqué à penser par les héritages spirituels multiples et complexes dont il a bénéficié. Il faut savoir gré à l’A. d’avoir fait preuve d’une telle désinvolture – coûteuse – à l’égard de la doxa des cercles philosophiques, fussent-ils de renom, et de ne pas s’être soumis sans discussion, comme tant de ses contemporains, aux verdicts devenus des prêts-à-penser, héritage de la philosophie dite critique, qui ont prétendu interdire à l’être humain d’accéder à la connaissance de son Principe et, au bout du compte, à la « joie de son Maître » (Mt 25 23).
Michel NODÉ-LANGLOIS
[Recension publiée dans la Revue Thomiste, juillet - septembre 2017, p. 505-513]
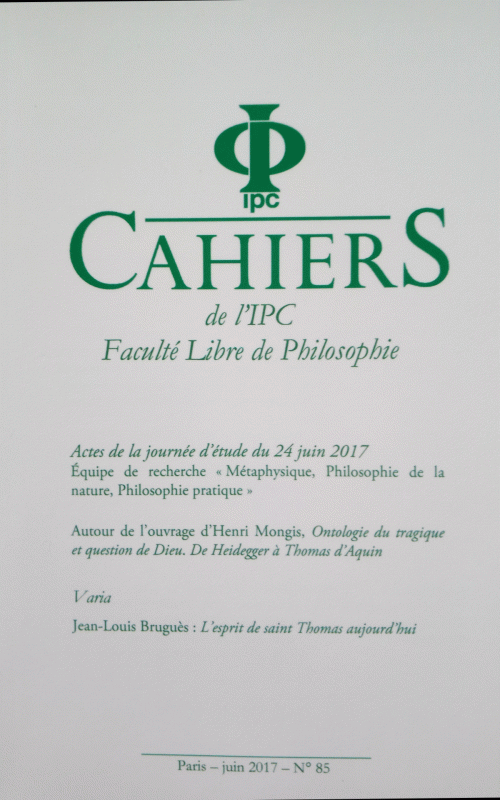
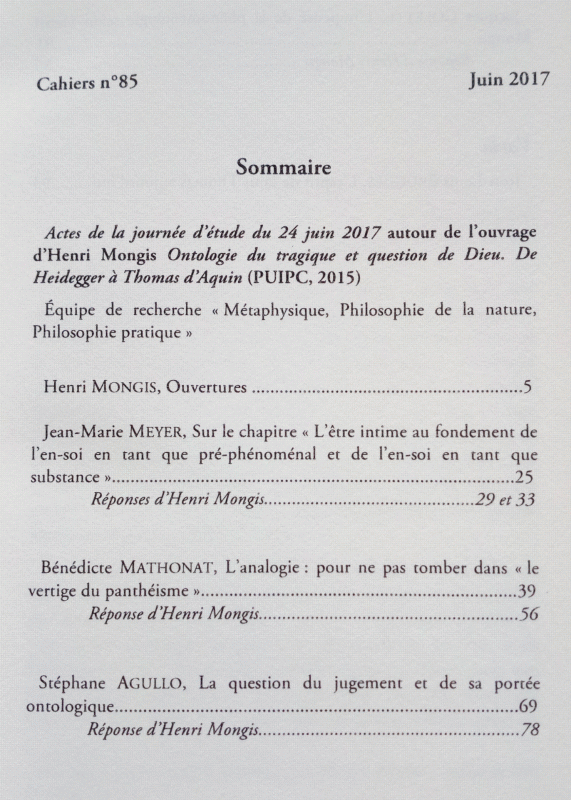
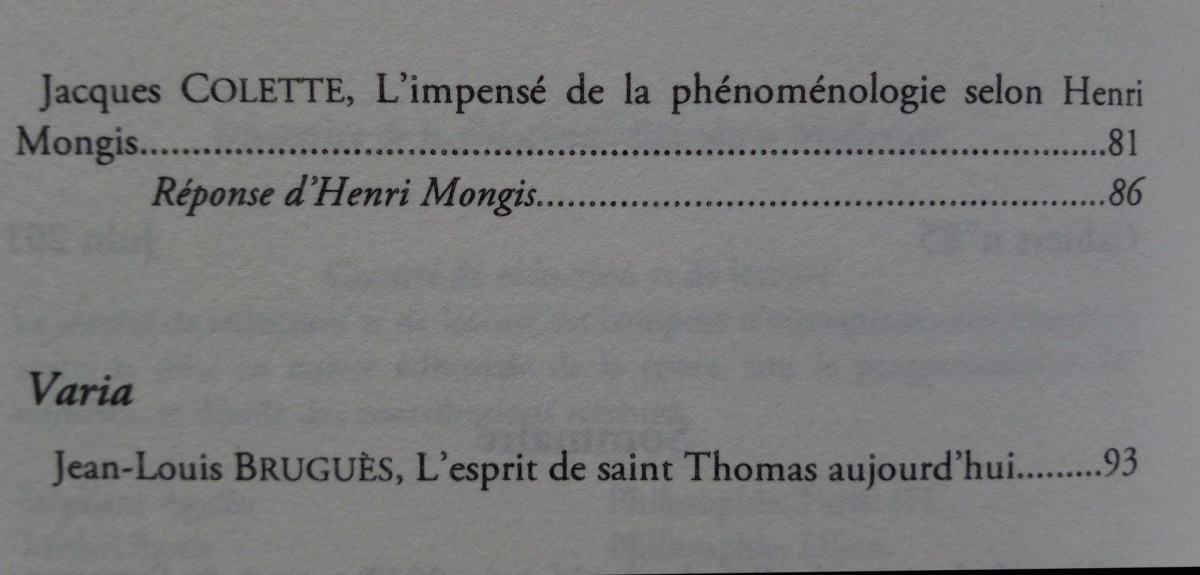
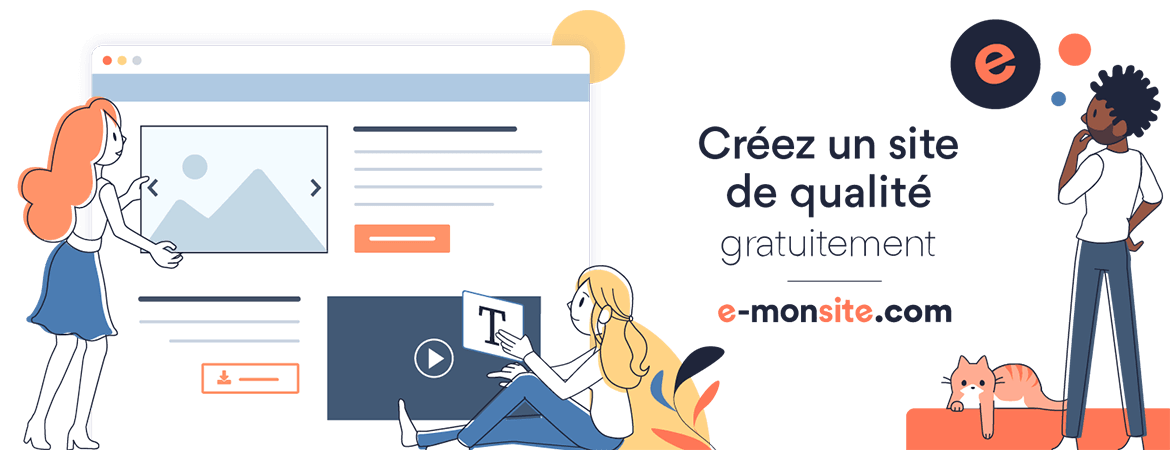




Ajouter un commentaire