- Accueil
- Publications
- Textes
- Membres de la SIPR
- Jean-Baptiste Échivard 1
Jean-Baptiste Échivard 1
À propos du réalisme bergsonien
1. Une convergence possible ?
Nous allons répétant avec Thomas que « L’étude de la philosophie n’a pas pour but de savoir ce que les hommes ont pensé, mais de savoir ce qu’est la vérité des choses»1 ; néanmoins, nous voyons Aristote se livrer dans ses grandes œuvres à un examen de la pensée de ses devanciers pour synthétiser ce à quoi ils ont abouti ou en montrer les limites : c’est l’examen dialectique nécessaire pour mieux asseoir ensuite une analyse. De la même manière, nous pouvons nous aussi nous livrer à cet examen ‘dialectique’ pour comprendre les pensées de nos philosophes modernes ou contemporains et saisir les vérités qu’ils peuvent apporter dans la connaissance du réel. Cela signifie aussi un souci précis de les comprendre vraiment dans ce qu’ils ont écrit, dans ce qu’ils ont voulu nous dire, dans l’intuition centrale qui anime sans doute leurs œuvres, voire dans leur vie même et dans les engagements qu’ils ont voulus pour leur époque.
La présente étude portera non pas tant sur la pensée de Bergson dans son détail même, mais sur son intention d’ensemble en nous efforçant toujours de dégager, à partir des textes de Bergson, un bergsonisme d’intention plutôt que de critiquer d’emblée un bergsonisme de fait présent dans le détail de chacune de ses grandes œuvres, et ceci pour reprendre une distinction formulée par Maritain dans la préface à la seconde édition de son livre La philosophie bergsonienne2.
Nous partons, en fait, du constat que la philosophie bergsonienne a été considérée comme la philosophie qui, à son époque, permettait de redécouvrir la métaphysique mise à mal par le positivisme, le scientisme et le matérialisme. Si la métaphysique est rendue possible, c’est qu’il s’agit de donner à l’intelligence humaine la possibilité de connaître ce qui est et les causes de ce qui est, de l’ouvrir d’abord non pas à ses seules capacités cognitives, mais à l’être extra-mental dont on peut atteindre progressivement et avec l’appui des sciences expérimentales elles-mêmes ce qu’il y a en lui d’essentiel. Nous pensons qu’effectivement la philosophie bergsonienne représente un effort important pour redonner à la métaphysique ses lettres de noblesse, celles qui permettent à l’homme de pouvoir dire vraiment quelque chose d’authentique sur l’origine de l’univers, sur la nature de l’homme, de l’âme, de son immortalité, de la liberté et de l’esprit, finalement de rendre possible que l’idée de Dieu soit présente au faîte de cette métaphysique. Si elle ouvre à la métaphysique, c’est qu’elle est une métaphysique elle-même, et qu’il nous faut dans ces conditions l’accueillir et la comprendre comme une métaphysique digne de ce nom.
Henri Gouhier, dans son livre d’entretiens Henri Gouhier se souvient, ou comment on devient historien des idées (Vrin, Paris, 2005) raconte les agacements d’Étienne Gilson lors d’une communication du Père de Tonquédec à un congrès de philosophie (celui qui fut organisé par la Société de philosophie de langue française en 1959) qui, selon ce que ce père jésuite disait en introduisant sa conférence, voulait indiquer « les nuages qui me semblent planer encore sur la conception bergsonienne de Dieu » ; Gouhier témoigne :
Alors, après la communication du Père de Tonquédec, Gilson a demandé la parole et il a dit ceci, je l’entends encore le disant : « Lorsque je me reporte à 1905-1908 et que j’entends la manière dont il est aujourd’hui critiqué par des théologiens, je me sens très surpris ; en effet, qui nous a rendu la métaphysique à un moment où on nous disait qu’elle était morte ? C’est Bergson. Qui nous a appris à poser de nouveau en termes précis et intelligibles des problèmes tels que ceux de la liberté, de la nature de l’âme, de son immortalité, de l’origine et de la nature de l’univers ? C’est Bergson. Ce que nous sommes devenus plus tard, quelquefois dans des voies très différentes des siennes, nous le sommes devenus grâce à lui et alors, ici – je continue à citer – « si beaucoup d’entre nous ont conservé leur religion ou l’ont retrouvée, ce n’est pas à des manuels de philosophie néoscolastique qu’ils le doivent. C’est de cela, conclut-il que je voulais le remercier3.
Rendre à la métaphysique ce qui lui revient signifie que la pensée de Bergson ne peut pas être ramenée à un seul héraclitéisme facile, à une philosophie du mouvement purement et simplement. En effet, si la durée est une idée-phare de Bergson, elle nous conduit à la stabilité de la réalité et à sa substantialité qui demeure – puisqu’elle dure ! - tout en supposant aussi le changement, l’évolution et la création continue de nouveauté imprévisible : cette création continue ne s’oppose en rien à ce qui peut demeurer dans cette stabilité vivante et qualitative. Bref, nous nous efforçons de comprendre ce qui dans la pensée de Bergson, dans son mouvement essentiel et original, permet qu’il y ait une métaphysique authentique qui soit vraiment et tout purement philosophique tout en s’ouvrant à la possibilité de l’existence de Dieu au cœur même de l’expérience.
Nous essayerons, pour ce faire, de caractériser son réalisme, et les leçons que nous pouvons tirer de ce dernier, en particulier dans ce qui le conduit à retrouver la connaissance métaphysique mise à mal, entre autres, par la critique kantienne, et aussi par les « systèmes » philosophiques trop abstraits et loin du réel qui, selon Bergson, nous empêchent une connaissance véritable de l’être. Néanmoins, la personnalité même de Bergson, sa présence sur la scène nationale et internationale au moment le plus intense de son enseignement, sont aussi sans doute riches d’enseignements, même si la vie de Bergson est finalement toute simple en son déploiement étonnant.
Résumons celle-ci pour comprendre comment on ne peut séparer chez notre auteur le génie spéculatif et le souci pratique, voire politique, qu’il manifeste, comme si sa philosophie spéculative était aussi une philosophie pratique de sa liberté qui s’incarnait dans des actions effectives, par un rayonnement spirituel incontestable s’achevant avec l’examen de l’expérience mystique et l’admiration pour la morale de l’Évangile.
Éminent mathématicien, il aurait pu se consacrer aux sciences mathématiques, opter pour des études en sciences à l’École Normale Supérieure et ceci pour des résultats de haut vol certainement. La philosophie fut son choix, plus précisément, l’enseignement de la philosophie et, parallèlement à celui-ci, la recherche, non pas la recherche pour la recherche, mais la recherche pour la découverte de la vérité à laquelle il se donna de toute son âme. Sa pensée, nourrie par la découverte de la richesse de la vie intérieure, de la conscience personnelle à une époque de positivisme, de scientisme, de rationalisme, de mécanicisme, fut alimentée par un souci constant de recevoir du meilleur des sciences, principalement biologiques, psychologiques et sociologiques, la connaissance du réel : expérience interne de la conscience, expérience externe des faits scientifiques et des hypothèses ensemble réunies pour tenter d’aller jusqu’au fond de ce qu’elles permettaient de connaître du monde, de l’homme, bref, de l’être des choses.
La métaphysique de la durée fut la réponse à cette double intention. Mais cette recherche philosophique devait également devenir, par la méthode que Bergson se proposait et le retentissement spirituel qu’il eut de par ses livres et son enseignement public au Collège de France, sans doute aussi par sa personnalité, une école de vie. Elle appelait à un effort spirituel volontaire de concentration et d’attention à la vie pour en dégager la quintessence, l’essentiel, rendant ainsi accessible à tous la possibilité d’une introduction à la métaphysique. Cette école de vie permettait alors de redonner à l’esprit la possibilité effective de voir mieux la richesse, la profondeur du réel et de la vie, de l’admirer, de s’émerveiller sur elle, tout en sachant les limites de la connaissance abstraite qu’il analysait. On ne s’y trompait pas : les succès de ses cours au Collège de France ne signifiaient-ils pas une renaissance du génie métaphysique et de la vie spirituelle nécessaire pour accompagner cette découverte spéculative de l’essence du réel ?
Fin pédagogue, Bergson l’était aussi dans son enseignement et ses écrits, comme dans ses conférences ; son génie littéraire, le flux continu de ses exemples, de ses images et métaphores étaient faits pour introduire toutes les intelligences dans les profondeurs subtiles et méditatives où lui-même se conduisait. Le rythme même de sa phrase, la simplicité de son vocabulaire, la durée elle aussi continue, diverse, imprévisible, de sa pensée éduquaient l’intelligence, donnaient une nouvelle manière de penser, un chemin, un style, une manière d’interroger le réel fondée sur l’expérience interne et externe, sur une connaissance de première main de l’histoire de la philosophie, entre autres, de la philosophie grecque, sur l’appui de la connaissance artistique, en particulier la musique. S’il livrait les résultats d’une recherche, d’un travail, il donnait aussi une méthode présentée dans un écrin littéraire de première valeur4.
Cette dimension spéculative se doublait d’une dimension active non négligeable et qui, d’une certaine manière, représente comme l’incarnation de sa métaphysique ; il fut ainsi pleinement un philosophe dans la Cité par un souci constant d’éducation dont nombre de ses conférences sont les témoins, par une présence effective au cœur de la vie politique : qu’à Madrid il prononça des conférences fort importantes sur l’âme humaine et la personnalité5 est bien significatif de cette incarnation de la philosophie dans des finalités réellement pratiques6. En ce sens, on ne peut ignorer ses qualités diplomatiques et politiques. En 1916, envoyé du gouvernement français à Madrid, puis aux USA pour aider la décision du Président Wilson à l’entrée en guerre des États-Unis auprès des alliés, il s’acquitta de sa mission en y mettant toute sa finesse psychologique, son renom philosophique, sachant utiliser ses amitiés américaines7. Il révélait que sa philosophie pouvait aussi toucher le cœur et l’intelligence d’autres Nations que la France. Il n’y a qu’à lire son emploi du temps aux USA8, la relation de ses « missions », pour s’apercevoir de sa finesse psychologique, de sa connaissance des hommes, du sens pratique qu’il pouvait avoir des stratégies à penser pour approcher les personnalités nécessaires au bon résultat de sa « mission ». Il n’était pas un philosophe de cabinet, un chercheur penché sur ses dossiers, solitaire dans sa recherche spéculative ; il l’était aussi, mais avec un sens éminent de la diffusion de sa pensée à l’extérieur pour servir au fond d’éducateur : ici un éducateur politique, là un éducateur qui veut donner des voies nouvelles pour rendre à nouveau possible une authentique métaphysique, ou bien un éducateur de l’esprit dans ses discours de distribution de prix.
La fin de sa vie fut exemplaire : la morale de l’Évangile avec son livre Les deux sources de la morale et de la religion et le désir du baptême catholique avec son testament9, sans qu’il ne le reçoive réellement, à cause, comme il l’explique dans ce codicille ajouté à celui-ci, de sa solidarité avec ses frères juifs.
Puisque Bergson nous demande d’entrer en sympathie avec toute réalité pour la connaître de l’intérieur, nous aurions mauvaise grâce si nous ne tentions pas cet effort de sympathie pour son œuvre. Quelles sont, en conséquence, les données philosophiques bergsoniennes qui peuvent alimenter le réalisme qu’un disciple de Thomas et d’Aristote semble avoir vocation de professer ? Comment peut-il se nourrir du « réalisme » bergsonien puisque c’est Bergson lui-même qui suggère la vitalité réaliste de sa philosophie, reconnaissant qu’il connaît mal la philosophie du Moyen-Âge mais qu’il pressent, à travers ce qu’il en peut connaître, qu’il pourrait y avoir un accord avec lui et Thomas sur certains points. En effet, un an après la publication des Deux sources… Bergson écrira le 16 août 1935 :
[…] Je ne connais pas assez, malheureusement la philosophie de saint Thomas prise dans son ensemble, pour pouvoir dire moi-même jusqu’à quel point ma pensée est dans le prolongement de la sienne. Mais ce qui est certain, c’est que, lorsque j’ai dû approfondir tel ou tel point particulier de cette philosophie, je me suis trouvé en présence d’idées dont je pouvais accepter l’essentiel, quitte à tenir compte, naturellement, du développement scientifique qui avait eu lieu dans l’intervalle […] Reste alors la question posée entre le réalisme et l’idéalisme. S’il faut choisir entre ces deux « ismes », je n’hésite pas un seul instant : c’est au réalisme, et au réalisme le plus radical, que je rattache l’ensemble de mes vues. Je n’ai jamais pu considérer la connaissance comme une construction, et c’est pourquoi avant même les réflexions sur le temps qui furent mon point de départ et que j’expose dans l’introduction de La Pensée et le mouvant, j’avais rejeté le kantisme ou plutôt refusé de m’y arrêter, bien que la Critique de la raison pure inspirât alors aux philosophes un respect presque religieux10.
Le P. Sertillanges, dans un livre paru en 1941, Henri Bergson et le catholicisme, n’hésite pas à parler de « réalisme » à propos de la philosophie de Bergson :
Aussi Henri Bergson se déclare-t-il réaliste et objectiviste très déterminé, ce qui l’apparente, sous un rapport très important à la philosophie chrétienne. Il est réaliste contre Kant, et encore plus contre Lachelier, Hamelin ou Brunschvicg, qui prétendent épurer Kant de ce qui lui reste de réalisme avec sa chose en soi. Pour Bergson, ce qui est en soi, c’est l’être tel que nous le percevons, l’être qualifié en soi, non par référence à de prétendues formes de la pensée.
« On étonnerait beaucoup un homme étranger aux spéculations philosophiques, en lui disant que l’objet qu’il a devant lui et qu’il touche, n’existe que dans son esprit et pour son esprit, ou même, plus généralement, que pour un esprit, comme le voulait Berkeley…Mais d’autre part on étonnerait autant notre interlocuteur en lui disant que l’objet est tout différent de ce qu’on y aperçoit. »
« Ce n’est pas en nous, ajoute notre penseur, c’est en eux que nous percevons les objets ; c’est du moins en eux que nous les percevrions si notre perception était pure », c’est-à-dire si nous n’exercions pas à leur égard cette faculté de morcelage utilitaire que nous imposent les besoins de la pratique.
Si je regardais un arbre avec un regard adapté à l’échelle des rythmes élémentaires, je ne verrais plus, au lieu de l’arbre, qu’un immense brouillard ; l’arbre disparaîtrait comme arbre, et son apparente immobilité, sa couleur, tous ses caractères se changeraient en une danse effarante confondue dans la danse de tout l’univers et où mes sens ne se retrouveraient plus. L’individu arbre est donc, pour ma perception un triage. Cette perception n’en est pas moins objective, et l’individu arbre n’est nullement dissous11. (Cf. La pensée et le mouvant, pp. 95 et 119).
En ce sens, la réalité telle qu’elle est en elle-même existe pour tout homme, et donc, pour tout philosophe ; ce qui ne veut pas dire que la connaissance ne puisse abstraire telle ou telle qualité qu’il perçoit d’un être pour l’étudier à part des autres qualités, ou qu’il ne veuille regarder que les propriétés quantitatives de ce même être séparées de son existence effective. Mais toujours c’est le réel lui-même que nous percevons, que nous recevons dans nos sensations et dont nous nous efforçons de considérer la richesse propre qui s’offre ainsi à nous.
Réaliste donc est cette attitude qui affirme l’antériorité du réel sur la connaissance, ou qui souligne que le réel existe en lui-même indépendamment de la connaissance que l’on veut en avoir ; avant même qu’on la pense, ou que l’on discerne ses parties et les relations entre elles, chaque réalité est là, devant moi, offerte à mon interrogation qui s’étonne, selon la célèbre affirmation d’Aristote que « les choses soient ce qu’elles sont. » Encore faut-il, sans doute, définir l’orientation que Bergson veut donner à ce réalisme foncier qu’il affirme sans hésitation.
Cherchons alors cet accord et les raisons pour lesquelles un disciple de saint Thomas pourrait, sans retenue aucune, mais en gardant intacte la liberté de son jugement, recevoir de Bergson une actualisation, une aide, un éclairage un peu nouveaux par rapport à ses propres habitudes, mais non moins riches pour son propre chemin de connaissance et de vie.
2. Le fait de l’expérience immédiate interne
Il y a chez Thomas une présence de l’expérience interne ; la conscience effective de soi-même à partir de la réalité des actes de pensée, de volition, de sentiment, de mémorisation dont nous prenons conscience d’une manière habituelle et continue. Des données immédiates réalistes de la conscience, en quelque sorte parce que nous accompagnant en permanence dans tous nos actes et que nous les saisissons d’abord sans aucun intermédiaire.
Au début de son commentaire sur le De l’âme, saint Thomas, pour montrer la supériorité - et sa certitude - de la science de l’âme sur les autres sciences, remarque, presque en passant, que cette science de l’âme tient d’abord sa certitude de la certitude de l’expérience interne :
Chacun fait l’expérience en lui-même qu’il a une âme et qu’il vit par elle12.
Ce qui signifie que pour l’étude des êtres vivants, il faut commencer par l’expérience intérieure : nous saisissons que nous avons une âme ; autrement dit, que la multiplicité de nos actes dont nous avons effectivement conscience – le fait que nous sentons, que nous imaginons, que nous pensons, voulons, décidons, hésitons, rêvons, que nous avons des souvenirs volontairement remémorés ou involontairement suscités par tels ou tels événements, que nous avons des sentiments de colère, de plaisir, de tristesse, de jouissance, que nous nous regardons vivre, penser, imaginer, vouloir, que nous nous sentons avoir faim, soif, être malade, que nous nous voyons regardant un paysage et ressentir telle ou telle émotion devant lui, etc. – est animée de l’intérieur par un principe qui l’unifie et rend possible que ce soit le même être qui puisse se reconnaître à travers cette multiplicité d’actes : il n’y a pas plusieurs personnes qui posent ces actes, mais c’est la même personne qui se perçoit les posant tout au long de sa vie. Parfois, nous pouvons nous retourner sur notre vie passée, et percevoir combien c’est bien nous qui, il y a quinze ou vingt ans, vivions tel ou tel sentiment. Cette expérience interne est très commune et ne nous dit encore rien, ou si peu, sur la nature de ce principe interne, mais elle met à jour - par la conscience que nous en avons, par les retentissements en nous d’événements intérieurs (ou extérieurs) qui durent du fait qu’ils sont conservés dans notre mémoire et peuvent à l’improviste ou par une réminiscences volontaire rejaillir en nous -, le fait que c’est la même personne qui se retrouve à travers cette diversité très nuancée parfois : il y a effectivement une certaine unité intérieure et nous existons vraiment comme personne unique. Si chacun expérimente en lui-même qu'il a une âme, c'est que cette expérience a une certaine universalité, c’est-à-dire une certaine objectivité, et c'est pour cela qu'elle fonde la certitude de la science de l'âme. Comme le souligne encore une fois Thomas :
Cette science de l’âme est très certaine parce que chacun expérimente en lui-même qu’il a une âme et que les actes de cette âme lui sont internes. Mais savoir ce qu’est l’âme est très difficile. C’est pourquoi le Philosophe dans le même texte dit qu’il est très difficile d’acquérir quelques certitudes à son sujet13.
Dans le même article, il précisera même que :
L’esprit, avant d’abstraire à partir des images a une connaissance habituelle de lui-même par laquelle il peut percevoir qu’il existe14.
Ainsi, avant même de poser un acte explicite de réflexion, de volonté, nous pouvons avoir conscience que nous existons, comme fond de tous nos actes, non pas en nous abstrayant de la réalité sensible, mais en nous regardant vivre chacun de nos actes, chacune de nos tendances, chacun de nos besoins relatifs à la réalité qui nous entoure et que nous recevons en nous par notre connaissance. Et nous avons conscience que nous existons parce qu’effectivement le monde existe, qu’il a existé avant notre existence et qu’il continuera après celle-ci. Nous avons comme une présence implicite et continuelle de l’âme à elle-même en même temps qu’une présence du monde à nous-même : il faut bien que quelque chose existe pour avoir conscience que nous la pensons, que nous la sentons ! Thomas dira aussi en ce sens :
L’intellect comprend qu’il comprend, de la même manière que la volonté veut vouloir et aime le fait qu’elle aime15.
Cette présence à soi-même par cette saisie interne de nos actes, et d’un principe d’unité qu’elle suppose, est bonne et désirable en elle-même. Saint Thomas dira, en effet, dans son commentaire de l’Éthique à Nicomaque :
Appartient au nombre des réalités aimables en soi le fait de se sentir vivre parce que, comme cela a été prouvé plus haut, vivre est naturellement bon. En effet, ce qui est perçu comme étant bon en soi est agréable. On voit ainsi, du fait que vivre est désirable, en particulier pour ceux qui sont bons (pour lesquels le fait d’être est bon et désirable) leur est agréable ; parce que, en même temps que cela, ils perçoivent ce qui est bon en soi pour eux, c’est-à-dire être et vivre, et pour cela, ils se réjouissent16.
On le voit, cette conscience de soi rend présent en nous-mêmes l’existence et nous la rend aimable et désirable. N’est-ce pas ici le juste amour de soi-même, qui est aussi juste amour de l’existence, de cet appétit d’être que tout vivant a en lui et dont il peut, à des degrés divers, avoir conscience, dès lors qu’il peut exprimer une certaine affectivité, signe qu’il éprouve en lui des sentiments sur les réalités, les événements qu’il vit ? Juste amour de soi-même dont beaucoup de moralistes ont parlé comme d’un chemin qui nous rend la vie aimable et désirable. Celui-ci suppose, en conséquence, un regard intérieur sur tous nos actes d’êtres vivants et non une attention à nos seuls actes strictement intellectuels, ou à notre seule pensée réflexive abstraite que nous qualifions parfois d’une manière trop rapide comme ‘spirituels’. La conscience que nous existons est donc en soi bonne et agréable. Elle est le point de départ d’une science authentique de l’âme. Dans un texte fameux, Aristote dira combien cette conscience de soi, loin d’être un égoïsme psychologique ou une expérience individualiste, se révèle comme une des sources de l’amitié :
Mais si la vie elle-même est une chose bonne et agréable (comme elle semble bien l'être, à en juger l'attrait qu'elle inspire à tout homme et particulièrement aux hommes vertueux et parfaitement heureux, car à ceux-ci la vie est désirable au suprême degré, et leur existence est la plus parfaitement heureuse), et si celui qui voit a conscience qu'il voit, celui qui entend, conscience qu'il entend, celui qui marche, conscience qu'il marche, et si pareillement pour les autres formes d'activités il y a quelque chose qui a conscience que nous sommes actifs, de sorte que nous aurions conscience que nous percevons, et que nous penserions que nous pensons, et si avoir conscience que nous percevons ou pensons est avoir conscience que nous existons (puisque exister, avons-nous dit, est percevoir ou exister), et si avoir conscience qu'on vit est au nombre des plaisirs agréables par soi (car la vie est quelque chose de bon par nature, et avoir conscience qu'on possède en soi-même ce qui est bon est une chose agréable) ; et si la vie est désirable, et désirable surtout pour les bons, parce que l'existence est une chose bonne pour eux et une chose agréable (car la conscience qu'ils ont de posséder en eux ce qui est bon par soi est pour eux un sujet de joie); et si l'homme vertueux est envers son ami comme il est envers lui-même (son ami étant un autre lui-même),- dans ces conditions, de même que pour chacun de nous sa propre existence est une chose désirable, de même est désirable pour lui au même degré, ou à peu de chose près, l'existence de son ami17.
L’ami étant comme un autre nous-même, si nous aimons vraiment nous désirerons l’existence de notre ami comme nous désirons notre propre existence. Cette conscience de l’existence de notre ami contribuera bien évidemment à actualiser la propre conscience de notre existence personnelle. L’existence de l’ami étant aimable et désirable, c’est notre existence elle-même qui sera d’autant plus aimable et désirable qu’elle se diffusera au-delà d’elle-même. La vie, l’exister seront alors le bien commun aux deux amis qui, par la communication explicite des biens, rendront leur vie plus aimable et désirable que s’ils étaient seuls.
Cette expérience interne est la conscience de la bonté de la vie à partir de la bonté des opérations qui permet de prendre conscience de la bonté de l'être, et par là de la bonté de l'amitié à partir du moment où l'ami étant un autre soi-même, son existence est autant désirable que notre propre existence. Dans son commentaire de l’Éthique à Nicomaque, Thomas écrit18 :
De même, donc, que l’on se réjouit du fait d’exister et de vivre en le sentant, on doit, pour se réjouir de son ami, simultanément sentir qu’il existe ; cela se produit en vivant avec lui dans la communication des paroles et des biens de l’esprit19.
Cette conscience habituelle que nous avons de nous-mêmes n'est pas une conscience vide, c'est la conscience d'un vivant qui, d'une manière habituelle, prend conscience qu'il existe comme vivant parce qu'il a des actes propres au vivant : il dort, il rêve, il imagine, il sent, il ressent plaisir et tristesse, peur et colère, etc. et des actes propres à sa nature humaine : il veut, il ne veut pas, il pense, il médite, il comprend, etc., il saisit soudain dans un éclair la vérité de ce qu’il cherchait, etc. Cette conscience habituelle est bonne, elle rend la vie désirable, et me rend proche de mon ami, dont la propre existence devient pour moi désirable. L'esse, c’est-à-dire ici le fait d’exister, est bon en lui-même, et la vie de mon ami également de telle manière que par lui, mon propre esse, mon fait d’exister est rendu meilleur, plus désirable même que si je n’avais qu’une conscience strictement individuelle de vivre et d’exister20.
Si cette conscience est habituelle, c’est qu’elle dure en nous et peut prendre des aspects très différents qualitativement selon les âges traversés, la période de la vie où nous prenons davantage conscience de ce qui intérieurement nous anime, les événements qui jalonnent notre histoire personnelle et le retentissement de ceux-ci sur cette conscience habituelle. Parfois, elle n’est guère présente à nous-mêmes, quand nous sommes trop pris par l’extériorité de nos activités ; elle l’est trop au contraire dans le chagrin ou dans des périodes d’échecs, de doutes. Ne pourrait-on dire dans ces conditions que cette conscience habituelle de nous-mêmes à travers chacun de nos actes, et comme ‘fond’ permanent de ceux-ci, est la conscience d’une durée intérieure qui a sa vie en nous, se développe, évolue en suivant les sinuosités diverses, et donc nécessairement qualitatives, des retentissements en elle de notre histoire personnelle ? Ce qui est une manière bergsonienne de poser le problème.
Un texte de saint Thomas pourra compléter notre analyse de cette « conscience immédiate » par laquelle nous pouvons nous rendre présents à nous-mêmes d’une manière continue. Il s’agit d’un texte du commentaire des Physiques d’Aristote au début de la définition du temps. Aristote cherche disputative, comme l’indique saint Thomas, à manifester ce qu’est le temps, et d’abord que celui-ci ne va pas sans mouvement : cela semble évident si l’on s’appuie sur l’expérience commune, c’est-à-dire ici une donnée immédiate qu’une conscience temporelle peut avoir, une perception commune que tout le monde peut faire et que le philosophe ici met à jour en se servant d’un exemple. Cette donnée immédiate, parce que commune, est le point de départ d’une détermination plus explicite ensuite. Nous sommes avec ce texte dans l’ordre de la recherche et tout le monde est capable, s’il veut bien s’en donner la peine, de faire cette expérience interne :
570. Il montre que le temps n’existe pas sans mouvement parce que lorsque les hommes ne se meuvent pas en le connaissant, ou quand ils se meuvent celui-ci leur étant caché, il ne leur apparaît pas alors qu’il s’est passé un certain temps. Comme on le voit dans le cas de ces hommes à Sardes, une ville d’Asie, qu’une fable dit dormir auprès des Héros, c’est-à-dire des dieux. En effet, ils appelaient Héros les âmes des grands hommes et des hommes de bien qu’ils honoraient presque comme des dieux, comme Hercule, Bacchus et d’autres semblables. Par certaines incantations ils se rendaient insensibles et disaient avoir dormi auprès des Héros. Hors d’eux-mêmes, ils disaient avoir vu des réalités étonnantes et révélaient certains faits futurs. Mais quand ils revenaient à eux ils ne percevaient pas le temps écoulé pendant qu’ils étaient en transe. Car ils unissaient le premier instant où ils avaient commencé à dormir à l’instant postérieur où ils revenaient à eux comme si cela n’avait été qu’un seul instant ; ils n’avaient pas la perception qu’il y avait eu un temps intermédiaire. Ainsi donc, s’il n’y avait pas d’instants différents mais un seul instant, il n’y aurait pas de temps intermédiaire ; c’est pourquoi, aussi, lorsque nous est cachée la diversité de deux instants, nous ne percevons pas de temps intermédiaire. S’il arrive, donc, que nous ne pensons pas au temps quand nous ne percevons pas de changement, puisqu’il nous semble que nous sommes dans un instant indivisible, nous percevons que le temps passe quand nous sentons et déterminons, c’est-à-dire nombrons, un mouvement ou un changement. Il s’ensuit manifestement que le temps n’existe pas sans mouvement ni sans changement.
572. C’est pourquoi il affirme que, à cause de notre recherche sur la nature du temps, on doit commencer par comprendre que le temps est quelque chose du mouvement. Et que celui-ci soit un certain mouvement, cela est manifeste du fait que nous sentons simultanément le temps et le mouvement. Il arrive, en effet, parfois que nous percevons le flux du temps (fluxum temporis), quoique nous ne sentions aucun mouvement particulier sensible ; par exemple, nous sommes dans les ténèbres et, par la vue, nous ne sentons pas le mouvement extérieur. Et si nous n’éprouvions quelque altération dans notre corps provoquée par un agent extérieur, nous ne sentirions aucun mouvement d’un corps sensible. Et cependant, s’il se produit un mouvement dans notre âme, comme, par exemple, la succession des pensées et des images, il nous apparaît soudain qu’il se déroule un certain temps. C’est ainsi qu’en percevant un mouvement, nous percevons du temps et, à l’inverse, quand nous percevons du temps, nous percevons en même temps du mouvement. C’est pourquoi, comme il n’est pas lui-même du mouvement, comme nous l’avons prouvé plus haut, nous disons qu’il est quelque chose du mouvement21.
N’avons-nous pas dans ce texte affaire à une expérience interne, une donnée immédiate de notre conscience, une perception, une sensation d’un mouvement qui nous permet de percevoir le temps, l’expérience d’un ‘flux’ continuel de pensées, de sensations, d’images, et l’on pourrait ajouter, de tout ce qui peut naître de la perception interne de nos organes et facultés ? N’est-ce-pas aussi souligner que notre conscience peut être habitée intérieurement par la conscience, la perception, la sensation d’un écoulement temporel ? Comme nous sommes dans ce texte de Thomas, au début d’une recherche, les verbes sentir, percevoir ne sont pas distingués du verbe nombrer, verbe qui désigne un acte plus spécifiquement rationnel, plus mathématique sans doute aussi et de ce fait, plus abstrait. Mais avant cette numération explicite, c’est le temps de la perception interne, de la sensation d’un écoulement, d’une prise de conscience ; ce devenir des pensées met à jour l’existence temporelle de la conscience.
3. Une question de ‘méthode’ ?
On pourra toujours dire de ces textes que nous citons, mises à part les citations du De l’âme et du commentaire sur Les Physiques, qu’ils sont des textes théologiques au service d’une problématique théologique ; en particulier le texte extrait d’une question du De Veritate puisque l’article est une partie d’une question aux allures augustiniennes (De l’esprit, dans lequel réside l’image de la Trinité). Il pose la question : Est-ce que l’esprit se connaît lui-même par son essence ou par une espèce (sous entendue acquise par un acte de connaissance) ? On pourrait, dans ces conditions, affirmer que ces analyses ne concernent nullement la philosophie…
Derrière cette question, se profilent les analyses de saint Augustin dans son De Trinitate ; plus précisément, les chapitres IX et X. Celles-ci sondent comment l’être humain, à travers ses facultés principales que sont la mémoire, la volonté et la raison, ou dans la relation entre l’âme, la connaissance et l’amour, peut être une image de la Trinité reflétant la relation des personnes divines et leur unité. De même que l’esprit est un et aussi un ‘tout’ composé de parties relatives les unes aux autres, que cette relation ‘trinitaire’ ne s’oppose pas à l’unité de la substance de l’esprit, de même la relation des Personnes divines ne s’oppose pas à l’Unité divine : l’esprit est une substance et a des facultés relatives les unes aux autres ; nous sommes images et ressemblances de Dieu Un et Trois Personnes.
Pour saint Augustin cette méditation doit permettre à l’esprit de se rendre intérieur à lui-même, de dégager sa véritable nature qui doit le conduire à Dieu en lui permettant de s’échapper à tout ce qui peut lui être extérieur, en particulier tout cet univers intérieur d’images, de sensations qui accrochent l’âme et la distraient de sa véritable nature et finalité. Cette méditation, en même temps qu’elle est une analyse spéculative est aussi comme un ‘exercice spirituel’ pour atteindre vraiment ce pourquoi l’esprit est fait :
C’est donc un étrange problème de savoir comment l’âme se cherche et se trouve, vers quoi elle tend pour se chercher, où elle va pour se trouver. Qu’y a-t-il qui soit plus dans l’âme que l’âme ? Mais comme elle est dans les choses auxquelles elle pense avec amour – les choses sensibles, les choses corporelles, avec lesquelles son amour l’a rendue familière, - elle ne peut plus être en soi sans les images de ces corps […] Ces images se sont étrangement agglutinées à elle par le liant de l’amour. Lorsqu’on lui fait un devoir de se penser, qu’elle n’aille donc pas se chercher comme si elle était soustraite à elle-même, mais qu’elle s’arrache à ce qu’elle s’est ajoutée. Elle est en effet plus intérieure à elle-même non seulement que les objets sensibles qui, manifestement, sont au-dehors, mais encore que les images de ces objets […] Que l’âme se connaisse donc elle-même. Qu’elle se cherche non comme une absente, mais qu’elle fixe sur elle l’attention de la volonté qui errait à l’aventure sur les autres choses et qu’elle se pense ! Elle verra alors qu’elle n’a jamais cessé de s’aimer, jamais de se connaître : mais en aimant en même temps que soi autre chose que soi, elle s’y est mêlée et agrégée en quelque sorte […]22.
Étant ainsi préparée, l’âme peut alors se connaître elle-même, reproduisant ainsi le connais-toi toi-même socratique. Et ceci, parce que :
Lorsqu’on dit à l’âme « connais-toi toi-même », dès l’instant qu’elle comprend ces paroles « toi-même », elle se connaît ; cela, pour la simple raison qu’elle est présente à elle-même […] Que l’âme donc n’ajoute rien à la connaissance qu’elle a d’elle-même, lorsqu’elle reçoit le précepte de se connaître ! Elle sait avec certitude que ce précepte s’adresse à elle, à elle qui est, qui vit, qui comprend. Le cadavre est aussi, les animaux vivent aussi ; mais comprendre, ni le cadavre ni les animaux ne le peuvent […]23.
Par cette présence à elle-même l’âme va donc saisir immédiatement qu’elle vit, qu’elle existe parce qu’elle comprend, qu’elle se voit comprendre, qu’elle sait qu’elle veut, qu’elle sait qu’elle se souvient. Même l’expérience d’un doute nous met devant l’évidence de l’existence de l’âme ; il devient lui-même un chemin pour saisir l’être de l’esprit comme existant véritablement, vivant réellement24 :
Par contre, nul ne doute qu’il ne se souvienne, qu’il ne comprenne, qu’il ne veuille, qu’il ne pense, qu’il ne sache, qu’il ne juge. Puisque, même s’il doute, il vit ; s’il doute d’où vient son doute, il se souvient ; s’il doute, il comprend qu’il doute ; s’il doute, il veut arriver à la certitude ; s’il doute il pense ; s’il doute, il sait qu’il ne sait pas ; s’il doute il sait qu’il ne faut pas donner son assentiment à la légère. On peut donc douter du reste, mais de tous ces actes de l’esprit, on ne doit pas douter ; si ces actes n’étaient pas, impossible de douter de quoi que ce soit25.
Il s’agit donc bien d’une présence de l’esprit à lui-même qui lui permet de saisir son être et sa vie ; présence immédiate, commune à tout homme, que tous peuvent faire en conséquence mais qui demande un effort, une purification pour se rendre intérieur à soi-même et se dégager du sensible. Non pas que le sensible soit une illusion, mais parce que son empreinte en nous avec les images mémorisées risquent de nous détourner de ce qui est le plus nous-mêmes.
L’intérêt du texte de Thomas de la question disputée De veritate est, entre autres, qu’il fait allusion à un texte d’Aristote, celui que nous citions :
Quant à une connaissance actuelle par laquelle quelqu’un se considère comme ayant une âme en acte, je dis que l’âme est connue par ses actes. En effet, que quelqu’un perçoit qu’il a une âme, qu’il vit, qu’il existe, dans le fait qu’il perçoit qu’il sent et comprend et qu’il exerce d’autres opérations vitales de ce type. C’est pour quoi le Philosophe dit au livre IX de l’Éthique à Nicomaque : Mais nous sentons que nous sentons ; et nous comprenons que nous comprenons, et parce que nous le sentons, nous comprenons que nous sommes. Mais personne ne se perçoit en train de comprendre sinon par le fait qu’il comprend quelque chose : on comprend, en effet, quelque chose, avant de comprendre que l’on comprend. C’est pourquoi l’âme parvient à la perception actuelle qu’elle existe par le fait qu’elle comprend, qu’elle sent26.
On ne peut se percevoir en train de penser si on ne pense pas à quelque chose effectivement, si l’on n’a pas un objet effectif de pensée. Il faut effectivement penser avant d’avoir conscience que l’on pense, pour que l’on ait une conscience que l’on pense, pour que l’on soit effectivement présent à soi-même. Autrement dit, Thomas affirme ici, en s’appuyant aussi sur un texte d’Aristote, l’antériorité de l’être sur l’esprit : on ne peut être intérieur à soi-même que si l’on pense effectivement à quelque chose, si l’on conçoit donc en nous quelque chose. Or quand on conçoit une chose, c’est que la réalité est en nous présente d’une manière intentionnelle. C’est donc bien que nous sommes reliés à ce qui existe. Et reliés d’abord par notre connaissance sensible (les cinq sensations qui sont les sens externes et l’imagination et la mémoire qui sot les sens internes) qui reçoit en elle le réel sensible, qui s’imprime en nous d’une certaine manière nous rendant relatif à lui, par nos images, nos souvenirs, nos sensations. C’est pourquoi, pour aller à Dieu, le réalisme aristotélicien demande cette antériorité de l’être sur l’esprit, être extra-mental que nous rencontrons dès lors que nous voulons ouvrir les yeux, écouter le bruit des choses, nous souvenir des images, ces traces des choses en nous. Il ne peut donc pas se limiter à la seule perception de la nature de l’esprit comme seul chemin possible vers Dieu, puisque la découverte elle-même de l’esprit, de l’existence de l’âme se fait par une présence de soi à des contenus de pensée qui nous permettent de prendre conscience que nous pensons.
Il est évident que la problématique de tous ces textes, ceux de Thomas comme ceux de saint Augustin, est d’abord théologique, mais il est non moins évident, par ailleurs, que le philosophe païen Aristote converge aussi, à sa manière, vers cette problématique :
Dirigeant mes efforts d’après cette règle de foi (saint Augustin vient de citer le Deutéronome, saint Paul, et, surtout, saint Jean) autant que je l’ai pu, autant que tu m’as donné de le pouvoir, je t’ai cherché ; j’ai désiré voir par l’intelligence ce que je croyais ; j’ai beaucoup étudié et beaucoup peiné, Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que, par lassitude, je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face (Ps. CIV, 4)27.
« J’ai désiré voir par l’intelligence ce que je croyais ».
Cela dit, saint Augustin veut voir, c’est-à-dire comprendre, saisir le mieux possible par l’intelligence, la vérité de l’esprit, vérité reçue d’abord bien évidemment de la Parole de Dieu à laquelle il adhère de tout son être et de tout son esprit, de toute son intelligence de ce fait ! Ce qui implique une étape par la méditation sur la nature de l’esprit et la prise en compte de tout ce qu’une une présence actuelle de l’esprit à lui-même peut nous faire découvrir de sa nature. En cela, la philosophie qui voit par l’intelligence est, pour Augustin, le chemin, le préambule qui prépare la foi ou qui, aussi, la conforte, la rend plus ferme, plus affirmative. L’intelligence veut saisir le mieux possible la nature de l’esprit pour y reconnaître dans sa nature l’image que Dieu a laissée de Lui, et ceci à partir d’expériences premières réalisables par tous si l’on veut quelque peu se rendre attentif à la véritable nature de son être en se dégageant non pas du sensible en lui-même, mais de ce qui nous attache trop à ces réalités terrestres dont nous avons en nous les empreintes fortes et durables : elles peuvent nous distraire, nous détourner de notre véritable intériorité.
L’intention d’Augustin rejoint en ce sens celle de Thomas, à travers les références philosophiques différentes qu’ils peuvent avoir l’un et l’autre, du fait des différences de temps, de lieux, d’histoire (etc.) et de tempérament et de vocations dans l’Église. Thomas ne répudie nullement l’expérience augustinienne ni ne la contredit purement et simplement. Il l’imprègne d’Aristote en la fondant sur la primauté non pas de l’esprit mais de l’être extra-mental à qui tout l’être de l’homme est relié par chacune de ses facultés mises en acte par la réception en elles de la réalité et la réaction à cette réception. Dans ces conditions, l’expérience augustinienne de cette prise de conscience de soi par l’amour, de l’amour de soi par la connaissance de soi peut nourrir le réalisme thomasien qui, lui aussi, prend en compte l’expérience intérieure de la présence de soi-même à soi-même dans une conscience immédiate de soi-même. Nous pouvons alors ne considérer que la vérité de cette expérience interne et la nourrir, l’enrichir, la vitaliser en quelque sorte par l’expérience intérieure d’un flux temporel continu de nos actes de pensées, de sentiments, de volitions, etc. Expérience commune s’il en est, philosophique si l’on veut. Et l’on peut s’arrêter à celle-ci, si on le désire, sans essayer d’en faire une étape vers la découverte d’une présence de Dieu en nous, d’une ‘habitation’ de Dieu en nous : dans ce domaine, nous en sommes remis à notre conscience et à notre liberté les plus profondes. Nous aurions, ce faisant, l’exemple le plus emblématique peut-être, d’une question théologique – et somme toute éminemment spirituelle et religieuse puisqu’il y va de la vie même de l’âme intérieure -, qui suscite l’intelligence philosophique pour aider à conforter la foi elle-même, et, qui, parce qu’elle est philosophique, peut devenir une vérité distincte de sa finalité théologique, sans que l’on puisse crier à la confusion des genres et des méthodes !
Personne d’ailleurs ne peut interdire à quiconque de faire cette expérience de la présence de l’âme à soi-même dans l’expérience interne de la saisie des ‘données immédiates’, qu’il soit croyant ou non : il s’agit d’un donné naturel premier, mais on ne peut saisir l’immédiateté de cette expérience interne que par un effort volontaire de perception d’une continuité d’états, de tendances et d’actes vivant en nous, qui se compénètrent les uns les autres d’une manière continue et toujours nouvelle : conscience d’un flux temporel, d’une durée intérieure, d’une réelle unité qui progresse, qui se développe, qui vit en un mot, condition et cause de notre personnalité unique que l’on peut, à partir d’elle, mieux connaître.
Mais, nous sommes déjà avec Bergson et sa manière de penser ces « données immédiates de la conscience »…
4. Les données immédiates de la conscience, chemin pour la philosophie ?
Il s’agit, d’abord, dans sa thèse Les données immédiates de la conscience de rectifier le ‘mécanicisme’ de la psycho-physique, fréquent à l’époque de Bergson chez un Gustav Fechner, par exemple ou un Wilhem Wundt28. Ce mécanicisme pouvait rendre déterminés tous les comportements humains et donc rendait difficile l’exercice effectif de la liberté. Mais plus profondément aussi, il y a une critique du mécanicisme physique inauguré par Newton qui dans le domaine des forces physiques peut se justifier mais ne peut être transposé tel quel dans le domaine biologique et psychologique. On ne peut considérer, en effet, les êtres vivants, et, en particulier la conscience humaine, comme exclusivement relatifs aux lois qui gouvernent les mouvements physiques dans la nature. C’est pourquoi, Les données immédiates s’attaqueront à la question de la liberté et de la durée intérieure manifestant le caractère qualitatif, non absolument et totalement quantifiable, de la conscience humaine et donc de la liberté, et ceci par une distinction, chère à Bergson ensuite, entre le temps mathématique mesurable et la durée intérieure qualitative irréductible à toute mesure29.
Dans une lettre importante à l’écrivain italien Giovanni Papini Bergson indiquera l’origine de ce premier livre et le bouleversement qu’il éprouva en découvrant l’importance de la durée intérieure de la conscience ; bouleversement qui fut à l’origine de toute sa pensée ultérieure :
En réalité, la métaphysique m’attirait beaucoup moins que les recherches relatives à la théorie des sciences. Je me proposais, pour ma thèse de doctorat, d’étudier les concepts fondamentaux de la mécanique. C’est ainsi que je fus conduit à m’occuper de l’idée de temps. Je m’aperçus, non sans surprise, qu’il n’est jamais question de durée proprement dite en mécanique ni même en physique, et que le « temps » dont on y parle est tout autre chose. Je me demandai alors où est la durée réelle, et ce qu’elle pouvait bien être, et pourquoi notre mathématique n’a pas de prise sur elle. C’est ainsi que je fus amené graduellement du point de vue mathématique et mécanistique où je m’étais placé d’abord, au point de vue psychologique. De ces réflexions est sorti l’Essai sur les données immédiates de la conscience où j’essaie de pratiquer une introspection absolument directe et de saisir la durée pure30.
L’évolution créatrice, ensuite, se penchera sur les données biologiques de la théorie de l’Évolution pour tenter de les interpréter à la lumière de cette expérience première qu’est la conscience de la durée intérieure, et fonder cette expérience sur le mouvement même de la vie.
Ainsi sa thèse rend d’abord effectivement présente cette conscience immédiate comme une expérience authentique et première qui peut être expérimentée par tous31 ; elle peut ouvrir l’attention sur la nature de l’esprit, et par là, de la personne humaine, ou pour employer un terme davantage bergsonien, de la personnalité humaine. Car évoquer la personne, c’est évoquer une notion générale, parler de personnalité, c’est insister sur l’individu réel, vivant, concret qui a sa manière propre de vivre, ses dispositions justement personnelles. Comme le souligne Jacques Chevalier dans son livre Bergson :
Nos états psychologiques se pénètrent intimement ; ce n’est pas telle sensation ou telle image qui pousse mon désir et ce désir qui pousse ma volonté, comme autant de forces physiques, distinctes et séparées, qui agiraient les unes sur les autres ; nos états intimes sont en nous « comme des êtres vivants, sans cesse en voie de formation »32 : ils se développent, ils s’organisent, ils se fondent ensemble au sein d’un moi vivant et durant comme eux, dont ils reflètent et expriment la concrète individualité. En chacun de nos états ou de nos actes, la conscience nous présente à nous-mêmes notre moi ; en chacun d’eux elle se saisit elle-même, comme un être spirituel invisible, ordonné dans le temps, non dans l’espace, et indivisible comme le temps réel où elle s’ordonne ; car notre durée intérieure, envisagée du premier au dernier moment de notre vie consciente, est un indivisible déroulement33.
Bergson nous permet alors de mettre à jour une expérience effectivement présente dans la philosophie thomasienne, nous venons de l’indiquer. Mais la manière, selon Bergson, d’être présent à soi-même, peut aussi nous apporter beaucoup. Elle est, en effet, un regard unitif, synthétique de beaucoup d’actes, de tendances et de besoins naturels, de beaucoup d’événements aussi mémorisés et présents dans notre passé. Elle est relative à la mémoire recueillant ce qui a été vécu pour saisir un élan, une orientation, un ‘style’ d’âme, une courbure essentielle qui marque une certaine unité à travers la manière dont nous avons vécu des événements passés. Prise de conscience active, en un mot, une réminiscence d’une certaine manière, synthétique et unitive d’une multiplicité d’états de conscience. C’est pourquoi dira-t-il dans une conférence à Madrid :
Si nous prenons notre vie intérieure depuis le moment où nous naissons, et même au-delà, tout cela, tout ce mouvement est absolument comme celui de la flèche de Zénon, c’est un saut indivisible qui occupe du temps, tout le temps que l’on voudra, mais un temps indivisible. Toutes les divisions que l’on voudra y introduire seront artificielles. Notre vie consciente est un flux, elle a la continuité d’un courant qui commencerait à la naissance pour ne plus jamais s’arrêter […] L’unité de la personne appartient à la vie intérieure elle-même, comme une continuité indivisible, et il ne faut pas la chercher ailleurs, hors du temps ou dans l’inconnaissable. Elle se manifeste en pleine clarté dans la continuité de la vie intérieure, si l’on met de côté les obscurités artificiellement introduites par les métaphysiciens34.
Cette conscience ne peut donc pas être une conscience purement intellectuelle ou spirituelle dans le sens où elle ne ferait intervenir qu’une pensée pure dégagée du corps, de la relation à la réalité sensible - c’est-à-dire à l’ensemble de l’univers -, de notre propre manière d’être reliée à celle-ci par nos sens externes – les sensations -, et internes - imagination et notre mémoire. Cette conscience est, au fond, l’histoire de notre vie intérieure constituée par le retentissement en nous de ce que, dans toutes nos facultés, nous avons vécu.
L’intérêt de celle-ci est qu’elle soit unitive et synthétique, que nous puissions la saisir comme un tout qui recueille un pluralité d’actes se fondant entre eux pour pousser la conscience présente en avant, assurant aussi par le fait même la continuité avec le présent ; ce qui fait que nous pouvons parler de ‘personnalité’ unifiée, ou, du moins, en voie d’unification. Ainsi, tout de suite, de par cette saisie intérieure de nous-même, nous sommes face à notre personnalité propre et unique. C’est la fécondité d’une telle saisie intérieure, que de nous rendre présent à nous-même. Elle demande un effort effectif : celui de prendre conscience du ‘trésor’ que sont l’ensemble des états conservés dans la mémoire, mettant en valeur ainsi l’existence de notre mémoire principe d’unité et de continuité entre le passé et le présent.
Il est vrai que l’analyse cherche à distinguer les différents objets des diverses tendances et les actes de ces tendances. Elle classe, relie, divise, sépare. Ce qui est nécessaire, bien évidemment. Mais cette vue unitive et synthétique qu’est cette conscience immédiate va plus loin que cette classification puisqu’elle est saisie d’une unité qualitative, unique et absolument non répétable à l’identique de ce qui peut se nommer à juste titre une personnalité Et par là, d’une liberté. C’est dire que d’emblée, nous sommes face à l’existence d’une personnalité unique, qualitativement différente d’une autre et d’une liberté qui s’affirme dans l’existence de cette personnalité. Bref, la question de la liberté se pose dès lors que l’on saisit dans cette conscience immédiate une personnalité dans une direction, un élan, un ‘style’ qu’elle veut donner à sa vie.
On peut aussi comprendre que la question de l’âme se pose tout de suite : une âme unique, principe d’unification de cette multiplicité d’actes qui interfèrent les uns sur les autres et que la mémoire recueille. Il n’y a donc pas d’emblée une dualité tranchée entre l’âme et le corps mais une interpénétration d’actes qu’unifie une mémoire puisque la personnalité se reconnaît pleinement elle-même dans chacun des états passés conservés en elle. C’est bien devant une relation entre des états moraux, corporels, physiologiques, intellectuels, que nous sommes placés dans cette conscience immédiate : il faut bien qu’il y ait un principe de vie qui unifie cette diversité pour qu’il y ait une personnalité unique. Finalement, nous le voyons, cette conscience immédiate relie la question de la liberté avec celle de la personnalité et celle de la relation de la matière et de l’esprit, mettant en valeur la mémoire comme faculté unitive de ces états intérieurs passés qui émergent dans chaque état dont nous prenons conscience dans le moment présent. Bref, la force de cette manière bergsonienne de raisonner n’est-elle pas de mettre en relation, et de les unifier, des questions qu’une analyse pourrait rendre trop distinctes et trop distantes les unes des autres ? Peut-être est-ce la force de l’intuition que de synthétiser et d’unir, de nous mettre ainsi à l’intérieur de l’unité réelle, substantielle pourrait-on dire, de la liberté, de la personnalité, de la mémoire, et de l’âme et le corps. Ce qui ne veut pas dire qu’ensuite l’analyse ne puisse entrer davantage dans la connaissance plus distincte de chacune de ces questions ; mais toujours, avec comme fond, la certitude qu’elles sont étroitement liées dans notre vie. Nous nous rappellerons toujours que ce qui est distinct dans une analyse nécessairement abstraite, est, quant à la réalité, uni. Il n’est pas impossible que la manière de philosopher de Bergson nous rappelle en permanence l’exigence d’une telle attitude.
Tout ceci implique trois questions qui, pour Bergson, seront d’importance et constitueront l’objet de plusieurs textes : d’une part, la liberté, et ce sera Les données immédiates de la conscience ; d’autre part, celle de la mémoire, - et ce sera Matière et mémoire en 1896 -, et, avec elle, celle de la question de l’âme en sa relation avec le corps puisque selon le titre même de cette œuvre, ce livre est « un essai sur les relations du corps à l’esprit ». L’énergie spirituelle abordera en 1919 la question de l’âme en particulier dans deux textes principaux que sont La conscience et la vie, et L’âme et le corps. Ainsi, ces questions de la liberté, des rapports de l’esprit à la matière, de la nature de l’âme le conduisent comme tout naturellement à celle de la personnalité
En 1916, lors d’une conférence à Madrid, Bergson posait en ces termes le problème principal de la personnalité humaine :
Quel est le problème métaphysique de la personnalité ? C’est le suivant. Comment une personnalité est-elle quelque chose d’unique ? Quand notre conscience tourne ses regards vers l’intérieur, que distingue-t-elle ? Un état d’esprit, puis un autre état d’esprit, puis un autre, et ainsi successivement, des idées, des sensations, des jugements. Tous ces états néanmoins, se maintiennent les uns les autres, se joignent et constituent ce que chacun de nous appelle une personne. Mais comment cela se peut-il ? Quel est le lien qui unit entre eux ces états discontinus ? Pour parler plus précisément, il existe, dit-on, une succession d’états de conscience dans le temps, et, pour lier tous ces états, il manque quelque chose ; qu’y a-t-il ? Quand notre conscience se tourne vers l’intérieur, ce qu’elle trouve, c’est toujours un état, et pourtant, il doit y avoir quelque chose de distinct des états d’âme pour réunir, rejoindre, les maillons de la chaîne35.
Mais la liberté, l’âme dans sa nature et dans sa relation avec le corps et la personnalité sont enracinées dans l’ensemble du mouvement de la nature tant il est vrai que l’esprit humain s’inscrit dans le mouvement de la totalité du cosmos. Dans L’évolution créatrice, face à la question biologique de l’Évolution et à ses diverses interprétations, Bergson s’efforcera de saisir comment l’intelligence, s’appuyant sur l’ensemble du mouvement des êtres vivants et suivant ainsi la direction donnée par le mouvement de la vie, procède dans ses actes propres ; et comment, à cause même de ce que la biologie elle-même peut nous dire sur l’origine des espèces vivantes, on peut tenter un effort pour retrouver une unité harmonieuse entre deux conduites auxquelles a abouti l’évolution du vivant, la conduite instinctive des espèces animales et la conduite intelligente de l’espèce humaine. C’était ainsi déterminer la nature de l’intelligence et celle de ses actes principaux par une saisie de la totalité des mouvements dans la nature. Cela permettait alors de comprendre ce vers quoi tend l’intelligence, ce qu’elle peut connaître dans son usage habituel et de rendre ainsi plus visible l’effort que nous aurions à faire pour dépasser les limites qui en relativiseraient son exercice dans sa capacité de connaître la vérité sur le réel. C’est, au fond, procéder à une étude ‘critique’ de l’intelligence ; mais une étude ‘critique’ qui fonde l’intelligence sur une philosophie du vivant, qui est, dans le sens le plus simple et le plus exact du terme, une philosophie de la nature. Ici, le réel qu’est la direction générale de la vie est antérieur aux actes de l’intelligence. C’est le mouvement même de la vie, qui explique comment procède l’intelligence, ses tendances générales, ses insuffisances aussi comme ses sommets. Comme le souligne Bergson lui-même dans l’introduction de L’évolution créatrice, « la théorie de la connaissance et la théorie de la vie nous paraissent inséparables l’une de l’autre ». Seulement, il précise bien que cette théorie de la connaissance doit replacer la connaissance dans l’évolution générale de la vie, c’est-à-dire dans une véritable philosophie de la nature :
C’est dire que la théorie de la connaissance et la théorie de la vie nous paraissent inséparables l’une de l’autre. Une théorie de la vie qui ne s’accompagne pas d’une critique de la connaissance est obligée d’accepter, tels quels, les concepts que l’entendement met à sa disposition : elle ne peut qu’enfermer les faits, de gré ou de force, dans des cadres préexistants qu’elle considère comme définitif. Elle obtient ainsi un symbolisme commode, nécessaire même peut-être à la science positive, mais non pas une vision directe de son objet. Une théorie de la connaissance qui ne replace pas l’intelligence dans l’évolution générale de la vie, ne nous apprendra ni comment les cadres de la connaissance se sont constitués, ni comment nous pouvons les élargir ou les dépasser. Il faut que ces deux recherches, théories de la connaissance et théorie de la vie, se rejoignent, et, par un processus circulaire, se poussent l’une l’autre indéfiniment36.
Dans ces conditions, ne sommes-nous pas, dans cette manière bergsonienne d’envisager la nature de l’intelligence et celle de ses actes principaux dans une attitude authentiquement réaliste qui affirme que l’être, étant antérieur au connaître, est donc la mesure de la connaissance ?
5. La question « critique » chez Bergson
Ainsi, un des points bergsonien importants est que cette conscience immédiate, pour qu’elle soit un authentique point de départ de la philosophie, doit être précédée, ou du moins accompagnée, d’une critique de la connaissance, d’une critique du langage37 et du concept dont il est à l’origine puisque les mots employés dans une langue véhiculent avec eux des concepts, des représentations abstraites de telles ou telles réalités ; celles-ci ont tendance à créer comme des automatismes verbaux, des idées toutes faites que nous répétons nous empêchant cette adaptation souple et fine à toute nouveauté que le réel peut nous faire rencontrer.
Dans un discours prononcé à l’occasion de la distribution des prix du Concours général, le 30 juillet 1895, Bergson, en fin pédagogue qu’il sait être, affirmera en définissant le bon sens :
Mais regardons de plus près : le bon sens n’est pas plus que le génie une attitude passive de l’esprit, attendant au milieu de la nuit, que l’éclair brille et que la lumière se fasse. Si le génie devine la nature, c’est qu’il a vécu dans une étroite camaraderie avec elle. Le bon sens, lui aussi, exige une activité incessamment en éveil, un ajustement toujours renouvelé à des situations toujours nouvelles. Il ne redoute rien tant que l’idée toute faite, fruit mûr de l’esprit peut-être, mais fruit détaché de l’arbre, bientôt desséché, et ne présentant plus, dans sa rigidité, que le résidu inerte du travail intellectuel. Le bon sens est ce travail même. Il veut que nous tenions tout problème pour nouveau et lui fassions l’honneur d’un nouvel effort. Il exige de nous le sacrifice, parfois pénible, des opinions que nous nous étions faites et des solutions que nous tenions prêtes. Et pour tout dire, il paraît avoir moins de rapport avec une science superficiellement encyclopédique qu’avec une ignorance consciente d’elle-même, accompagnée du courage d’apprendre […] Je vois justement dans l’éducation classique, avant tout, un effort pour rompre la glace des mots et retrouver au-dessous d’elle le libre courant de la pensée. En vous exerçant, jeunes élèves, à traduire les idées, d’une langue dans une autre, elle vous habitue à les faire cristalliser, pour ainsi dire, dans plusieurs systèmes différents ; par elle, elle les dégage de toute forme verbale définitivement arrêtée, et vous invite à penser les idées mêmes, indépendamment des mots38.
Le langage, introduisant dans l’esprit des concepts distincts, instaure des séparations, des négations, des oppositions, il classe, hiérarchise et risque ainsi d’immobiliser des états qui, dans la réalité, sont essentiellement mobiles. C’est pourquoi le langage, et avec lui, les concepts abstraits, peuvent être une opposition à la vraie liberté de l’esprit si nécessaire pour la vie philosophique, pour toute vie d’ailleurs quelle qu’elle soit. Bergson dira en effet un peu plus loin dans ce discours :
Un des grands obstacles, disions-nous à la liberté de l’esprit, ce sont les idées que le langage nous apporte toutes faites, et que nous respirons, pour ainsi dire dans le milieu qui nous environne. Elles ne s’assimilent jamais à notre substance : incapables de participer à la vie de l’esprit, elles persévèrent, véritables idées mortes, dans leur raideur et leur immobilité. Pourquoi donc les préférons-nous si souvent à celles qui vivent et qui vibrent ? Pourquoi notre pensée, au lieu de travailler à se rendre maîtresse chez elle, aime-t-elle mieux s’exiler d’elle-même ? C’est d’abord par distraction, et parce qu’à force de nous amuser le long de la route, nous ne savons plus où nous voulions aller39.
Il faut donc, d’après Bergson, tout en commençant par les données immédiates de la conscience, critiquer l’origine du langage et du concept afin que nous puissions établir vraiment comment d’authentiques données immédiates de la conscience peuvent être le point de départ d’une prise de conscience de ce qui en nous dure essentiellement, mettant ainsi à jour l’unité profonde de notre personnalité unique ; en conséquence ces « données immédiates de la conscience » demandent un effort : celui de lutter contre une pente naturelle de l’esprit qui est de simplifier, d’homogénéiser, d’universaliser en un mot, la richesse d’un réel, essentiellement qualité d’états hétérogènes qui, dans leur flux, changent, durent et s’enrichissent de multiples nuances qu’apportent leur changement40.
Cette pente naturelle, Bergson dira qu’elle spatialise, qu’elle représente les réalités dans un espace quantitatif, étendu, nous rendant ainsi impossible la vision de leur milieu naturel auquel elles sont attachées et dont elles dépendent. Il va sans dire que ces données immédiates de la conscience ne pourront être saisies qu’après une conversion de l’esprit, par cette critique de ce qui, dans le langage et le concept, risque d’immobiliser et de relativiser les capacités de l’esprit humain.
Car, pour Bergson, nous prenons trop facilement l’habitude de penser à travers des idées toutes faites41, des catégories mentales stéréotypées et qui, dans la philosophie, donneront des systèmes abstraits ; et nous nous empêchons alors de saisir de la réalité toute la nouveauté qualitative et toute la richesse imprévue qui pourrait renouveler nos idées et saisir mieux la vérité d’un réel dont la richesse intrinsèque dépasse largement la connaissance que l’on peut en avoir, et ceci dans tous les domaines des diverses réalités, psychologiques (dans Les données immédiates de la conscience et Matière et mémoire), biologiques (dans L’évolution créatrice), sociologiques, morales et religieuses (dans Les deux sources de la morale et de la religion), métaphysiques (dans La pensée et le mouvant), spirituelles (dans L’énergie spirituelle mais nous pourrions citer tout autant ses deux premiers livres)42, celles dont Bergson s’est tout particulièrement occupé.
Cette intention ‘critique’, nous la voyons dès l’avant-propos de sa thèse de doctorat Les données immédiates de la conscience ; les premières phrases elles-mêmes le soulignent :
Nous nous exprimons nécessairement par des mots, et nous pensons le plus souvent dans l’espace. En d’autres termes, le langage exige que nous établissions entre nos idées les mêmes distinctions nettes et précises, la même discontinuité qu’entre les objets matériels. Cette assimilation est utile dans la vie pratique, et nécessaire dans la plupart des sciences. Mais on pourrait se demander si les difficultés insurmontables que certains problèmes philosophiques soulèvent ne viendraient pas de ce qu’on s’obstine à juxtaposer dans l’espace les phénomènes qui n’occupent point d’espace et si, en faisant abstraction des grossières images autour des quelles le combat se livre, on n’y mettrait pas parfois un terme43.
C’est à Clermont-Ferrand que Bergson a préparé sa thèse44, c’est aussi dans cette ville qu’il eut aussi, un jour, après la présentation à ses élèves des arguments de Zénon d’Elée45, l’idée de ce qui deviendra sa ‘métaphysique de la durée’, et par le fait même la critique de l’intelligence abstraite qui rend incapable de penser, mieux, de vivre, de sympathiser avec cette durée inhérente à toutes les choses. Nous savons que les arguments de Zénon suppriment l’existence du mouvement puisque pour parcourir une certaine distance, un être mobile (en l’occurrence ici, une flèche, Achille et une tortue) doit parcourir une infinité de points. C’est supposer dans ces conditions que le temps se divise comme l’on divise une quantité. Alors qu’en fait, le mobile, une fois parcourue une certaine distance, se retournant sur le trajet accompli, pourra regarder et mesurer les distances, diviser celle-ci en autant de parties qu’il le voudra. Mais diviser ainsi, c’est diviser un mouvement déjà accompli, donc immobile et non pas rendre compte d’un mouvement en train de s’accomplir, c’est-à-dire considérer une réalité d’un point de vue statique et s’interdire ainsi de recevoir en nous vraiment tel ou tel être réel. Il faut donc distinguer le temps mis pour parcourir une certaine distance, qui, étant une mesure, est de l’ordre de la quantité et la durée intérieure vécue par ce même mobile, durée existant en lui quand il accomplit ce mouvement. Cette représentation spatiale, on peut la voir à l’œuvre dans le langage et dans l’intelligence pratique qui est faite pour trouver des moyens afin de réaliser le mieux possible la satisfaction de nos besoins ; l’intelligence pratique est donc à l’aise dans les classifications, les définitions, les divisions, les distinctions nettes et tranchées tout comme le langage qui cherche à mettre un nom sur une chose sans pouvoir s’adapter vraiment à cette chose qui est mouvante, changeante, dont la vie se déroule selon des états qualitatifs divers, hétérogènes, en un mot qui dure qualitativement. Comme il le dira dans un cours au Collège de France sur l’idée de temps en 1902-1903 :
Le mouvement, vu du dehors, est un déplacement, une trajectoire ; vu du dedans, il est quelque chose de simple, d’analogue à un état d’âme, car différents mouvements, vus de l’intérieur du mobile, donneraient une impression indivisible et originale. Or, le système de signes par lequel nous exprimons un mouvement est bien général ; car il permet de le décomposer en une infinité d’éléments doués d’une vitesse infinitésimale, en points, éléments rectilignes, nombres également utilisables pour d’autres cas. Il est orienté vers l’action : la connaissance intuitive du mouvement comme fait indivisible n’est pas utile pour la vie ; ce qui nous intéresse, c’est de savoir où est le mobile, car cette connaissance seule nous donne prise sur lui46.
C’est donc bien la distinction du temps et de la durée et par là la durée elle-même qui est le centre essentiel de la philosophie de Bergson. Il le dira très explicitement en 1915 :
À mon avis, tout résumé de mes vues les déformera dans leur ensemble et les exposera, par là même, à une foule d’objections, s’il ne se place pas de prime abord et s’il ne revient pas sans cesse à ce que je considère comme le centre même de la doctrine : l’intuition de la durée. La représentation d’une multiplicité de « pénétration réciproque », toute différente de la multiplicité numérique – la représentation d’une durée hétérogène, qualitative, créatrice – est le point d’où je suis parti et où je suis constamment revenu. Elle demande à l’esprit un très grand effort, la rupture de beaucoup de cadres, quelque chose comme une nouvelle méthode de penser (car l’immédiat est loin d’être de plus facile à apercevoir) ; mais une fois qu’on est arrivé à cette représentation et qu’on la possède sous sa forme simple (qu’il ne faut pas confondre avec une recomposition par concepts), on se sent obligé de déplacer son point de vue sur la réalité […]47.
6. L’intuition de la durée
Cette intuition de la durée, Bergson l’a donc d’abord déterminée dans sa thèse. Autrement dit, elle est une de ces données immédiates de la conscience qu’il faut pouvoir saisir par un effort volontaire d’attention à notre vie intérieure, à notre durée intérieure, celle de notre conscience ; elle demande donc aussi, comme nous le disions, une ‘critique’ de nos habitudes intellectuelles d’abstraction et de généralisation. Cette immédiateté là devient vraiment immédiate quand on a pu convertir son regard pour se rendre attentif à la succession continue de nos états passés qui, par la mémoire, affleure dans notre présent et lui donne une qualité particulière ; la diversité de ces états intérieurs constitue une multiplicité qualitative, un développement continu d’états hétérogènes et finalement imprévisibles dans leur création incessante :
Force est donc bien d’admettre qu’il y a ici une synthèse pour ainsi dire qualitative, une organisation graduelle de nos sensations successives les unes avec les autres, une unité analogue à celle d’une phrase mélodique. Telle est précisément l’idée que nous nous faisons du mouvement quand nous pensons à lui seul, quand nous extrayons de ce mouvement, en quelque sorte, la mobilité. Il suffira, pour s’en convaincre, de penser à ce qu’on éprouve en apercevant tout à coup une étoile filante, dans ce mouvement d’une extrême rapidité, la dissociation s’opère d’elle-même entre l’espace parcouru, qui nous apparaît sous forme d’une ligne de feu, et la sensation absolument indivisible de mouvement et de mobilité. Un geste rapide qu’on accomplit les yeux fermés se présentera à la conscience sous forme de sensation purement qualitative, tant qu’on n’aura pas songé à l’espace parcouru. Bref, il y a deux éléments à distinguer dans le mouvement, l’espace parcouru et l’acte par lequel on le parcourt, les positions successives et la synthèse de ces positions. Le premier de ces éléments est une quantité homogène ; le second n’a de réalité que dans notre conscience ; c’est, comme l’on voudra, une qualité ou une intensité48.
C’est pourquoi la durée représente, comme il le dit dans Les données immédiates… :
Une multiplicité qualitative, sans ressemblance avec le nombre ; un développement organique qui n’est pourtant pas une quantité croissante ; une hétérogénéité pure au sein de laquelle il n’y a pas de qualités distinctes. Bref, les moments de la durée interne ne sont pas extérieurs les uns aux autres49.
Ou bien, dans La pensée et le mouvant :
Pourtant, il n’y a pas d’état d’âme, si simple soit-il, qui ne change à tout instant, puisqu’il n’y a pas de conscience sans mémoire, pas de continuation d’un état sans l’addition, au sentiment présent, du souvenir des états passés. En cela consiste la durée. La durée intérieure est la vie continue d’une mémoire qui prolonge le passé dans le présent, soit que le présent renferme distinctement l’image sans cesse grandissante du passé, soit plutôt qu’il témoigne, par son continuel changement de qualité, de la charge toujours plus lourde qu’on traîne derrière soi à mesure qu’on vieillit davantage. Sans cette survivance du passé dans le présent, il n’y aurait pas de durée, mais seulement de l’instantanéité50.
Sur cette perception de notre durée intérieure se calque celle des choses, tout spécialement les durées propres aux êtres vivants, dans chacune de leur individualité et dans le mouvement d’ensemble qui les relie les uns aux autres comme une grande procession continue d’êtres différents qualitativement, imprévisibles dans leur nouveauté, mais formant un long processus animé d’un élan vital qui les soulève, les fait progresser, évoluer, changer, parfois aussi stagner à l’image de notre durée intérieure qui est aussi comme cet élan vital continu, aux formes toujours qualitativement nouvelles si l’on sait y être attentif, imprévisibles, mais marquées d’une certaine unité, celle de notre personnalité. Ainsi :
L’univers dure. Plus nous approfondirons la nature du temps, plus nous comprendrons que durée signifie invention, création de formes, élaboration continue de l’absolument nouveau51.
Or, tous peuvent, s’ils sont invités à cet effort volontaire de saisie intérieure, percevoir cette continuité, la comprendre comme qualitative et prendre conscience de cette incessante continuité du passé dans le présent. Si chacun veut se rendre attentif à lui-même, il pourra alors ramasser dans une vision intuitive l’ensemble de ces états et comprendra la direction prise par sa personnalité propre, éminemment singulière et nouvelle par rapport à une autre personnalité. Il s’agit bien de l’intuition de la durée à partir d’une donnée immédiate du sens commun, - c’est-à-dire commun à tout homme -, qui accepte cet effort volontaire. Intuition parce que saisie nécessairement synthétique et unitive ; un peu lorsque, parfois, soudain, après un effort de réflexion, nous comprenons, nous saisissons la direction dans laquelle aller pour résoudre un problème philosophique, apercevant par le fait même tous les aspects divers posés dans une analyse antécédente ; mais il a fallu cette analyse, et la synthèse intuitive permet l’unification de tous les points considérés antérieurement ; ou bien quand, parfois, à certaines heures, nous mesurons par une vue simple et unique, unitive plutôt, de tous nos états antérieurs, notre vie intérieure comme une continuité vivante qui a pris naissance dans un passé lointain mais où, aujourd’hui, malgré le temps écoulé, nous nous reconnaissons bien nous-mêmes, identique à ce que nous avons toujours été : nous nous reconnaissons et pourtant nous savons bien que nous n’aurions pu deviner, au moment où notre vie a commencé, où nous avons pris telle ou telle décision qui nous mettait dans telle ou telle direction, quel aurait pu être le résultat effectif de cette décision : le point d’aboutissement était imprévisible, et pourtant, malgré tout, nous savons que toute notre personnalité profonde transparaissait dans chacune des décisions pourtant imprévisibles, ou du moins relatives à des circonstances contingentes qui, autres, eût donné un autre résultat sans doute, mais toujours en relation avec notre cœur profond ; ou bien quand, voyant une personne pour la première fois nous saisissons, sans pouvoir encore mettre des mots précis, ce qu’elle est, les tourments qui peuvent l’habiter ou bien la simplicité profonde d’une personne unifiée et dont les actes coïncident avec la personnalité profonde que l’on peut deviner sous son maintien, son visage, sa manière de parler, de sourire, d’habiter son corps sans gêne ni rétractation particulière ; ou bien, écoutant une mélodie, nous nous laissons aller à son rythme et son intensité, à son unité, à ce qui émane d’elle et à l’émotion que nous ressentons qui peut toucher parfois des fibres spirituelles que nous ne soupçonnions pas quelques instants auparavant. Cette mélodie est unique en son genre, qualitative et continue et nous savons qu’elle ne pourra pas être répétée telle que nous l’avons éprouvée ; elle se joue en nous, nous la recevons et coïncidons avec elle comme avec un ami qui nous est ‘sympathique’, présent intérieurement à notre sensibilité, à notre esprit, à notre volonté. Et en tout ceci nous voyons l’intuition se distinguer de l’analyse puisqu’elle est :
[…] la sympathie52 par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un objet pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par conséquent d’inexprimable. Au contraire, l’analyse est l’opération qui ramène l’objet à des éléments déjà connus, c’est-à-dire communs à cet objet et à d’autres. Analyser consiste donc à exprimer une chose en fonction de ce qui n’est pas elle. Toute analyse est ainsi une traduction, un développement en symboles, une représentation prise de points de vue successifs, d’où l’on note autant de contacts entre l’objet nouveau, qu’on étudie, et d’autres, que l’on croit déjà connaître. Dans son désir éternellement inassouvi d’embrasser l’objet autour duquel elle est condamnée à tourner, l’analyse multiplie sans fin les points de vue pour compléter la représentation toujours incomplète, varie sans relâche les symboles pour parfaire la traduction toujours imparfaite. Elle se continue donc à l’infini. Mais l’intuition, si elle est possible, est un acte simple53.
Un texte de Bergson pourra nous faire comprendre combien la réalité effective de cette intuition est ‘intelligence’54 et peut d’ailleurs s’éduquer, se développer au point de devenir connaturelle à notre personnalité55 :
L’intelligence vraie est ce qui nous fait pénétrer à l’intérieur de ce que nous étudions, en toucher le fond, en aspirer à nous l’esprit et en sentir palpiter l’âme. Que ce soit l’intelligence de l’avocat ou celle du médecin, l’intelligence de l’industriel ou celle du commerçant, toujours l’intelligence est ce courant de sympathie qui s’établit entre l’homme et la chose, comme entre deux amis qui s’entendent à demi-mot et qui n’ont plus de secrets l’un pour l’autre. Voyez comme le critique le plus exercé devine les intentions cachées de l’auteur qu’il commente, comme l’historien sagace lit entre les lignes des documents qu’il compulse, comme le chimiste habile prévoit les réactions du corps qu’il manipule pour la première fois, comme le bon médecin devance les symptômes visibles de la maladie, comme le bon avocat comprend votre affaire mieux que vous ne la comprenez vous-même. Tous ces hommes manifestent, dans ces domaines différents, une même puissance de l’esprit, la puissance de s’accorder sur les choses, de les suivre dans leurs mouvements les plus subtils et de vibrer sympathiquement avec elles (c’est nous qui soulignons). Quelle est cette puissance ? […] ce n’est ni la science toute pure, ni le raisonnement tout seul, ni rien de ce qui s’apprend par cœur, ni rien de ce qui se met en formules. C’est une adaptation exacte de l’esprit à son objet, un ajustement parfait de l’attention, une certaine tension intérieure, qui nous donne au moment voulu la force nécessaire pour saisir promptement, étreindre vigoureusement, retenir durablement. Enfin, c’est, au sens propre, l’intelligence […] Or, cette adaptation parfaite de l’esprit aux objets dont il s’occupe, adaptation qui est l’intelligence même, l’observation nous montre qu’elle peut s’acquérir dans une large mesure. Elle s’acquiert par un effort de volonté. En dépit des apparences, elle n’est pas autre chose qu’une concentration de l’attention, une forme, par conséquent, de l’effort volontaire. Plus puissant est cet effort de concentration, plus profonde et plus complète l’intelligence […] La concentration, voilà, mes chers amis, tout le secret de la supériorité intellectuelle. Elle est ce qui distingue l’homme de l’animal, l’animal étant le grand distrait de la nature, toujours à la merci des impressions venues du dehors, toujours extérieur à lui-même, tandis que l’homme se recueille et se concentre. Elle est ce qui distingue l’homme éveillé et sensé de l’homme qui divague et de l’homme qui rêve, ceux-ci abandonnant leur esprit à toutes les idées qui le traversent, celui-là se ressaisissant constamment lui-même, ramenant sans cesse son attention sur les réalités de la vie […] Oui, nous arrêtons le plus souvent notre regard sur les qualités intellectuelles, parce qu’elles sont ce qui brille à la surface ; nous ne savons pas assez que la source profonde de toute énergie, même intellectuelle, est la volonté […] descendez au plus profond de vous-mêmes pour amener à la surface tout ce qu’il y a, que dis-je ? plus qu’il n’y a en vous. Sachez que votre volonté peut faire ce miracle. Exigez qu’elle l’accomplisse.
Nous pouvons ainsi sympathiser avec le réel, nous adapter à ce que nous recevons de lui pour être saisis par sa richesse, son mouvement propre, sa qualité continue, ce qu’il y a en lui d’essentiel, de substantiel. Car si nous durons, c’est que demeure en nous une direction unique que montre la multiplicité hétérogène de nos états de conscience : on ne pourrait pas parler de durée s’il n’y avait pas en nous une unité intérieure, une continuité d’états qui fait que nous demeurons nous-mêmes à travers chacun d’eux et que, cependant, nous changeons aussi, mais nous changeons en fonction de notre personnalité propre qui se retrouve toujours elle-même sous la diversité de ses états de conscience. De la même manière si les choses durent, c’est qu’elles ont-elles aussi une unité intérieure, une continuité de tendances et de direction où elles se retrouvent pleinement elles-mêmes. Elles durent, elles demeurent, elles sont en un mot, elles existent d’une existence unique mais continue dans leur identité à elle-même, malgré la diversité des états par lesquels elles sont passées, vont passer ou passent. Dans ces conditions, nous comprenons peut-être pourquoi ces données immédiates de la conscience peuvent être une introduction directe à la métaphysique, à la connaissance des choses telles qu’elles sont, telles qu’elles durent dans leur unité propre et singulière, qualitative et hétérogène. Il y a un lien entre les données immédiates de la conscience et la métaphysique, c’est-à-dire une connaissance de l’absolu, de la réalité telle qu’elle est en elle-même et non relative aux conditions de possibilité de la connaissance qui, comme des lunettes déformantes, transforment ou limitent la connaissance que nous pouvons avoir de celles-ci. En ce sens, les données immédiates de la conscience rétablissent la connaissance métaphysique mise à mal par Kant. Précisons davantage.
Bergson cherche, en effet, à atteindre la réalité dans ce qui la constitue essentiellement, dans ce qui fait « son essence », ce qui est proprement elle. Et tout son effort est de trouver le moyen qui permettra cette saisie. Cela signifie qu’il est possible pour l’intelligence de saisir l’intériorité des choses, ce qui constitue le propre essentiel de chacune d’elle. En ce sens le terme ‘absolu’ désigne d’abord le fait que chaque chose a ce qui lui est propre et que l’intelligence peut l’atteindre, à condition qu’elle utilise une autre voie que la voie de l’abstraction et du concept, ou de l’analyse quantitative par laquelle procède les sciences physico-mathématiques. Bergson reprochera à Kant, en effet, et avec lui à un certain ‘platonisme’ de la philosophie, d’avoir rendu la connaissance philosophique relative aux outils rationnels, d’avoir ainsi constitué des ‘systèmes’ philosophiques, donnant ainsi du réel un certain point de vue, surtout considéré à partir des certitudes données par un mode mathématique de raisonner :
Si la métaphysique prétend se constituer avec des concepts que nous possédions avant elle, si elle consiste dans un arrangement ingénieux d’idées préexistantes que nous utilisons comme des matériaux de construction pour un édifice, enfin si elle est autre chose que la constante dilatation de notre esprit, l’effort toujours renouvelé pour dépasser nos idées actuelles et peut-être aussi notre logique simple, il est trop évident qu’elle devient artificielle comme toutes les œuvres de pur entendement […] Qu’on lise de près la Critique de la raison pure, on verra que c’est cette espèce de mathématique universelle qui est pour Kant la science, et ce platonisme à peine remanié qui est pour lui la métaphysique. À vrai dire le rêve d’une mathématique universelle n’est déjà lui-même qu’une survivance du platonisme. La mathématique universelle c’est ce que devient le monde des Idées quand on suppose que l’Idée consiste dans une relation ou dans une loi, et non plus dans la chose. Kant a pris pour une réalité ce rêve de quelques philosophes modernes : bien plus, il a cru que toute connaissance scientifique n’était qu’un fragment détaché ou plutôt une pierre d’attente de la mathématique universelle. Dès lors la principale tâche de la Critique était de fonder cette mathématique, c’est-à-dire de déterminer ce que doit être l’intelligence et ce que doit être l’objet pour qu’une mathématique ininterrompue puisse les relier l’une à l’autre56.
Bergson le dit bien : il s’agit pour Kant de déterminer comment raisonne l’homme, quelles sont les relations qu’il peut établir entre ses différents outils rationnels pour que se constitue un ‘objet’ de connaissance tout relatif aux conditions de possibilité de la connaissance ; un peu comme un savant qui préparerait ses outils d’observation avant d’entrer dans son laboratoire ; il expérimenterait en fonction des possibilités que lui accordent ces outils ; il n’atteint pas, dans ces conditions, la réalité elle-même mais ce que nous en permet de connaître ses outils d’expérimentation qu’il a d’abord organisés, mis en relation les uns avec les autres. À ces outils d’expérimentation, il conviendrait d’ajouter d’ailleurs les lois formulées antérieurement, les outils mathématiques à travers lesquels ont été exprimées, cherchées, découvertes ces lois. Mais ce n’est pas atteindre la réalité pour elle-même, c’est en donner un point de vue relatif et à la nature des relations entre les outils rationnels et au mode mathématique de raisonner.
En revanche, nous atteignons l’absolu parce que nous pouvons atteindre ce qu’est chaque chose en elle-même, par cet effort de « coïncidence », de « sympathie » avec les choses dans ce qui constitue leur unicité essentielle, effort qui est l’intuition intellectuelle elle-même. Un texte important, qui utilise un exemple de l’activité artistique, toujours dans l’Introduction à la métaphysique explique ainsi ce sens du terme ‘absolu’ :
Soit un personnage de roman dont on me raconte les aventures. Le romancier pourra multiplier les traits de caractère, faire parler et agir son héros autant qu’il lui plaira : tout cela ne vaudra pas le sentiment simple et indivisible que j’éprouverais si je coïncidais un instant avec le personnage lui-même. Alors, comme de la source, me paraîtraient couler naturellement les actions, les gestes et les paroles. Ce ne seraient plus là les accidents s’ajoutant à l’idée que je me faisais du personnage, enrichissant toujours cette idée sans arriver à la compléter jamais. Le personnage me serait donné tout d’un coup dans son intégralité, et les mille incidents qui le manifestent, au lieu de s’ajouter à l’idée et de l’enrichir, me sembleraient au contraire alors se détacher d’elle, sans pourtant en épuiser ou en appauvrir l’essence. Tout ce qu’on me raconte de la personne me fournit autant de points de vue sur elle. Tous les traits qui me la décrivent, et qui ne peuvent me la faire connaître que par autant de comparaisons avec des personnes ou des choses que je connais déjà, sont des signes par lesquels on l’exprime plus ou moins symboliquement. Symboles et signes me placent au-dehors d’elle ; ils ne me livrent d’elle que ce qui lui est commun avec d’autres et ne lui appartient pas en propre. Mais ce qui est proprement elle, ce qui constitue son essence, ne saurait s’apercevoir du dehors, étant intérieur par définition, ni s’exprimer par des symboles, étant incommensurable avec tout autre chose. Description, histoire et analyse me laissent ici dans le relatif. Seule la coïncidence avec la personne même me donnerait l’absolu57.
L’absolu désigne donc bien pour Bergson ce qui constitue essentiellement ce qu’il y a de propre et d’unique à une réalité et que nous pouvons atteindre effectivement alors qu’une philosophie comme celle de Kant nous laisse dans le « relatif » puisque toute connaissance doit, pour lui, passer par des conditions de possibilité relative à tous les outils rationnels qu’il faut analyser avant de connaître. Dès lors que nous pouvons atteindre ce qui fait l’essentiel d’une réalité, ne sommes-nous pas déjà sur le chemin de la métaphysique, de la possibilité d’une connaissance de ce que sont les choses, en un mot, de la possibilité de la connaissance de l’être, indépendamment des conditions de possibilité de la connaissance qui en limite la portée ?
7. Le renouveau de la métaphysique ?
Nous savons, en effet, que, pour Kant, la connaissance est capable d’établir les lois des phénomènes mais non de connaître les noumènes, c’est-à-dire la réalité telle qu’elle est en elle-même indépendamment des conditions de possibilité de la connaissance. Nous connaissons à travers les formes a priori de la sensibilité que sont l’espace et le temps, mais ce ne peut être que connaissance des ‘phénomènes’, les réalités métaphysiques comme la liberté, la nature de l’âme ou l’existence de Dieu sont inconnaissables parce qu’elles sortent des cadres imposées par ces limites spatio-temporelles. En ce sens, nous ne savons pas si la liberté existe parce que celle-ci, pour exister, doit être inconditionnée et que nous ne pouvons avoir l’expérience d’une réalité inconditionnée, de par nos limites des conditions de connaissance et d’existence : pour être vraiment libre un acte, une décision doivent être inconditionnées, c’est-à-dire produites, pensées sans conditions antérieures, or cela n’est pas connaissable puisque tout ce qui existe ou tout ce qui est pensé l’est en fonction de conditions antérieures ; de la même manière, nous ne savons pas ce qu’est l’âme humaine ni si elle peut être immatérielle et, par là, immortelle, parce que le savoir serait sortir de ces limites de la connaissance que sont l’espace et le temps ; et il en est ainsi pour Dieu et la démonstration de son existence.
En revanche, pour Bergson, c’est à partir des données immédiates de la conscience que l’intelligence pourra, s’adaptant à toutes les nuances qualitatives du réel, saisir la réalité de la liberté, celle de l’âme et de son immatérialité comme de sa dépendance par rapport au corps, et arriver jusqu’à la Cause première, la plus vivante de tous les vivants dont elle est la créatrice. Les données immédiates de la conscience établissent la possibilité même de la liberté, à partir de la découverte de la durée qualitative et de sa différence d’avec le temps quantitatif, Matière et mémoire et L’énergie spirituelle, la dépendance de l’âme par rapport au corps , mais aussi l’immatérialité de l’âme, c’est-à-dire sa spiritualité et donc la possible survie de celle-ci après la mort, et L’évolution créatrice, s’interrogeant sur la nature du mouvement d’ensemble qui préside à l’évolution des êtres vivants pourra ouvrir l’intelligence sur la possibilité d’une Cause première extrinsèque à l’élan vital qui préside à tous les mouvements dans la nature et toutes les relations des êtres vivants les uns avec les autres58. Quant aux Deux sources de la morale et de la religion, prenant en compte la nature de l’expérience mystique le livre introduit à une morale ouverte par l’amour synthétisée dans la morale de l’Évangile. Il est révélateur que la dernière œuvre de Bergson soit La pensée et le mouvant, c’est-à-dire une œuvre qui récapitule tout ce qu’est pour Bergson la métaphysique contenant un certain nombre d’études déjà anciennes mais, pour lui, toujours actuelles ; en particulier sa conférence, Introduction à la métaphysique, qui représente comme le résumé synthétique de la métaphysique bergsonienne59 : si, d’une part, la liberté, la nature immatérielle et spirituelle de l’âme, sa relation avec le corps et, en particulier son indépendance avec lui, et si, d’autre part, l’existence de Dieu peuvent être connues, c’est que la métaphysique est possible.
Au fond, ce que Bergson découvre dès le début de sa carrière avec sa thèse principale, même si son but premier est la découverte de la durée intérieure, c’est que les données immédiates de la conscience ont par elles-mêmes une valeur métaphysique, à condition d’accepter un effort d’attention et de connaissance synthétique intuitive, c’est-à-dire une conversion de la volonté tout autant que de la raison pour se purifier des tendances naturelles de la raison humaine à l’abstraction, à la systématisation. Comme le souligne Jean Theau dans son livre La critique bergsonienne du concept60 :
Enfin Bergson a accordé, dès l’Essai, une valeur métaphysique à la connaissance intuitive de l’immédiat. De ce moment, en effet, nous le répétons à sa suite, il avait parfaitement aperçu que sa doctrine de la durée rompait la barrière établie par Kant, au moins dans le domaine de la conscience interne, entre le phénomène et l’être en soi. Si les phénomènes internes se pénètrent les uns les autres et forment avec la conscience un tout indissociable, si chacun d’eux constitue, non pas une certaine représentation que le moi se fait de son être, mais un accroissement réel et substantiel de cet être, il est sûr qu’en connaissant les phénomènes on connaît au moins en partie l’être du moi. Le « sens interne » ne nous donne plus seulement, qui bien que prise du dedans, demeure cependant tout entière extérieure à l’être en soi du moi ; il nous en fait pénétrer la substance. C’est pourquoi, au regard des Données immédiates, appréhender la qualité des états de conscience, ce n’est pas éprouver la façon dont se traduit en nous quelque manière d’être inconnaissable en soi, c’est saisir l’étoffe substantielle de ces états. Avoir conscience de la durée, ce n’est pas ressentir successivement des représentations séparées les unes des autres et séparées du moi « nouménal », mais saisir en sa source la genèse de ce que nous sommes et faisons. Se savoir libre, ce n’est pas se fier à un sentiment illusoire, ou postuler pour notre âme un attribut inaccessible à notre connaissance, mais voir du dedans, comme il est, un mode d’activité ou de causalité réellement donné dans l’expérience.
Dans ces conditions, l’affirmation de Raïssa Maritain dans Les grandes amitiés prend tout son sens :
Quelqu’un que je connais bien a écrit beaucoup plus tard que « l’homme est un animal qui se nourrit de transcendantaux. » Dans des termes différents Bergson nous assurait qu’une telle nourriture était à notre portée, que nous sommes capables de connaître vraiment le réel, que par l’intuition nous atteignons l’absolu. Et nous traduisions que nous pouvons vraiment, absolument, connaître ce qui est. Peu nous importait alors que ce fût par l’intuition qui transcende les concepts, ou par l’intelligence qui les forme ; l’important, l’essentiel, c’était le résultat possible : atteindre l’absolu. Par une critique merveilleusement pénétrante Bergson dissipait les préjugés antimétaphysiques du positivisme pseudo-scientifique, et rappelait l’esprit à sa fonction réelle, à son essentielle liberté.
Sa parole éloquente et précise nous tenait en suspens ; la distraction était impossible. Pas un instant notre attention ne se détournait, ne rompait le fil précieux du discours. Il en était comme pour la musique parfaitement belle : son authenticité, sa richesse profonde enchaîne l’esprit et ne lui permet pas de s’évader. S’il y a des défaillances dans l’attention passive de l’auditeur, il y en a aussi dans la nécessité du texte écouté… Et lorsque la pensée de Bergson atteignait un de ses sommets, comme le jour où il nous dit, faisant allusion à une parole de l’Apôtre (ce qu’alors j’ignorais) : « Dans l’absolu nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. », il créait en nous l’enthousiasme, et une reconnaissance joyeuse qui devait subsister à travers les années, à travers même de graves divergences philosophiques, et malgré les critiques nécessaires et non atténuées.
Bergson libérait l’esprit en le rappelant à l’intériorité où est sa vie véritable, aux profondeurs toutes qualitatives de la conscience, en s’élevant avec force et succès contre la tendance des philosophes de son temps à tout ramener – même le qualitatif, l’unique et l’incomparable – au nombre et à l’espace, aux quantités mesurables, superposables et réversibles selon l’extériorité et l’homogénéité des relations physico-mathématiques. Si un tel comportement intellectuel est légitime dans le domaine des sciences mathématiques et physiques, il est dans les autres, destructif de toute philosophie vraie. Bergson rendait à la philosophie son domaine en montrant que la science et les procédés qui sont les siens y sont inévitablement inapplicables, du fait même que la science cherche, aujourd’hui du moins, ses ultimes explications dans la quantité pure, dans l’homogène et le mesurable.
Il semblerait évident que si l’on parle avec Bergson de métaphysique, cela ne peut être exactement dans le même sens que la métaphysique aristotélicienne qui affirma l’être en tant qu’être comme objet de la métaphysique. Si la pensée parménidienne et, avec elle, les paradoxes de Zénon d’Elée qui l’appuient, représente l’ouverture de la métaphysique62, si celle-ci a pour objet l’être et si cet être s’oppose quelque peu au devenir, au mouvement, cette métaphysique entre alors dans la critique bergsonienne : elle surajoute un monde immobile, idéal au monde sensible matériel que représente l’ensemble ordonné de tous les êtres du cosmos ; elle nous sépare en conséquence du réel. Nous pourrions dire, dans ces conditions, que la métaphysique serait une science qui n’aurait pas besoin, à aucun moment de son développement, d’une physique ; une non-physique en quelque sorte qui n’aurait besoin pour exister et se développer que ces données immédiates de la conscience. Et par ‘physique’, il faut entendre bien évidemment toutes les sciences qui portent sur un objet naturel, comme la physique, la chimie, la biologie, l’anatomie, la physiologie, la paléontologie, la géologie, la géographie, la psychologie, la sociologie, etc. Or Bergson a justement voulu pour chacun de ses objets de recherche connaître le mieux possible ce que chacune des sciences pouvait avoir dit à son époque sur lui. D’où l’intérêt porté par Bergson aux sciences, non pas comme une curiosité extérieure mais comme des activités intellectuelles nécessaires pour développer le sens de l’expérience interne et externe.
Autrement dit, si métaphysique il y a chez Bergson, c’est bien une méta-physique dont il s’agit qui se nourrit des données immédiates de la conscience et des sciences. En ce sens, une métaphysique qui aurait pour objet l’être en tant qu’être sans s’appuyer sur ce que des sciences peuvent nous faire appréhender du réel serait pour Bergson une métaphysique suspecte, abstraite, séparée du réel, une métaphysique de l’immobile et de la forme, une métaphysique tronquée d’une partie importante d’elle-même. Dans un passage de La pensée et le mouvant, Bergson assigne à la science et à la philosophie deux rôles différents mais convergents nécessairement et devant finalement se répondre l’une l’autre : à la science l’étude de la matière et à la métaphysique celle de l’esprit ; comme il y a une relation nécessaire entre l’esprit et la matière, que ce soit dans l’homme lui-même ou dans l’ensemble du mouvement des êtres vivants, il est nécessaire que la métaphysique côtoie la science et puisse ainsi compléter le champ de leurs expérience respectives :
Pour tout résumer, nous voulons une différence de méthode, nous n’admettons pas une différence de valeur entre la métaphysique et la science. Moins modeste pour la science que ne l’ont été la plupart des savants, nous estimons qu’une science fondée sur l’expérience, telle que les modernes l’entendent, peut atteindre l’essence du réel. Sans doute elle n’embrasse qu’une partie de la réalité ; mais de cette partie, elle pourra un jour toucher le fond ; en tout cas s’en rapprochera indéfiniment. Elle remplit donc déjà une moitié du programme de l’ancienne métaphysique : métaphysique elle pourrait s’appeler, si elle ne préférait garder le nom de science. Reste l’autre moitié. Celle-ci nous paraît revenir de droit à une métaphysique qui part également de l’expérience, et qui est à même, elle aussi d’atteindre l’absolu : nous l’appellerions science, si la science ne préférait se limiter au reste de la réalité. La métaphysique n’est donc pas la supérieure de la science positive ; elle ne vient pas, après la science, considérer le même objet pour en obtenir une connaissance plus haute. Supposer entre elles ce rapport, selon l’habitude à peu près constante des philosophes, est faire du tort à l’une et l’autre : à la science que l’on condamne à la relativité ; à la métaphysique, qui ne sera plus qu’une connaissance hypothétique et vague, puisque la science aura nécessairement pris pour elle, par avance, tout ce qu’on peut savoir sur son objet de précis et de certain. Bien différente est la relation que nous établissons entre la science et la métaphysique. Nous croyons qu’elles sont ou qu’elles peuvent devenir, également précises et certaines. L’une et l’autre portent sur la réalité même. Mais chacune n’en retient que la moitié, de sorte qu’on pourrait voir en elle, à volonté, deux subdivisions de la science ou deux départements de la métaphysique, si elles ne marquaient des directions divergentes de l’activité de la pensée […] Laissez-leur, au contraire, des objets différents, à la science la matière et à la métaphysique l’esprit : Comme l’esprit et la matière se touchent, métaphysique et science vont pouvoir, tout le long de leur surface commune, s’éprouver l’une l’autre, en attendant que le contact devienne fécondation. Les résultats obtenus des deux côtés devront se rejoindre, puisque la matière rejoint l’esprit63.
Dans un autre passage qui termine son Introduction à la métaphysique, il indique combien l’effort pour coïncider par sympathie avec ce qu’il y a de plus intérieur et de plus vrai dans le réel doit se nourrir d’une longue fréquentation des sciences :
Car on n’obtient pas de la réalité une intuition, c’est-à-dire une sympathie spirituelle avec ce qu’elle a de plus intérieur, si l’on n’a pas gagné sa confiance par une longue camaraderie avec ses manifestations superficielles. Et il ne s’agit pas simplement de s’assimiler les faits marquants ; il faut en accumuler et fondre ensemble une si énorme masse qu’on soit assuré, dans cette fusion, de neutraliser les unes par les autres toutes les idées préconçues et prématurées que les observateurs ont pu déposer, à leur insu, au fond de leurs observations. Ainsi seulement se dégage la matérialité brute des faits connus. Même dans le cas simple et privilégiée qui nous a servi d’exemple, même pour le contact du moi avec le moi, l’effort définitif d’intuition distincte serait impossible à qui n’aurait réuni et confronté ensemble un très grand nombre d’analyses psychologiques. Les maîtres de la philosophie moderne ont été des hommes qui s’étaient assimilé tout le matériel scientifique de leur temps. Et l’éclipse partielle de la métaphysique depuis un demi-siècle a surtout pour cause l’extraordinaire difficulté que la philosophie éprouve aujourd’hui à prendre contact avec une science devenue beaucoup plus éparpillée64.
À l’intérieur même des sciences, Bergson s’évertue à privilégier les sciences biologiques, psychologiques et sociologiques sur les sciences plus ‘classiques’ et davantage marquées par les mathématiques comme dans la physico-mathématique galiléenne et newtonienne, et ceci pour séparer l’intelligence d’un cadre trop mathématique et l’amener à la connaissance de réalités plus proches de la vie. C’est bien le sens de cette affirmation suivante :
Travaillons donc à serrer l’expérience d’aussi près que nous pourrons. Acceptons la science avec sa complexité actuelle, et recommençons, avec cette nouvelle science pour matière, un effort analogue à celui que tentèrent les anciens métaphysiciens sur une science plus simple. Il faut rompre les cadres mathématiques, tenir compte des sciences biologiques, psychologiques, sociologiques et sur cette plus large base, édifier une métaphysique capable de monter de plus en plus haut par l’effort continu, progressif, organisé, de tous les philosophes associés dans le même respect de l’expérience65.
L’effort bergsonien pour rencontrer les sciences, les connaître - et philosopher avec elles, en elles et pour elles -, indique que celles-ci complètent ces données immédiates et rendent possible l’atteinte plus distincte de cet absolu que la métaphysique recherche. On peut, par exemple, pressentir, par une expérience interne, l’existence de l’esprit comme indépendant de la matière, mais Bergson désire davantage que ce ‘pressentiment’ intuitif : il utilise les données physiologiques sur l’aphasie dans Matière et mémoire pour indiquer le rôle du corps dans la mémoire (ou dans l’oubli…) et la nature de son indépendance par rapport au corps. On peut pressentir de la même manière l’existence de la liberté, par une expérience interne, en la saisissant dans certains moments intérieurs pendant lesquels elle peut nous apparaître soudain à la conscience, mais Bergson rend beaucoup plus distinct ce pressentiment intuitif par la critique du déterminisme mécanique de son époque. En ce sens, l’analyse scientifique vient ‘actualiser’, rendre plus distincte une intuition de départ nécessairement ‘confuse’, c’est-à-dire, au sens aristotélicien et thomasien du terme, très en puissance par rapport à des connaissances antérieures beaucoup plus distinctes, plus ‘actualisées’ si l’on veut. Il conviendrait donc alors de distinguer une intuition confuse sur la nature de l’objet d’une recherche qui peut donner néanmoins une direction vers laquelle la recherche peut aller et une intuition beaucoup plus distincte, résultat de ce que peut produire l’analyse scientifique. Léon Husson, dans son livre, L’intellectualisme de Bergson, écrit en effet :
Une exégèse serrée devra donc distinguer, bien que l’exposé de la méthode oblige à passer sans cesse de l’une à l’autre sans que le style, sous peine de s’alourdir énormément au point d’en devenir obscur, puisse souligner chacun de ses passages, l’intuition confuse, qui est au fond de notre connaissance spontanée, de l’intuition distincte, parfois qualifiée en raison de sa fonction métaphysique, qui est au terme de la recherche philosophique, la méthode n’étant que l’ensemble des procédés par lesquels le philosophe s’élève lui-même, et tente d’aider les autres à s’élever à leur tour, jusqu’à la seconde en s’appuyant sur la première. Pour saisir l’unité de ces sens, il suffira de considérer l’intuition comme une fonction de l’esprit, dont ils désignent les actes successifs aux divers stades de son développement66.
Dans ces conditions, ne peut-il y avoir convergence entre le projet bergsonien et le projet aristotélicien, d’abord parce que la saisie de l’être en tant qu’être qui définit pour Aristote cette « philosophie première » qu’il recherche est in séparable d’une philosophie de la nature qui étudie tous les mouvements de la nature. Et celle-ci est également inséparable du recours à l’ expérience commune, c’est-à-dire ces connaissances communes accessibles par notre connaissance sensible ; elles sont ce qui est premier quoad nos, ce que nous pouvons dire de plus premier, de plus commun sur la nature. Ce sera par exemple, dans les Physiques d’Aristote les analyses du livre I et II sur les principes absolument premiers du devenir, comme la matière la forme et la privation et sur la question du hasard et de la finalité ; ou encore dans le livre III les analyses qui conduisent à la définition du mouvement ou dans le livre IV à celles du temps. D’ailleurs, le terme même de durée, en effet, n’indique-t-il pas que nous sommes dans une philosophie de la nature qui saisit ce qu’il y a de premier quant à notre expérience et que chacun d’entre nous peut saisir sans les instruments de mesure du laboratoire ou les hypothèses antérieures des théories précédentes. Philosophie de la nature de la conscience et de l’esprit analysée dans Les données immédiates de la conscience, philosophie de la nature de l’âme et de ses relations avec l’esprit recherchée dans Matière et mémoire, philosophie de la nature du mouvement d’ensemble de la vie, responsable de l’évolution des vivants, dans L’évolution créatrice. Nous ajouterions à cette philosophie de la nature une philosophie morale et politique qui se fonde sur cette philosophie de la nature de l’ensemble des êtres vivants dans Les deux sources de la morale et de la religion.
Mais nous pourrions dire que si nous sommes justement dans une philosophie de la nature, celle du mouvement, de la durée, Bergson ne veut pas en rester là et voulut accéder à une philosophie de l’être proprement dite, c’est-à-dire à une ‘authentique’ métaphysique : c’est, en tout cas, ce que Bergson a voulu concevoir.
En lisant attentivement ce livre si important de Jacques Chevalier Entretiens avec Bergson, on note un entretien du 3 juin 1907 qui portait sur L’Évolution créatrice. Nous assistons comme en direct, à la recherche de Bergson. Et la considération de l’être n’y est pas absente. Jugeons plutôt :
Alors le contact de nos esprits s’établit, sans mot, par la seule durée de l’entretien, par la sympathie qui s’installe entre nous – au-dessus de nous. Maintenant, le visage du philosophe rayonne, et traduit une sorte de gaieté de l’âme, bien qu’il se tienne, à présent, de côté, les yeux clos par intervalles. Pour moi, je ne sais : mais je lui parle avec une force de persuasion indicible, dont je suis surpris moi-même ; et parfois, un auditeur, qu’un voile empêcherait de nous voir, me prendrait pour le plus âgé ; pourtant, je n’ai nulle honte, et, pour lui comme pour moi, il n’y a rien là de ridicule : rien que cette sympathie qui existe entre lui et moi. Nous parlons de Dieu. « Si je puis, lui dis-je, concevoir Dieu, c’est ainsi : une Personne complète, mais créatrice. Mais qui, créant, ne se fait pas…C’est, pour moi, la solution du problème qui se pose à toute une masse d’esprits, même les plus simples : je veux dire le problème du mal… Dieu étant, il y a comme un écoulement qui se fait. – je n’ai pas nommé, dans mon livre, le mal : mais c’est cette idée même qui a inspiré tout mon chapitre III : le mal, suite nécessaire de cette évolution à double mouvement, montée-descente. – pourtant lui dis-je, il y a aussi de l’immobile. – Je ne sais, réplique Bergson : je ne puis séparer l’être de la durée ; j’ai été jusqu’ici amené à voir plutôt l’aspect durée comme essentiel à l’être. (C’est nous qui soulignons) – (Moi) Il me semble qu’on saisirait cela dans l’intuition : car l’intuition est un intemporel qui, pour vous, est bien la forme supérieure de l’appréhension de l’être ? – (Lui). Assurément. C’est l’instinct post-intellectuel, saisissant la matière comme fait l’intelligence, mais supérieure à l’intelligence. Seulement, cet instinct est, chez nous, instable et transitoire67.
Dans L’évolution créatrice, il dira bien la capacité de l’esprit à atteindre l’être des choses quand la science et la philosophie unissent leurs efforts – et tout spécialement la métaphysique – pour comprendre, saisir la direction du mouvement de la vie en ne se limitant pas à traiter le vivant selon les mêmes méthodes utilisées pour analyser la matière inerte :
C’est l’être même, dans ses profondeurs que nous atteignons par le développement combiné et progressif de la science et de la philosophie68.
La durée est hétérogène, qualitative, indivisible et créatrice. Nul doute qu’il ne s’agisse de notre durée intérieure, celle de la continuité de nos états intérieurs qui se compénètrent les uns dans les autres à tout moment, chaque état étant nouveau par rapport à d’autres états puisqu’il est fort de ce qui l’a précédé et riche de ce vers quoi il va. Ces propriétés de notre durée intérieure, nous les retrouvons dans la durée propre du monde vivant animé par cet « élan vital » qui crée des formes nouvelles, tout en donnant une direction d’ensemble à ce mouvement de la vie. Nous pouvons sans doute, à l’image de notre durée intérieure, voir l’ensemble de la durée des êtres vivants comme animé par un élan créateur de formes imprévisibles et cependant allant vers de plus en plus de conscience, de plus en plus de liberté, comme, par exemple, le monde animal, plus ‘libre’ que le monde végétal, les êtres humains eux-mêmes plus ‘libres’ que les animaux. Dans l’expérience mystique nous retrouverons aussi les propriétés de cette durée : qualitative, imprévisible, hétérogène et créatrice, active donc, dense d’une énergie vitale puisée à la Source vive de Dieu qui est Amour : saint Jean de la Croix, sainte Thérèse d’Avila étaient imprévisibles, car qui aurait pu prévoir qu’ils deviendraient, à un moment de leur histoire et de l’histoire de leur époque, ce qu’ils sont devenus ? Ils ont créés, chacun selon leur personnalité propre, un courant de vie qui a influencé non seulement l’institution ecclésiale, mais leur société civile, leur nation ; ils ont eu aussi un rayonnement mondial objectivement observable69.
Nous pourrions aussi regarder ces mêmes propriétés dans l’activité artistique et nous aurions la même vision de la durée d’une œuvre d’art : imprévisible, hétérogène par rapport à d’autres œuvres d’art, qualitative et créatrice, dense aussi d’un rayonnement d’être et d’actes70. Autrement dit, nous tenons des propriétés présentes dans des expériences en elles-mêmes différentes. L’être des choses ne se révèle-t-il pas à nous, par la saisie de ces ressemblances des propriétés de la durée ? C’est pourquoi avait-il affirmé, quelques lignes plus haut dans le texte précédent, reprenant la citation de saint Paul (Act. 17, 28) :
Dans l’absolu nous sommes, nous circulons et nous vivons.
Seulement, il y a dans cette allusion implicite à saint Paul et par cette affirmation d’une saisie de l’absolu, sans doute beaucoup plus que l’affirmation de la métaphysique. Ou du moins ne nous permet-il pas de comprendre, par cette phrase si paulinienne d’accent, que l’esprit humain est capable d’atteindre Dieu et que cet absolu désigne pas uniquement la capacité d’atteindre l’être des choses telle qu’elles sont comme le dit le début de L’introduction à la métaphysique, mais d’atteindre Dieu Lui-même, par la « coïncidence », par la « sympathie », en définitive, par l’amour et l’union à Lui. Après tout, n’est-ce pas le sens de l’expérience mystique, de l’intuition énergique et créatrice des mystiques vers qui il a été tant attiré, que d’aboutir à Celui qui est source de l’élan vital. En ce sens, Bergson atteint par cette voie le terme vers lequel peut conduire la connaissance métaphysique.
On pourrait aussi souligner pour insister sur cet esprit résolument métaphysique, que dans La pensée et le mouvant, Bergson parle de la ‘substantialité’ du moi comme étant l’équivalent de la durée :
Il s’agissait de ressaisir la vie intérieure, au-dessous de la juxtaposition que nous effectuons de nos états dans un temps spatialisé. L’expérience était à la portée de tous : et ceux qui voulurent bien la faire n’eurent pas de peine à se représenter la substantialité du moi comme sa durée même71.
C’est pourquoi :
Notre vie entière, depuis le premier éveil de notre conscience, est quelque chose comme ce discours indéfiniment prolongé. Sa durée est substantielle, indivisible en tant que durée pure72.
C’est pourquoi encore, Bergson n’écarte nullement la substance73, comme si cette durée signifiait une universelle mobilité, où rien de stable ne peut demeurer. Il précisera, déjà, dans une note de l’Introduction à la métaphysique :
Encore une fois, nous n’écartons nullement par là la substance. Nous affirmons au contraire la persistance des existences. Et nous croyons en avoir facilité la représentation. Comment a-t-on pu comparer cette doctrine à celle d’Héraclite ?
Ajoutons que dans la Pensée et le mouvant, Bergson analysant ce que sont les idées générales, en indiquera trois sortes, d’abord les généralités automatiques utiles et nécessaires à la vie, qui viennent de la satisfaction des besoins et nécessitent de classer, distinguer, pour satisfaire un instinct, ensuite, celles que la société prépare dans le langage pour les commodités des relations sociales, enfin celles qui sont fondées sur la perception des ressemblances, les ressemblances proprement dites dans les organes et les fonctions observées chez les êtres vivants, et l’identité dans celui de la matière inerte (« l’identité est du géométrique et la ressemblance du biologique74). En d’autres termes, la réalité même du vivant rend possible que l’on puisse établir des ressemblances entre les organes, les fonctions dont se compose chaque être vivant, c’est sur elle que se trouvent fondées les subdivisions en genres, espèces, sous-espèces, etc. ; il affirmera concernant ces ressemblances :
Les premières sont d’essence biologique : elles tiennent à ce que la vie travaille comme si elle avait elle-même des plans de structure en nombre limité, comme si elle avait institué des propriétés générales de la vie, enfin et surtout comme si elle avait voulu, par le double effet de la transmission héréditaire plus ou moins lente, disposer les vivants en série hiérarchique, le long d’une échelle où les ressemblances entre individus sont de plus en plus nombreuses à mesure qu’on s’élève plus haut75.
Dans le premier tome de son livre Bergson, Henri Hude cite un texte important d’un cours de Bergson (Cours de psychologie à Clermont, mss. p. 27) ; celui-ci souligne que Bergson n’est pas un adversaire du concept et de l’abstraction ; ce qui est souligner que Bergson ne répudie en aucune façon la différences des ‘facultés’ qui auraient, de ce fait, chacune un objet spécifique, mais qui, toutes sont, dans la réalité même de notre vie, unies et en relation permanente les unes avec les autres, de sorte qu’elles durent ensemble et constituent ainsi, au fur et à mesure du déroulement de notre histoire, notre personnalité :
Beaucoup ont reproché à la philosophie de scinder l’âme humaine, de la diviser en compartiments, de la couper en trois tronçons : sensibilité, intelligence et volonté. Une pareille objection ne peut être élevée que par des personnes étrangères aux études philosophiques.
En effet, à la rigueur, on pourrait considérer les facultés de l’âme comme n’en étant que des catégories. On donnerait le nom de sensibilité, par exemple, à l’ensemble des faits sensibles, de volonté à l’ensemble des déterminations volontaires et d’intelligence à l’ensemble des faits intellectuels. Beaucoup de psychologues et en particulier les empiriques ne donnent pas d’autre sens au mot faculté : c’est un terme commode pour désigner une catégorie de faits psychologiques.
Néanmoins nous irons plus loin qu’eux et pour notre part, nous voyons dans le terme faculté autre chose encore que cela : une faculté est une puissance ou énergie de l’âme, une capacité d’engendrer ou de subir certaines choses. La sensibilité, l’intelligence, la volonté sont respectivement des puissances de sentir, de penser et de vouloir.
Faculté signifie précisément pouvoir de faire. C’est que l’âme est une force sans doute, mais une force capable de rayonner dans une infinité de directions. On peut considérer tour à tour les directions principales et leur donner des noms : on obtient ainsi des facultés. Ce n’est pas diviser l’âme que de distinguer trois facultés en elle. Elle est toute entière sensibilité, toute entière intelligence, toute entière volonté selon le point de vue76.
S’il en est ainsi, si chaque faculté a sa manière propre d’exister, si, reliée avec les autres, elle peut constituer comme les sources énergétiques qui permettent à une personnalité d’exister, de s’unifier, de s’accomplir tout au long de son histoire personnelle, bref, si chacun de nous, nous avons une personnalité qui peut émerger de cette totalité unifiante qu’elle veut être et qu’elle peut être grâce à ses facultés, cela ne signifie-t-il pas qu’il y a comme une intention dans la nature, une direction vers lequel semble tendre l’élan vital ? La nature n’est donc pas aveugle, absolument fantaisiste ou complétement imprévisible, procédant par le pur et seul hasard ; il y a ainsi de l’intelligence dans la nature.
Plus même, il affirmera, comme une partie de sa conclusion sur la question religieuse étudiée dans Les deux sources que les mystiques donnent à l’évolution du vivant tout son sens, sa signification, sa raison d’être, c’est-à-dire, au fond, sa finalité :
Distincts de Dieu, qui est cette énergie même, ils ne pouvaient surgir que dans un univers, et c’est pourquoi l’univers a surgi. Dans la portion d’univers qu’est notre planète, probablement dans notre système planétaire tout entier, de tels êtres, pour se produire, ont dû constituer une espèce, et cette espèce en nécessité une foules d’autres, qui en furent la préparation, le soutien ou le déchet : ailleurs il n’y a peut-être que des individus radicalement distincts, à supposer qu’ils soient encore mortels ; peut-être aussi ont-ils été réalisés alors d’un seul coup, et pleinement. Sur la terre, en, tout cas, l’espèce qui est la raison d’être de toutes les autres n’est que partiellement elle-même (c’est nous qui soulignons) Elle ne penserait même pas à le devenir tout à fait si certains de ses représentants n’avaient réussi, par un effort individuel, qui s’est surajouté au travail général de la vie, à briser la résistance qu’opposait l’instrument, à triompher de la matérialité, enfin à retrouver Dieu. Ces hommes sont les mystiques. Ils ont ouvert une voie où d’autres hommes pourront marcher. Ils ont par là même, indiqué au philosophe d’où venait et où allait la vie77.
Dans l’Introduction à la métaphysique il parlait aussi de « degrés d’être »… :
[…] l’intuition dont nous parlons n’est pas un acte unique, mais une série indéfinie d’actes, tous du même genre sans doute, mais chacun d’espèce très particulière, et comment cette diversité d’actes correspond à tous les degrés d’être78.
Ce dernier texte est d’ailleurs très important. Il semble dire que les intuitions sont différentes selon les degrés d’être qu’elles saisissent. Et effectivement, Bergson sait bien la différence entre l’homme et l’animal79, entre les végétaux et la vie animale ; il sait très bien ce qu’est une intuition mathématique ou une intuition qui saisit quelque chose du vivant, quand il saisit, par exemple, la différence entre le géométrique et le vital dans la matière inerte et la matière vivante ; ou même une intuition artistique comme dans la musique80 ou la peinture. Il sait bien aussi ce que peut être une intuition ‘technique’ qui aurait comme but une utilité pratique comme, par exemple, dans la création d’outils, ou même une intuition dans l’ordre de la connaissance pour synthétiser une multiplicité de faits recueillis par l’expérimentation scientifique81, dans la traduction de textes de la littérature ‘classique’ qui forme une partie de l’enseignement ‘classique’ qu’il a défendu82 ; on pourrait dire aussi que sachant ce qu’est monter à cheval, il sait ce que peut être une ‘intuition’ dans ce domaine83. Ajoutons à cette énumération, l’expérience acquise dans la vie diplomatique ou dans la Présidence d’un ‘conseil’ culturel international : et là aussi l’intuition est requise comme l’expérience peut l’affiner ; ou bien son intuition psychologique pour la connaissance des hommes qu’il avait très précise et très lucide84 ; tout ceci finissant aussi par l’intuition des mystiques dans l’expérience religieuse, principalement celle des mystiques chrétiens.
Nous pensons qu’il y a chez Bergson un désir résolu de rendre possible une métaphysique et une vraie métaphysique qui soit un chemin vers une connaissance de l’être tel qu’il est, en soi.
En effet, on peut alors, si l’on voit comme en synthèse cette philosophie de la nature et cette philosophie morale, politique et religieuse, parler véritablement de métaphysique esquissée dans La pensée et le mouvant ; de sorte que c’est avec toute l’expérience assimilée, analysée dans les livres antécédents qu’il faudrait lire ce dernier livre et en particulier la conférence Introduction à la métaphysique. Bergson connaît Aristote, il l’a enseigné, en particulier dans un cours de Khâgne au lycée Henri IV ; il sait bien qu’Aristote distingue dès le début des Physiques, les choses qui sont les premières en soi et celles qui sont premières par rapport à nous ; et il sait aussi, de ce fait, que la métaphysique est dernière par rapport à nous, et que si elle est dernière, elle a besoin des sciences pour commencer à entrer dans la connaissance du réel85.
Autrement dit, on ne peut séparer dans l’œuvre de Bergson les sciences qui étudient les mouvements dans la nature de la métaphysique elle-même. Celle-ci a nécessairement besoin de celles-là pour exister vraiment et être autre chose qu’un discours abstrait. Sans les sciences, on encourrait le reproche tout à fait justifié de parler de la durée comme d’un terme abstrait, sans aucun contenu réaliste, sans aucune chair pourrait-on dire. De sorte que le projet ‘encyclopédique’ d’Aristote qui est d’intégrer, dans ses traités de science naturelle, la connaissance de tous les mouvements dans la nature convergerait aussi, toute proportion gardée et en tenant compte des différences des sciences entre l’époque des grecs et les sciences modernes, aussi avec celui de Bergson86 ; de la même manière que serait aussi aristotélicien le fait d’envisager la métaphysique comme possible à partir des données de l’expérience, de ces vérités sur les choses recueillies par toutes les connaissances premières par rapport à nous auxquelles se destinent les sciences expérimentales de la nature. D’une certaine manière celles-ci sont pour Bergson les connaissances qui nous donnent les faits premiers nécessaires à connaître sur lesquels on peut ensuite s’interroger afin d’en déterminer quelques caractéristiques principales. Ou du moins il pourrait y avoir là encore une convergence entre la philosophie bergsonienne et la direction générale de la philosophie aristotélicienne. Il est d’ailleurs aussi possible qu’il s’agisse aussi de la philosophie grecque en elle-même que Bergson connaissait bien et appréciait fortement.
Avec Platon comme avec Aristote n’y a-t ’il pas dans cette philosophie un mouvement vers la mise en ordre de l’ensemble du savoir dans une analyse des différentes sciences à connaître, et une vision synthétique sur ce qu’il y a de plus essentiel à voir pour connaître la vérité des êtres ? Dans sa brochure écrite après la mort de Bergson, le P. Sertillanges rapporte un propos de celui-ci qui est l’aveu d’une préférence :
J’avoue que Plotin est de tous les philosophes anciens celui qui est le plus apparenté à ma façon de sentir. Je me le reproche parfois comme une faiblesse et une injustice, car Aristote, par exemple, est tellement plus fort ! Quant à Platon, je vous l’ai dit, je l’adore !
- Il ne faut adorer que Dieu (sourire.)87.
Il ne s’agit pas d’annexer Bergson à Aristote ou à saint Thomas ou à un autre philosophe d’ailleurs. Il est néanmoins possible de noter les convergences, les points de rencontre possibles tout en notant aussi ce qui fait l’originalité de notre auteur pour recevoir de lui ce qu’il peut nous enseigner et la manière dont il regarde le monde.
Pour notre auteur, il s’agit bien de penser les choses sub specie durationis, selon l’expression de la fin des conférences prononcées à l’Université d’Oxford le 26 et 27 mai 1911, La perception du changement comme celle rencontrée plus haut qui termine son texte sur L’intuition philosophique, qui est une conférence au Congrès de philosophie de Bologne. Mais si l’on ne veut pas apporter un nouveau concept vide, formel et abstrait il faut l’habiter grâce à toutes les expériences transmises dans les sciences et leurs réflexions sur elles.
Cette durée est donc bien un terme métaphysique qui tend à désigner l’essentiel de ce qui anime les réalités. Il n’est pas porteur d’un héraclitéisme sous-jacent comme s’il désignait une réalité perpétuellement en devenir. Ce qui est ‘durable’ est ce qui demeure, mais non pas à la manière d’une réalité immuable ou immobile ; à la manière d’une densité de vie, d’une énergie vitale créatrice de vie renouvelante, dépassant ainsi tous les obstacles ou toutes les répétitions systématiques, homogènes, identiques, sans nouveauté. Si cette durée est créatrice, c’est qu’elle est acte, action diffusante au-delà d’elle-même au point qu’arrivant vers les êtres les plus conscients, les plus ‘personnels’ et donc les plus intérieurs, nous arriverions vers une action de plus en plus créatrice et de plus en plus libre, de plus en plus vivante parce que libre et de plus en plus personnelle aussi, de sorte que, comme l’écrit Bergson :
Plus, en effet, nous nous habituons à penser et à percevoir toutes choses sub specie durationis, plus nous nous enfonçons dans la durée réelle. Et plus nous nous y enfonçons, plus nous nous replaçons dans la direction du principe, pourtant transcendant, dont nous participons et dont l’éternité ne doit pas être une éternité d’immutabilité, mais une éternité de vie : comment, autrement, pourrions-nous vivre et nous mouvoir en elle ? In ea vivimus et movetur et sumus88.
En ce sens, c’est vers l’Être le plus personnel de tous les êtres, le plus action aussi et le plus Créateur de ce fait, le plus diffusif de soi et le plus libre que nous allons. Ce Dieu transcendant, principe de l’Élan vital à qui aboutit en définitive L’Évolution créatrice - si ce qu’écrivait Bergson en 1912, au P. de Tonquédec et que nous citons plus haut - est exact…, est le Principe absolument transcendant au mouvement même de cette Évolution, et lui donne sa direction générale et sa signification authentique. En 1907, dans l’Évolution créatrice lui-même n’avait-il pas évoqué au troisième chapitre, de la signification de la vie, l’existence de Dieu, à cause même de cette universelle réalité présente partout que sont des actions qui s’accomplissent, et donc des êtres qui naissent, vivent, se développent et se transforment, des tendances qui s’accomplissent à travers d’autres réalités, d’autres êtres qui se défont, stagnent et s’immobilisent ?
Si partout, c’est la même espèce d’action qui s’accomplit, soit qu’elle se défasse soit qu’elle tente de se refaire, j’exprime simplement cette similitude probable quand je parle d’un centre d’où les mondes jailliraient comme les fusées d’un immense bouquet – pourvu toute fois que je ne donne pas ce centre pour une chose, mais pour une continuité de jaillissement. Dieu, ainsi défini, n’a rien de tout fait ; il est vie incessante, action, liberté. La création, ainsi conçue, n’est pas un mystère, nous l’expérimentons en nous dès que nous agissons librement89.
Dans ces conditions, nous sommes vraiment dans une métaphysique de la durée, une métaphysique qui approche d’une manière explicite de l’existence du Principe transcendant à tous les êtres de la nature, qui explique leur durée propre, le sens de leur élan vital, celui de chaque être, centre d’action diffusant et créateur d’autres formes, celui de l’ensemble des êtres vivants et des diverses espèces observées dans l’évolution de la vie et des vivants.
Notre conscience ainsi dure, elle est en mouvement certes, mais elle est aussi, sous un certain rapport, stable ; trésor stable mais qui émerge pour se continuer dans un présent qui peut être nouveau parce que essentiellement qualitatif, riche de tous les états, de tous les progrès rencontrés tout au long de son histoire et conservés dans la mémoire. Elle a de ce fait une nature unique, personnelle, indéfinissable parce qu’elle n’est absolument identique à aucune autre personnalité. Mais la saisie de cette unicité de notre personnalité s’enrichit aussi de la concentration, de l’attention à la vie, d’une attention à tous les vivants, en eux-mêmes et dans leur permanente relation les uns avec les autres de telle manière que l’on puisse saisir aussi cette durée dans le mouvement d’ensemble de l’histoire de la vie ; comme elle s’enrichit d’une attention aux diverses morales qui permettent à ces personnalités de se réaliser, de créer du nouveau, changeant ainsi l’histoire des hommes, ou au contraire de répéter, et de clore un courant de vie.
Cette métaphysique, dans ces conditions, ne peut-elle déboucher sur un sentiment de profonde admiration et de joie spirituelle, celle qui jaillit quand on s’émerveille de la beauté d’un être vivant qui, à travers les divers états par lesquels il peut passer, acquiert son être propre et dure ainsi dans son unité individuelle et – pour l’être humain – spirituel,?
Et n’est-elle pas, finalement, malgré ce que pouvait penser Bergson d’Aristote90, parente de l’inspiration aristotélicienne, ou du moins ne peut-elle converger avec elle ? De la même manière que dans l’habitude aristotélicienne, il faut s’habituer à penser contemporaines les unes des autres les sciences de la nature et la philosophie première (puisque les trois sciences spéculatives sont les sciences mathématiques, les sciences de la nature et la philosophie première à la fois distinguées dans leurs objets propres et unies dans leur démarche91), de la même manière chez Bergson, on ne pourrait nullement concevoir la métaphysique de la durée sans l’analyse scientifique des diverses durées auxquelles il s’est intéressé parallèlement à l’expérience commune de la vie intérieure par les ‘données immédiates de la conscience’. Pour Aristote, la philosophie première ne demande-t-elle pas aussi à la philosophie de la nature – celle de tous les traités aristotéliciens sur les êtres en mouvement -, à la philosophie morale et politique – les deux Éthiques et la Politique – le réalisme de leurs analyses et de leurs expériences méditées, assimilées ? Et cette métaphysique aristotélicienne ne débouche-t-elle pas sur l’Idée d’une Cause finale séparée, comme l’Évolution créatrice pourrait déboucher sur la Cause qui donne à la vie sa direction essentielle, que l’on nomme Dieu92 ? Ne se réalise-t-elle pas par un acte contemplatif de la vérité et de la bonté des êtres du cosmos favorisant le développement de ce qui, dans l’intelligence humaine, est la part la plus ‘divine’, un peu comme Bergson finissant ses œuvres par Les deux sources… c’est-à-dire par l’affirmation de Dieu présent dans la morale de l’Évangile.
Mais il y a aussi le choix des sciences. L’inspiration platonicienne penche plutôt vers les sciences mathématiques, plus ‘formelles’, l’inspiration aristotélicienne davantage vers les sciences biologiques, et psychologiques, plus ‘réalistes’ laissant à l’observation, à l’induction, aux classifications aussi une part plus grande, voire décisive. Bergson choisit la psychologie, la biologie et la sociologie après qu’il eut étudié les mathématiques et la physico-mathématique. En cela, n’est-ce pas aristotélicien ? Cela ne veut nullement dire que Bergson est aristotélicien de conviction puisque sa critique du concept et de la connaissance abstraite, de l’intellectualisme en un mot, semble s’adresser tout autant à Aristote qu’à Platon93. Cela signifie que les sciences biologiques, psychologiques et sociologiques l’amenaient sur un terrain beaucoup plus « réaliste » que formel. Aux idéalités mathématiques que pourtant il connaissait mieux que personne, il préfère s’intéresser aux vivants, à l’homme, à l’esprit, à la personne, à ses dispositions sociales, morales, religieuses. C’est donc plutôt vers ‘l’aristotélisme’ que sa pensée peut nous conduire, l’aristotélisme de l’induction, de l’observation des êtres vivants et de la connaissance des caractéristiques morales et politiques de l’homme.
Dans ces conditions, il n’est pas impossible que cette métaphysique de la durée donne à une métaphysique de l’être une dimension vraiment réaliste parce que riche de toute l’expérience des différents types de durées dans le monde et d’abord celles que la science nous permet d’analyser. Cette sympathie pour chaque durée que demande Bergson ne procède-t-elle pas d’un amour réel de la vie ? En tout cas, elle peut contribuer à nous attacher à la vie, à tous les vivants, à ce qu’il y a en eux de richesses intérieures et uniques ; comme si notre regard sur la vie et tous les vivants ne pouvaient jamais finir puisqu’il pourra découvrir des développements imprévisibles, grâce aux développements de la connaissance scientifiques et à l’effort d’intuition que l’on pourra faire sur eux.
Jean-Baptiste ÉCHIVARD
1 THOMAS D’AQUIN, Commentaire au De caelo d’Aristote, 1, l. 22, (228) : Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quod homines senserint sed qualiter se habeat veritas rerum.
2 Par exemple cette affirmation (œuvres complètes, tome I, p. 24) : « Enfin nous avions pris soin dès lors, dans la troisième section de l’ouvrage, d’essayer de dégager les pressentiments et les vues fondamentalement justes, les directions métaphysiques salutaires qui nous semblent contenues, non pas certes dans les principes philosophiques du bergsonisme de fait, mais dans les tendances spirituelles du bergsonisme d’intention. » Cela dit, il faut aussi veiller à ne pas trop séparer ces deux « bergsonismes » car l’intention se manifeste aussi dans et par les textes qui l’explicitent et la mettent à jour pour les lecteurs.
3 P. 78.
4 W. James, l’ami de Bergson, et un des ‘pères fondateurs’ du ‘pragmatisme’, ne s’y était pas trompé quand il lut L’évolution créatrice (Mélanges, lettre du 13 juin 1907, p. 724) ; il lui écrivit son enthousiasme pour ce livre : « Oh ! mon cher Bergson, vous êtes un magicien, et votre livre est une merveille, un véritable miracle dans l’histoire de la philosophie : c’est une date, ou je me trompe fort, dans les conceptions de la matière, mais, au rebours des livres de génie de l’école « transcendantale » (qui sont tous écrits dans une langue si obscure, si cruelle et si inaccessible), le vôtre est d’une beauté de forme qui le rendra classique. Vous allez peut-être sourire de ma comparaison, mais quand je l’ai eu fermé, il m’a laissé le même arrière-goût que j’avais éprouvé jadis en finissant Madame Bovary, l’écho, le prolongement d’une euphonie durable ; le bruissement d’un fleuve immense, sans remous, ni écumes, ni bancs de sable, mais qui continuait, en coulant à plein bords, son cours tranquille et intarissable. Et puis cette justesse parfaite de vos images, qui n’accrochent jamais, ne font pas saillie à angles droits dans le discours comme des tableaux, mais invariablement clarifient la pensée et l’aident à s’épancher ! Ah ! oui ! quel magicien vous êtes ! Si votre prochain livre marque le même progrès sur celui-ci, que celui-ci est supérieur à vos deux livres précédents, vous êtes assuré de laisser un nom à la postérité, comme celui d’un des grands esprits créateurs qu’ait comptés la philosophie. »
5 Bergson écrit, en effet, dans Mes missions (Mélanges, p. 1555), texte posthume publié en 1947 : « La première, de beaucoup la moins importante, est celle d’Espagne, en 1916. Notre gouvernement envoya là-bas quelques membres de l’Institut, en vue d’y donner des conférences, en vue aussi et surtout, de causer avec les personnages influents du pays pour les amener à une idée plus juste de ce qu’était la France, de ce qu’était la France, de ce qu’elle représentait dans cette guerre. »
6 Floris Delattre, en effet, commente ainsi le texte Mes missions, de Bergson, son oncle : « Loin de s’enfermer dans la méditation, il n’a jamais cessé de s’intéresser passionnément à la vie de son pays, de répondre aux appels que celui-ci lui adressait, et il n’a pas hésité à quitter sa solitude distante et silencieuse pour descendre dans l’action et y défendre la cause commune. C’est ainsi qu’il résolut, avec simplicité et courage, aux heures les plus critiques de la première guerre mondiale, de partir à deux reprises pour les États-Unis, parce qu’on lui avait représenté qu’il y pourrait, avec son autorité morale incontestée, rendre des services utiles et immédiats. » (Mélanges, p. 1627)
7 Pour l’examen de ces missions et de l’évaluation de son importance sur la décision américaine finale, on se reportera au livre de Philippe Soulez, Bergson politique (PUF, 1989), en particulier le chapitre II (p. 89-125), Les premières missions ; dans Mélanges (p. 1554-1570), le texte de Bergson Mes missions ; dans le volume Correspondances, la correspondance qui concerne l’année 1917, p. 694-749, avec, en février 1917, les notes servant de base aux conférences devant l’American club, l’American Academy, l’Academy of sciences.
8 On lira en ce sens les pages 101 et 102 du livre de Philippe Soulez, Bergson politique (Puf, août 1989).
9 Correspondances, p. 1670, le testament de Bergson, 8 février 1937, codicille du 9 mai 1938 : « […] Mes obsèques – Mes réflexions m’ont amené de plus en plus près du catholicisme où je vois l’achèvement complet du judaïsme. Je me serais converti, si je n’avais vu se préparer depuis des années (en grande partie, hélas, par la faute d’un certain nombre de juifs entièrement dépourvus de sens moral) la formidable vague d’antisémitisme qui va déferler sur le monde. J’ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés. Mais j’espère, qu’un prêtre catholique voudra bien, si le cardinal archevêque de Paris l’y autorise, venir dire des prières à mes obsèques. Au cas où cette autorisation ne sera pas accordée, il faudrait s’adresser à un rabbin, mais sans lui cacher et sans cacher à personne mon adhésion au catholicisme, ainsi que le désir exprimé par moi d’avoir des prières d’un prêtre catholique. »
10 Mélanges, p. 1520-1521, lettre au P. Gorce. En ce sens Bergson écrivit au P. Sertillanges, le 19 janvier 1937, en réponse à un de ses articles sur Le libre-arbitre chez saint Thomas et chez M. Bergson (Mélanges, p. 1573-1574). On lira, en particulier les points de convergence avec Thomas : « […] J’ai été très frappé d’abord de l’interprétation que vous donnez de la théorie de la liberté chez saint Thomas. Sans vous arrêter à une terminologie qui pourrait tromper, et qui trompe effectivement ceux qui n’ont pas comme vous, la connaissance intime du thomisme, vous allez droit à la notion que saint Thomas a puisée de la liberté dans sa conscience, et qu’il a ensuite ajustée au niveau de la raison. Comment le coup de sonde que j’ai donné au fond de moi-même ne m’aurait-il, pas apporté quelque chose d’analogue ? […] Rapprochant alors mes vues de celles de saint Thomas, les fondant même avec elles, vous aboutissez à une conception de la liberté que je crois être la vérité même, et que vous présentez dans votre langage à vous, de manière à jeter une vive lumière sur le sujet. » Jacques Chevalier, dans son livre Entretiens avec Bergson (Plon, 1959, p. 80) rapporte que dans un entretien du 30-12-1926, Bergson lisait saint Thomas : « En ce moment, je lis saint Thomas, le traité de Dieu, premier livre de la Somme, et je trouve la pensée thomiste beaucoup plus riche que le thomisme étriqué qu’ont présenté certains de ses disciples contemporains. L’éternité, telle que la conçoit la théologie catholique, ne m’apparaît point comme la négation de la durée. – C’est seulement, me dit le P. Pouget, la durée immuable. – Dans l’intelligence divine, réplique Bergson, le futur, si je le comprends bien, se représente comme futur. »
11 A. D. SERTILLANGES, Henri Bergson et le catholicisme, (Flammarion, 1941, note 1, p. 24-25).
12 Hoc enim quilibet experitur in se ipso, quod scilicet habeat animam et quod anima uiuificet. On se reportera à notre traduction du proème du De l’âme dans notre deuxième volume (philosophie rationnelle et philosophie de la nature, p. 197) de notre Une introduction à la philosophie (éd. F. X. de Guibert, Paris 2005).
13 Q. de Ver. q. 10, a. 8, ad 8um : Haec enim scientia de anima est certissima, quod unusquisque in seipso experitur se animam habere, et actus animae sibi ,inesse : sed cognoscere quid sit anima, difficilimum est ; unde Philosophus ibidem sbiungit quod omnino difficillimum est accipere aliquam fidem de ipsa.
14 Ibid., ad 1um : Et ideo antequam a phantasmatibus abstrahat, sui notitiam habitualem habet, qua possit percipere se esse.
15 In I Sent., d. 17, q. 1, a. 5 ad 3um : Intellectus intelligit se intelligere, et similiter voluntas vult se velle et diligit se diligere.
16 In Eth. IX, l. 11, (1908) (éd. Marietti) : […] Quod autem aliquis sentiat se vivere est de numero eorum quae sunt secundum se delectabilia, quia, sicut supra probatum est, vivere est naturaliter bonum, quod autem aliquis sentiat bonum esse in ipso est delectabile. Et sic patet quod, cum vivere sit eligibile et maxime bonis quibus est bonum esse et delectabile, quod etiam percipere se sentire et intelligere est eis delectabile, quia simul cum hoc sentiunt id quod est eis secundum se bonum, scilicet esse et vivere, et in hoc delectantur. [
17 ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, IX, 9, 1170 a 25 – 1170 b 8 (traduction de J. Tricot)].
18 In Eth. IX, l.11, 1909-1910 (éd. Marietti).
19 Sicut ergo aliquis delectatur in suo esse et vivere sentiendo ipsum, ita ad hoc quod delectetur in amico oportet quod simul sentiat ipsum esse, quod quidem contingit convivendo sibi secundum communicationem sermonum et considerationem mentis.
20 On lira sur ce sujet le livre de F. X. Putallaz, Le sens de la réflexion chez Thomas d'Aquin, (Vrin Paris, 1991), en particulier, pour ce qui concerne notre propos, les pages 92-100 dans lesquelles l'auteur traite de la cognitio habitualis, la connaissance habituelle. En particulier cette page : « Pour comprendre ce qu'est la cognitio habitualis, il est indispensable d'éliminer toute représentation d'une connaissance actuelle, supposant une conscience quelconque : il ne s'agit pas d'une connaissance actuelle, d'ordre psychologique, mais d'une présence ontologique de l'âme à elle-même; à l'inverse d'une connaissance actuelle quelconque qui peut se réaliser, ou ne peut pas se réaliser, qui donc est contingente, la présence ontologique de l'âme à elle-même est permanente et incessante, parce que substantielle. En effet, il n'y a pas nécessité que l'esprit se pense toujours en acte, lui dont la connaissance nous est présente d'une manière habituelle du fait que son essence même est présente à notre intellect (Q. de ver. q.10, a. 8). » Ce n'est pas le lieu de rentrer dans l'examen circonstancié de cette question, mais néanmoins, ne peut-on pas dire que cette « présence ontologique », parce qu'elle est ontologique justement, n'est possible qu'à partir de la conscience d'actes effectifs : connaissance, donc conscience d'un objet connu, volonté, donc conscience d'une réalité voulue, imagination, donc conscience d'une réalité imaginée, etc. Si « nous expérimentons en nous-mêmes que nous avons une âme et que nous vivons par elle », si c'est une expérience, il faut bien des actes effectifs qui permettent celle-ci ; F. X. Putallaz dira encore (p.92-93) : « La seule présence de la chose extra-mentale et la réalisation de l'acte intentionnel ne suffisent certainement pas à expliquer la conscience de soi. En effet, de même que, dans toute connaissance, il faut nécessairement que l'objet soit présent à la conscience d'une façon ou d'une autre, de même, dans la connaissance de soi, il faut que le moi soit présent d'une certaine manière à lui-même : c'est cette présence originelle que Thomas d'Aquin appelle « connaissance habituelle » de soi ou cognitio habitualis. » Ajoutons encore une fois : le moi ne peut être présent à lui-même que dans l'expérience première d'une saisie d'êtres extra-mentaux puisque ce sont ces êtres qui actualisent nos diverses facultés : il faut bien qu’il pleuve pour que j’ai conscience que j’ai froid ; qu’il y ait un beau paysage que je suis en train de voir pour que j’ai conscience que j’éprouve un réel plaisir à cette vision ; qu’il y ait eu un événement douloureux dans ma vie pour que je mesure son retentissement en moi, etc. On se reportera également à l’article de F. Guillaud, La conception thomasienne de la conscience immédiate, Revue Thomiste, T. CII, n° III, 2002. Sur cette question on se reportera aux textes suivants de saint Thomas : In III Sent., d. 23, q. 1, a. 2 ; Q. de ver., q. 1, a. 9 ; q. 10, a. 9, a. 8 ; C.G. III, 46 ; Ia, q. 87, a. 1.
21 In Phys. IV, l. 16, 570-572 : 570. Ostendit quod tempus non est sine motu : quia quando homines non mutantur secundum suam appehensionem, aut, si mutantur, tamen lateat eos, tunc non videtur eis quod pertranseat aliquod tempus. Sicut patet in iis qui in Dardo, quae est civitas Asiae, dicuntur fabulose dormire apud Heroas, idest apud Deos. Animas enim bonorum et magnorum Heroas vocabant, et quasi Deos colebant, ut Herculis et Bacchi et similium. Per incantationes enim aliquas, aliqui insensibiles reddebantur, quos dicebant dormire apud Heroas ; quia excitati, quaedam mirabilia se vidisse dicebant, et futura quaedam praenunciabant. Tales autem ad se redeuntes, non percipiebant tempus quod praeterierat dum ipsi sic absorpti erant ; quia illud instans primum , in quo dormire coeperant, copulabant posteriori nunc in quo excitabantur, ac si essent unum ; medium enim tempus non percipiebant. Sic igitur, si non esset aliud et aliud nunc, sed idem et unum, non esset tempus medium ; sic et quando latet diversitas duorum nunc, non videtur tempus medium. Si ergo tunc accidit non opinari tempus, cum non percipimus aliquam mutationem, sed homini videtur quod sit in uno indivisiblili nunc ; tunc autem percipimus fieri tempus quando sentimus et determinamus, id est numeramus, motum aut mutationem ; manifeste sequitur quod tempus non sit sine motus, neque sine mutatione […] 572. Unde dicit quod quia inquirimus quid sit tempus, hinc incipiendum est, ut accipiemus quid motus sit tempus. Et quod tempus sit aliquid motus, per hoc manifestum est, quod simul sentimus motum et tempus. Contingit enim quandoque quod percipimus fluxum temporis, quamvis nullum motum particularem sensibilem sentiamus ; utpote si simus in tenebris, et sic visu non sentimus motum alicuius corporis exterioris. Et si nos non patiamur aliquam altérationem in corporibus nostris ab aliquo exteriori agenti, nullum motum corporis sensibilis sentiemus : et tamen si fiat aliquis motus in anima nostra, puta secundum successionem cogitationum et imaginationum, subito videtur nobis quod fiat aliquod tempus. Et sic percipiendo quemcumque motum, percipimus tempus : et similiter e converso, cum percipimus tempus, simul percipimus motum. Unde cum non sit ipse motus, ut probatum est, relinquitur quod sit aliquid motus.
22 De Trinitate, X, VIII, 11, p. 141-143 (études augustiniennes, 1991.) : Ergo se ipsam quemadmodum quaerat et inueniat, mirabilis quaetio est, quo tendat ut quaerat, aut quo veniat ut inveniat. Quid enim tam in mente quam mens est ? Sed quia in iis est quae cum amore cogitat, sensibilis autem, id est corporalibus, cum amore assuefacta est, non valet sine imaginibus, eorum esse semetipsa […] Cognoscat ergo semetipsam, nec quasi absentem se quaerat, sed intentionem voluntatis qua per alia vagabatur, statuat in semetipsam, et se cogitet. Ita videbit quod nunquam se non amaverit, nunquam nescierit : sed aliud secum amando cum eo se confudit et concrevit quodam modo ; atque ita dum sicut unum diversa complectitur, unum putavit esse quae diversa sunt.
23 Ibid., X, X, 13 (p. 144-145) : Sed cum dicitur menti, Cognosce te ipsam, eo ictu quo intelligit quod dictum est. Te ipsam, cognoscit se ipsam […] Non ergo adjungat aliud est id quod se ipsam cognoscit, cum audit ut se ipsam cognoscat. Certe enim novit sibi dici, sibi scilicet quae est, et vivit, et intelligit. Sed est et cadaver, vivit et pecus : intelligit autem nec cadaver, nec pecus
24 On notera évidemment une certaine parenté avec le ‘cogito’ cartésien. Pour comparer ces deux ‘cogito’ on pourra lire dans le livre d’Étienne Gilson (Étude sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien – Vrin, 1975), le chapitre Le cogito et la tradition augustinienne, p. 191 à 201 ; il en montre bien la différence.
25 Ibid., X, X, 14 (p. 148-149) : Vivere se tamen et meminisse et intelligere, et velle, et cogitare, et scire, et judicare quis dubet ? Quandoquidem etiam si dubitat, cogitat ; si dubitat, scit se nescire ; si dubitat, judicat non se temere consentire oportere. Quisquis igitur aliunde dubitat, de his omnibus dubitare non debet : quae si non essent, de ulla re dubitare non debet : quae si non essent, de ulla re dubitare non posset.
26 Q. D. De ver., q. 10, a. 8, c.
27 AUGUSTIN D’HIPPONE, op. cit., XV, XXVIII, 51, p. 565 : Ad hanc autem regulam fidei dirigens intentionem meam, quantum potui, quantum me posse fecisti , quaesivi te, et desideravi intellectu videre quod credidi, et multum disputavi, et laboravi. Domine Deus meus, una spes mea, exaudi me, ne fatigatus nolim te quaerere, sed quaeram faciem tuam semper ardenter (psalm. CIV, 4).
28 Fechner, par exemple, définit ainsi cette psychophysique : « J’entends par psychophysique une théorie exacte des rapports entre l’âme et le corps, et, d’une manière générale, entre le monde physique et le monde psychique » Se reporter aux notes explicatives du premier chapitre de la thèse Les données immédiates… et celles qui expliquent les pages 46 à 55 (dans la nouvelle édition aux PUF).
29 Par exemple, dans le deuxième chapitre, Bergson indique (p. 80) : « […] le temps entre dans les formules de la mécanique, dans les calculs de l’astronome et même du physicien, sous forme de quantité. On mesure la vitesse d’un mouvement, ce qui implique que le temps, lui aussi, est une grandeur […] Au-dedans de moi, un processus d’organisation ou de pénétration mutuelle des faits de conscience se poursuit, qui constitue la durée vraie » ; et à la page 83, cette affirmation si importante : « Bref, il y a deux éléments à distinguer dans le mouvement, l’espace parcouru et l’acte par lequel on le parcourt, les positions successives et la synthèse de ces positions. Le premier de ces éléments est une quantité homogène ; le second n’a de réalité que dans notre conscience ; c’est, comme l’on voudra, une qualité ou une intensité. »
30 Mélanges, p. 604, lettre du 21 octobre 1903. Il faudrait ajouter à cette lettre celle du 9 mai 1908 à William James (Mélanges, p. 765-766). Elle indique bien ce bouleversement de Bergson que fut cette ‘découverte’ de la durée et la raison pour laquelle il se consacra, ensuite, au point de vue psychologique : « […] Ce fut l’analyse de la notion de temps, telle qu’elle intervient en mécanique et en physique qui bouleversa toutes mes idées. Je m’aperçus, à mon grand étonnement, que le temps scientifique ne dure pas, qu’il n’y aurait rien à changer à notre connaissance scientifique des choses si la totalité du réel était déployée tout d’un coup dans l’instantané, et que la science positive consiste essentiellement dans l’élimination de la durée. Ceci fut le point de départ d’une série de réflexions qui m’amenèrent, de degré en degré, à rejeter presque tout ce que j’avais accepté jusqu’alors, et à changer complètement de point de vue. J’ai résumé dans l’Essai sur les données immédiates de la conscience (p. 87-90, 146-149) ces considérations sur le temps scientifique, qui déterminèrent mon orientation philosophique et auxquelles se rattachent toutes les réflexions que j’ai pu faire depuis… » À ces deux textes, il faut aussi ajouter des confidences à Charles Du Bos reproduites dans l’édition du Centenaire (p. 1541-1543) ; on pourra y lire la déception, voire sa colère, qu’il ressentit lorsqu’il s’aperçut que le jury de sa thèse ne comprit pas l’importance du deuxième chapitre sur la durée. C’est dans ces confidences qu’il montra comment en expliquant aux élèves les paradoxes de Zénon d’Elée il commença à entrevoir l’importance de la durée et sa distinction d’avec le temps mathématique : « […] Un jour que j’expliquais au tableau noir à mes élèves les sophismes de Zénon d’Elée, je commençais à voir plus nettement dans quelle direction il fallait chercher […] »
31 Dans une lettre à M. H. Von Keyserling du 3 janvier 1909, il écrira (Correspondances, p. 242) : « La doctrine que je propose n’est qu’un retour à la manière de philosopher qui est innée à chacun de nous, mais que l’intellectualisme exagérée des philosophes, joint à celui du langage, a fini par nous voiler. Ou je me trompe beaucoup, ou vous inclinez, vous aussi, à recourir à cette conscience immédiate. »
32 Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 175.
33 Jacques CHEVALIER, Bergson, (Librairie Plon, Paris, 1926, p. 145).
34 Conférence sur la personnalité du 6 mai 1915, Mélanges, p. 1223.
35 Il s’agit d’une conférence prononcée à Madrid le 6 mai 1916. On se reportera au livre Mélanges, p. 1216.
36 p. IX.
37 Par exemple, ce texte (L’évolution créatrice, p. 312): « Qu’on y regarde de près : on verra que notre manière habituelle de parler, laquelle se règle sur notre manière habituelle de penser, nous conduit à de véritables impasses logiques, impasses où nous nous engageons sans inquiétude parce que nous sentons confusément qu’il nous serait toujours loisible d’en sortir ; il nous suffirait, en effet, de renoncer aux habitudes cinématographiques de notre intelligence. Quand nous disons « l’enfant devient homme », gardons-nous de trop approcher le sens littéral de l’expression. Nous trouverions que, lorsque nous posons le sujet « enfant », l’attribut « homme » ne lui convient pas encore, et que, lorsque nous énonçons l’attribut « homme », il ne s’applique déjà au sujet « enfant ». La réalité qui est la transition de l’enfance à l’âge mûr, nous a glissé entre les doigts. Nous n’avons que les arrêts imaginaires « enfant » et « homme », et nous sommes tout près de dire que l’un de ces arrêts est l’autre, de même que la flèche de Zénon est, selon ce philosophe, à tous les points du trajet. La vérité est que, si le langage se moulait ici sur le réel, nous ne dirions pas « l’enfant devient homme », mais « il y a devenir de l’enfant à l’homme ».
38 Mélanges, p. 362, Le bon sens et les études classiques.
39 Ibid., p. 366.
40 Témoin en est cette affirmation des Données immédiates de la conscience (p. 303-304) : « Le devenir est infiniment varié. Celui qui va du jaune au vert ne ressemble pas à celui qui va du vert au bleu : ce sont des mouvements qualitatifs différents. Celui qui va de la fleur au fruit ne ressemble pas à celui qui va de la larve à la nymphe et de la nymphe à l’insecte parfait : ce sont des mouvements évolutifs différents. Et ces trois genres de mouvements eux-mêmes, qualitatif, évolutif, extensif, diffèrent profondément. L’artifice de notre perception, comme celui de notre langage consiste à extraire de ces devenirs très variés la représentation unique du devenir en général, devenir indéterminé, simple abstraction qui par elle-même ne dit rien et à laquelle il est même rare que nous pensions. » En ce sens, H. Gouhier écrira, comparant Maine de Biran à Bergson (MAINE DE BIRAN par lui-même, Les éditions du Seuil, coll. Les écrivains de toujours, paris, 1970, p. 41) : « […] les données immédiates de la conscience sont ce qui n’est jamais immédiatement donné , ce que la philosophie doit chercher, allant à contre-courant de la vie qui tourne l’homme vers le monde des choses et la société de ses semblables où s’exerce son action ; la philosophie implique donc la mise au point d’une méthode introspective qui soit à la fois épuration, et, dans le vocabulaire bergsonien, intuition. »
41 C’est ce que Péguy aimait tant chez Bergson ; il écrit dans Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne, (p. 20, éd. Gallimard, 1935): « Cette dénonciation d’un intellectualisme universel, c’est-à-dire d’une paresse universelle consistant à toujours se servir du tout fait, aura été l’une des grandes conquêtes et l’instauratio magna de la philosophie bergsonienne. Il est vrai que l’immense majorité des hommes pense par idées toutes faites. Par idées apprises. Il y a une paresse universelle et pour ainsi dire infatigable. C’est sur le travail qui se fatigue, mais la paresse, mais la fatigue ne se fatigue pas. La dénonciation de cette paresse, de cette fatigue, de cet intellectualisme constant est au seuil de l’invention bergsonienne. » Les disciples de saint Thomas ont eux aussi été tentés par cette pente naturelle à la paresse intellectuelle, à la répétition de notions toutes faites ; Gilson, par exemple, a souvent fustigé la philosophie des manuels scolastiques. Bergson, lui aussi, pressent quelque chose comme cela ; il écrit, en effet, à la comtesse Murat le 2 septembre 1916 (Correspondances, p. 645) : « […] Je suis très frappé de ce que vous m’écrivez du Père Sertillanges et de son opinion sur saint Thomas. Je ne connais que très incomplètement la philosophie du Moyen-Âge (il faudrait, pour l’approfondir tant soit peu, y consacrer sa vie), mais je soupçonne qu’il y a beaucoup plus dans saint Thomas que le « thomisme », et qu’ici encore les disciples ont rétréci et figé la doctrine du maître, dont la pensée a dû s’ouvrir dans bien des directions différentes, tandis que les continuateurs n’en retiennent jamais qu’un.»
42 Nous n’énumérons pas les discours, conférences, cours au Collège de France, à l’École Normale Supérieure, et la correspondance de notre auteur qui contiennent aussi beaucoup d’allusions aux ‘grands’ thèmes des livres principaux, l’éclairant, le développant aussi parfois ; tous ces textes montrent le professeur toujours soucieux de transmettre, de se faire comprendre et de rendre accessible le fruit de sa recherche. N’oublions pas non plus son expérience politique et diplomatique qui peut servir de toile de fond à bien des analyses de son livre Les deux sources de la morale et de la religion : le livre date de 1932, ses ‘missions’ diplomatiques de 1916 à 1918, sans compter ensuite la présidence de la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle (future UNESCO) ; il y enverra sa démission par une lettre du 27 juillet 1925 (Mélanges, p. 1476).
43 Les données immédiates de la conscience, avant-propos, (éd. Quadridge, PUF, 2011, p. VII).
44 Il dira dans une interview le 16 février 1914 (Mélanges, p. 1039) : « […] puis me voilà nommé à Clermont-Ferrand. La transition était brusque, du décor opulent de la Loire au décor sévère de l’Auvergne. Eh bien ! Cependant, c’est là, parmi les puys, les volcans éteints, les paysages de vive verdure peuplée de paysages aux maisons noires, c’est là que ma pensée s’est recueillie, ramassée, concentrée. Mes premières méditations eurent pour objet de définir la notion de temps, qui me semblait incomplète et lacunaire. Et depuis, j’ai travaillé, simplement. J’ai travaillé de toutes mes forces, sans à-coups, sans être obligé de changer la méthode rigoureuse que je me suis imposée dès le début. »
45 Pour la présentation des arguments de Zénon d’Élée, on se reportera dans Les physiques d’Aristote : 1, 185 a 17, a 2 ; 3, 6, 206 b ; 7, 207 a 33 ; 6, 2, 233 a 11-23 ; et dans la Métaphysique, Θ, 3, 1047 a. On trouve dans pratiquement toutes les œuvres de Bergson une allusion à ces arguments ; par exemple : Essai sur les données immédiates : p. 84-85 ; Matière et mémoire : p. 213-215 ; L’évolution créatrice : p. 313 ; La pensée et le mouvant : p. 8 ; Les deux sources de la morale et de la religion : p. 51 et 72 ; p. 32, 71, 51, 208.
46 Mélanges, p. 573-574.
47 Ibid., p. 1148, Lettre de Bergson à H. Höffding, du 15 mars 1915.
48 Les données immédiates de la conscience, p. 83.
49 Ibid., p. 170.
50 La pensée et le mouvant, Introduction à la métaphysique, p. 200-201.
51 L’évolution créatrice, p. 11.
52 Dans un cours sur Plotin professé à l’École Normale Supérieure en 1898-1899 (Cours sur Plotin, collec. Épiméthée, PUF, tome IV, p. 65-66 ; 71-73 ), il n’est pas impossible que Bergson trouve chez Plotin un écho de ce qu’il entend par « conscience » et, peut-être, cette idée d’intuition, de perception unitive et ‘sympathique’ que nous devons faire pour coïncider avec le réel et le connaître : « […] Parmi les termes qu’on a traduit par conscience, nous trouvons le mot συnαίσθησιςV. Que signifie ce mot ? IV, 5, 5 : « On peut dire de l’ouïe ce que nous avons dit de la vue ; son affection est une συnαίσθησιV comme celle des parties d’un animal. » Le mot ici a un sens clair. Or pour Plotin, la perception est une sympathie de l’organe avec l’objet avec lequel il vibre à l’unisson. Le mot signifie sympathie. De même, I, 1. 9 : « L’intelligence discursive faisant un choix des impressions venues de la sensation contemple les Idées et les contemple comme par une συναίσθησις, car la diάνοια véritable est une similitude et une communication de l’interne avec l’extérieur. » Ici encore le sens est clair. Plotin attribue à la diάνοια le rôle d’aller chercher dans le νοuV une Idée qu’elle rapproche de la sensation, elle a ce rôle dans la perception. Le mot désigne ici la communication sympathique entre la diάνοια et l’objet matériel qui va se peindre dans la représentation. Sympathie est bien le sens fondamental du mot. De degré en degré on s’achemine au sens de conscience. Si c’est une sympathie, elle peut être plus particulièrement la sympathie des parties d’un être les unes pour les autres, leur accord entre elles. IV, 4. 45 : « Dans un animal, il y a sympathie de chaque organe vis-à-vis de tous les autres et du tout pour le tout. » IV, 4. 9 : « L’âme universelle ne sera plus entière ; il y aura des puissances diverses dans les parties diverses du monde ; il n’y aura plus συναίσθησις. » C’est déjà le sens plus particulier de consensus, d’harmonie intérieure. De ce deuxième sens, nous allons passer au sens de conscience. Supposons que la conscience soit pour Plotin, d’un certain point de vue, une sympathie, une harmonie des différentes parties de l’âme entre elles ; alors le mot pourra signifier conscience. III, 8. 4, Plotin attribue à la nature une espace de conscience endormie : « La nature demeure dans son équilibre propre et dans une espèce de συναίσθησιV. » Cette conscience ici est un consensus interne, un équilibre. V, 3. 13 : « La συναίσθησις est l’αίσθησις d’une pluralité. » Le mot peut donc signifier conscience, mais ce n’est pas le sens fondamental du mot. Nous pouvons déjà apercevoir une certaine conception de la conscience. Du premier coup, Plotin est tombé sur une conception toute moderne de la conscience. La conscience serait avant tout synthèse, assimilation, communication sympathique de toutes les parties de l’âme. La psychologie contemporaine admet de plus en plus des états d’âme inconscients. Pour qu’un état devienne conscient, il faut qu’il y ait assimilation, que nous le fassions entrer dans le courant de notre personnalité. C’est quelque chose de ce genre que Plotin a dit. La conscience serait une puissance de possession par l’âme. »
53 La pensée et le mouvant, p. 181.
54 Dans une note de l’Introduction à la métaphysique, Bergson indique, sans doute afin qu’on évite d’opposer trop systématiquement l’intelligence à l’intuition et à dire de sa philosophie qu’elle est une philosophie ‘anti-intellectualiste’, qu’il a choisi le terme intuition, sachant bien que celui-ci pourrait laisser supposer une trop grande distance par rapport à l’intelligence et à sa capacité de raisonner : « Comme nous l’expliquons au début de notre second essai, (p. 25 sq.), nous avons longtemps hésité à nous servir du terme « intuition » ; et, quand nous nous y sommes décidés, nous avons désigné part ce mot la fonction métaphysique de la pensée : principalement la connaissance intime de l’esprit par l’esprit, subsidiairement la connaissance par l’esprit, de ce qu’il y a d’essentiel dans la matière, l’intelligence étant sans doute faite avant tout pour manipuler la matière et par conséquent pour la connaître, mais n’ayant pas pour destination spéciale d’en toucher le fond. » On pourra lire aussi ce qu’il dit à Jacques Chevalier, le 30 décembre 1926 et que celui-ci rapporte dans ses Entretiens avec Bergson à la page 79 : « J’ai choisi le mot intuition, faute d’un meilleur mot. Mais je n’en étais pas tout à fait satisfait. Je voulais désigner l’intelligence au sens large, ou la pensée. Mais le mot « intelligence » était employé dans un sens qui ne se prêtait pas à l’expression de ce que je voulais dire. Je pris donc le mot intuition. Malheureusement, nous ne sommes pas comme les mathématiciens qui forgent les mots dont ils ont besoin. »
55 Mélanges, p. 556-558. Discours prononcé par Bergson au lycée Voltaire le 31 juillet 1902.
56 Introduction à la métaphysique, p. 45-46.
57 Introduction à la métaphysique, p. 2-3. Nous avons mis en italique les expressions qui nous paraissent importantes pour notre propos. Les deux textes que nous citons extraits de la même conférence sont situés différemment. Celui sur Kant est situé dans les dernières pages (p. 45-46), et celui qui explique la nature de cet absolu, objet réel de la métaphysique pour Bergson est au début (p. 2-3). Il est suivi de la célèbre définition de l’intuition (p. 5), comme si la critique de la philosophie kantienne, et avec elle, un certain platonisme de la philosophie, à cause de la référence à une mathématique universelle était une des conséquences de la métaphysique telle que la conçoit Bergson. On notera aussi qu’il fait allusion au platonisme, mais non à l’aristotélisme.
58 Mélanges, p. 964, lettre au P. de Tonquédec du 20 février 1912, (c’est-à-dire cinq années après la publication de L’évolution créatrice) : « Je ne vois rien à ajouter pour le moment, en tant que philosophe, parce que la méthode philosophique, telle que je l’entends, est rigoureusement calquée sur l’expérience (intérieure et extérieure) et ne permet pas d’énoncer une conclusion qui dépasse de quoi que ce soit les considérations empiriques sur lesquels elle se fonde […] celles de l’Essai sur les données immédiates de la conscience aboutissent à mettre en lumière le fait de la liberté ; celles de Matière et mémoire font toucher du doigt, je l’espère, la réalité de l’esprit ; celles de L’évolution créatrice présentent la création comme un fait […] De tout cela se dégage nettement l’idée d’un Dieu créateur et libre, générateur à la fois de la matière et de la vie, et dont l’effort de création se continue du côté de la vie, par l’évolution des espèces et par la constitution des personnalités humaines […] Mais pour préciser encore plus ces conclusions et en dire davantage, il faudrait aborder des problèmes d’un tout autre genre, les problèmes moraux. Je ne suis pas sûr de jamais rien publier à ce sujet ; je ne le ferai, que si j’arrive à des résultats qui me paraissent aussi démontrables ou aussi « montrables » que ceux de mes autres travaux. Tout ce que je dirai dans l’intervalle serait à côté, et même en dehors de la philosophie telle que je la conçois, la philosophie étant à mes yeux quelque chose qui se constitue selon une méthode bien déterminée et qui peut, grâce à cette méthode, prétendre à une objectivité aussi grande que celle des sciences positives, quoique d’une autre nature. »
59 Ce texte qui est d’abord un article paru dans la Revue de métaphysique et de morale en janvier 1903 ; repris en 1934 (date de la parution de La pensée et le mouvant, dernier texte de Bergson), n’est-il pas un signe éloquent que la métaphysique accompagne la recherche bergsonienne, en particulier, après la publication de Matière et mémoire ?
60 Jean THEAU, La critique bergsonienne du concept, (PUF, Privat, éditeur, Toulouse, 1965, p. 39).
61 Les grandes amitiés, (Desclée de Brouwer, collection Livre de vie, 1974, p. 81-82.)
62 Bergson dira en effet dans La pensée et le mouvant (p.8) : « La métaphysique date du jour où Zénon d’Elée signale les contradictions inhérentes au mouvement et au changement tel que se le représente notre intelligence. »
63 La pensée et le mouvant, p. 43. On notera dans le même sens cette affirmation importante extraite d’une réponse à un article d’É. Borel de janvier 1908 (Mélanges, p. 753) : « […] s’il y a une conclusion qui se dégage de l’Évolution créatrice, c’est, au contraire, que l’intelligence humaine et la science positive, là où elles s’exercent sur leur objet propre, sont bien en contact avec le réel et pénètrent de plus en plus profondément dans l’absolu. »
64 La pensée et le mouvant, p. 226.
65 Mélanges, p. 488, Le parallélisme psycho-physique et la métaphysique positive, séance de la société de philosophie du 2 mai 1901.
66 L. HUSSON, L’intellectualisme de Bergson, PUF, 1947, p. 13-14.
67 J. CHEVALIER, Entretiens avec Bergson, Plon, Paris, 1959, p. 15.
68 L’évolution créatrice, p. 200.
69 Dans les Deux sources, Bergson écrit (p. 30) : « Pourquoi les saints ont-ils des imitateurs, et pourquoi les grands hommes de bien ont-ils entraîné derrière eux des foules ? Ils ne demandent rien, et pourtant, ils obtiennent. Ils n’ont pas besoin d’exhorter ; ils n’ont qu’à exister ; leur existence est un appel. »
70 Il écrit encore dans Les deux sources : « Une œuvre géniale, qui commence par déconcerter, pourra créer peu à peu par sa seule présence une conception de l’art et une atmosphère artistique qui permettront de la comprendre ; elle deviendra alors rétrospectivement géniale : sinon, elle serait restée ce qu’elle était au début, simplement déconcertante. Dans une spéculation financière, c’est le succès qui fait que l’idée avait été bonne. Il y a quelque chose du même genre dans la création artistique, avec cette différence que le succès, s’il finit par venir à l’œuvre qui avait d’abord choqué, tient à une transformation du goût public opéré par l’œuvre même ; celle-ci était un donc force en même temps que matière ; elle a imprimé un élan que l’artiste lui avait communiqué ou plutôt qui est celui même de l’artiste, invisible et présent en elle. On en dirait autant des créations successives qui enrichissent de plus en plus l’idée de justice. »
71 La pensée et le mouvant, p. 76. On lira, également avec profit cette forte affirmation de Bergson à Jacques Chevalier, le 29 octobre 1933 (in Entretiens…op. cit. p. 200): « la substance, telle que je la conçois, pour n’être pas statique, n’en est pas moins substance. »
72 Ibid., p. 80.
73 Dans sa brochure Avec Bergson, le P. Sertillanges rapporte ce que lui disait Bergson dans un entretien (p. 37) : « De la création ainsi envisagée nous passons naturellement à l’objet de la création, qui, à titre direct, est la substance, les réalités distribuées dans les autres catégories n’étant que ses attributs et comme greffées sur elle. Là-dessus, Bergson proteste contre ceux qui ont voulu faire de lui un négateur de la substance. « Autant, dit-il, me prêter la négation du moi, que j’ai passé ma vie que j’ai passé ma vie à étudier. Je rejette un moi chose, c’est-à-dire un moi immobile, et d’une façon générale une substance support inerte et indéfinissable. Mais définir la substance et le moi par leur mobilité même, ce n’est pas les nier, pas plus que les thèmes d’une symphonie, qui sont aussi une mobilité essentielle. J’observe alors que la définition thomiste de la substance par matière, c’est-à-dire potentialité pure, et forme, c’est-à-dire idéalité immanente, échappe entièrement à la critique de la substance-support. Il n’y a pas non plus pour nous de support concret. Il n’y a pas d’immobilité sous-jacente aux phénomènes concrets. La substance concrète change tout le temps. Ce qui ne change pas, c’est sa formule (la forme d’existence) et la limite potentielle des transformations qu’elle comporte (la matière). Mais ces éléments, de nature métaphysique, n’ont rien à voir avec la notion empirique d’un support.» Accord complet sur ces termes […] Reste que les éléments métaphysiques dont nous parlons : matière, forme, ne peuvent être qu’étrangers à une philosophie qui entend ne point dépasser l’expérience. »
74 La pensée et le mouvant, p. 60.
75 Ibid., p. 58.
76 H. HUDE, Bergson, tome I, p. 161-162.
77 Les deux sources…p. 273-274.
78Introduction à la métaphysique, p. 31.
79 Par exemple cette forte affirmation du troisième chapitre des Deux sources (p. 271) : « On pourrait encore hésiter à l’admettre, si l’on tenait pour accidentelle l’apparition, parmi les animaux et les plantes qui peuplent la terre, d’un être vivant tel que l’homme, capable d’aimer et de se faire aimer. Mais nous avons montré que cette apparition, si elle n’était pas prédéterminée, ne fut pas non plus un accident. Bien qu’il y ait eu d’autres lignes d’évolution à côté de celle qui conduit à l’homme, et malgré ce qu’il y a d’incomplet dans l’homme lui-même, on peut dire que c’est l’homme qui est la raison d’être de la vie sur notre planète. » Auparavant, Bergson avait montré (p. 265) comment l’âme mystique prolongeait l’intuition que l’âme humaine peut avoir de sa propre vie intérieure, donnant ainsi à l’élan vital sa signification principale : « Car elle était tournée vers le dedans : et, si par une première intensification, elle nous faisait saisir la continuité de notre vie intérieure, si la plupart d’entre nous n’allaient pas plus loin, une intensification supérieure la porterait peut-être jusqu’aux racines de notre être, et, par là, jusqu’au principe même de la vie en général. L’âme mystique n’avait-elle pas justement ce privilège ? »
80 Dans Les deux sources… (p. 268) Bergson affirme : « Quoi de plus construit, quoi de plus savant qu’une symphonie de Beethoven ? Mais tout le long de son travail d’arrangement, de réarrangement et de choix, qui se poursuivait sur le plan intellectuel, le musicien remontait vers un point situé hors du plan pour y chercher l’acceptation ou le refus, la direction, l’inspiration : en ce point siégeait une indivisible émotion que l’intelligence aidait sans doute à s’expliciter en musique, mais qui était elle-même plus que musique et plus qu’intelligence. »
81 Par exemple, quand, dans L’évolution créatrice (p. 88 à 98), Bergson évoque l’élan vital comme cause profonde des variations du vivant : « Nous revenons ainsi par un long détour à l’idée d’où nous étions partis, celle d’un élan originel de la vie, passant d’une génération de germes à la génération suivante, de germes par l’intermédiaire des organismes développés qui forment entre les germes le trait d’union. Cet élan, se conservant sur les lignes d’évolution entre lesquelles il se partage est la cause profonde des variations, du moins de celles qui se transmettent régulièrement, qui s’additionnent, qui créent des espèces nouvelles. »
82 Le 30 juillet 1895, il dira dans un discours sur Le bon sens et les études classiques (Les écrits philosophiques, p 160) : « Je vois justement dans l’éducation classique, avant tout, un effort pour rompre la glace des mots et retrouver au-dessous d’elle le libre courant de la pensée. En vous exerçant, jeunes élèves, à traduire les idées, d’une langue dans une autre, elle vous habitue à les faire cristalliser, pour ainsi dire, dans plusieurs systèmes différents ; par là, elle les dégage de toute forme verbale définitivement arrêtée, et vous invite à penser les idées mêmes, indépendamment des mots. »
83 On lira, sur ce sujet les pages 294-295 de Entretiens... : « Étant jeune, j’aimais et je pratiquais l’équitation (à Paris, Mérignac, chez Kirchoffen, puis à Clermont). Un jour vint, à Clermont, je crois, où je pris la résolution de faire sans effort ce que j’avais fait avec effort. Le résultat fut bien meilleur, lorsque je passais de l’état de tension à celui de rémission, d’abandon et de confiance. Mais cet état est très difficile à analyser. Il demanderait à être étudié dans ses conditions, en s’attachant à ce problème. Je voyais bien en tout cas qu’il ne s’agissait pas ici de courage, car le risque était nul. C’était peut-être la confiance de s’en remettre entre les mains : de qui ? de quoi ? Mettons : du génie de l’équitation : de Dieu. Il s’agissait d’une confiance absolue, équivalent quasi instantané de toute une série d’efforts, et qui me donnait la souplesse, l’aisance, et même quelque chose de plus. Pour être un fin cavalier, il faut commencer tôt ; on y arrive plus ou moins vite, plus ou moins aisément. Mais ceux qui ont fait effort gardent toujours quelque chose de l’effort qu’ils ont dû faire pour y parvenir. D’autres acquièrent très vite une aisance parfaite et absolue : c’est le privilège d’un petit nombre. Pour moi, j’avais à faire un gros effort, mais je sentais que j’aurais pu arriver au même résultat sans effort ou presque, et que cependant il y aurait toujours quelque chose qui aurait été le substitut de cet effort, qui l’eût contenu sous une forme simple. Il s’agit là d’un état indéfinissable, intermédiaire entre une disposition physique et une disposition morale ; si j’avais su l’analyser, je me serais inventé une méthode pour l’action. » N’avons-nous pas ici une description de la naissance d’un habitus proprement dit, une disposition permanente acquise par une répétition d’actes, que certains acquièrent avec plus ou moins d’aisance, de rapidité, peut-être à cause du désir qu’ils ont d’acquérir cet habitus précis, de l’amour de la fin de celui-ci.
84 On pourra, pour illustrer ce point lire dans Mes missions, (dans Mélanges, p. 1558) - texte publié après sa mort en 1947-, la description qu’il fait de l’ambassadeur de France aux USA, M. Jusserand.
85 On se reportera au Cours IV, Cours de philosophie grecque, édité par H. Hude, collection Épiméthée, 2000, p. 105-115) ; en particulier cette phrase qui termine le passage sur la science : « C’est ainsi que la métaphysique ou philosophie première est la dernière par rapport à nous. »
86 Il suffit de lire la note 206 (p. 178) du livre d’Henri Hude que nous citons plus haut, pour s’apercevoir du travail scientifique de Bergson auquel il s’adonna quand il était à Clermont.
87 Avec Bergson, Gallimard, 1941, p. 45-46.
88 La pensée et le mouvant, p. 176.
89 L’évolution créatrice, p. 249.
90 Nous n’aborderons pas la question difficile des rapports de Bergson avec Aristote. Sa thèse secondaire porte sur l’idée de lieu chez Aristote, il le connaissait donc, en particulier Les Physiques et la Métaphysique. Mais il semble l’inclure avec Platon dans sa critique de la connaissance abstraite, ne voyant pas ainsi la différence entre Platon et Aristote ; différence entre le réalisme platonicien des Idées, ce que l’on a appelé un ‘idéalisme’ et le réalisme aristotélicien des libri naturales, celui de l’étude des mouvements de la nature, celui qui associe étroitement une philosophie de la nature et la métaphysique.
91 Comme, par exemple, dans le premier chapitre du livre E de la Métaphysique.
92 Dans un entretien avec Jacques Chevalier (Entretiens…op. cit. p. 118), à la question « Comment êtes-vous venu à l’idée de création ? Est-ce par une influence religieuse, comme le paraît le supposer Söderblom ? - philosophe suédois - », il répondra : « Nullement. L’idée de création était indissolublement liée à ma découverte du temps, et elle se révéla à moi en même temps qu’elle, lorsque je commençai à me déprendre de Spencer. Pour moi, la création, c’est l’apparition de quelque chose de nouveau et d’imprévisible. Du néant rien ne peut procéder (le néant est impensable, il est impossible). Il doit y avoir l’Être, la force créatrice…Maintenant je ne vois pas de raisons pour que le mode ait toujours existé. Il me paraît extrêmement probable qu’il n’a pas toujours existé… » Mais il faut d’ailleurs préciser qu’en annotant le livre que Jacques Chevalier préparait, son Bergson, Bergson lui-même lui faisait remarquer à propos des pages 5, 6, 7, 8 et surtout 6 (Correspondances, p. 1183-1184) : « La rédaction de ces pages pourrait faire supposer que j’ai voulu donner dans l’Évolution créatrice une démonstration de l’existence de Dieu, ou, tout au moins qu’étant en possession, moi, d’une certaine croyance, j’ai voulu acheminer le lecteur. Cette interprétation détruirait ce que je tiens pour essentiel dans la doctrine, et surtout dans la méthode. Celle-ci consiste à partir de l’expérience, et à remonter aussi haut que possible vers la source, mais à s’arrêter là où s’arrête l’expérience. Je remonte aussi à un « Élan vital ». Sans doute cet élan vient de quelque part. Mais d’où ? Je n’en dis rien parce que, avec les matériaux dont je dispose en tant qu’auteur de « L’Évolution créatrice », je n’en sais rien. J’ai bien nommé cette cause, et, du moment que je la nomme, je ne puis que l’appeler Dieu. Mais si je m’en tiens à l’Évolution créatrice, ce Dieu n’est connu que comme la cause x d’un monde fini et imparfait ; rien ne nous autorise à lui donner les attributs traditionnels : en particulier, rien ne le révèle ici comme providence. »
93 Par exemple dans L’Évolution créatrice (p. 321), il affirme : « La philosophie antique ne pouvait échapper à cette conclusion (c’est-à-dire celle d’affirmer que les Idées existent par elles-mêmes). Platon la formula, et c’est en vain qu’Aristote essaya de s’y soustraire. Puisque le mouvement naît de la dégradation de l’immuable, il n’y aurait pas de mouvement, pas de monde sensible par conséquent, s’il n’y avait quelque part, l’immutabilité réalisée. Aussi, ayant commencé par refuser aux Idées une existence indépendante et ne pouvant pas, néanmoins, les en priver, Aristote les pressa les unes dans les autres, les ramassa en boule, et plaça au-dessus du monde physique une Forme qui se trouva être ainsi la Forme des Formes, l’Idée des Idées, ou enfin, pour exprimer son expression, la Pensée de la Pensée. Tel est le Dieu d’Aristote, - nécessairement immuable et étranger à ce qui se passe dans le monde, puisqu’il est la synthèse de tous les concepts en un concept unique. »
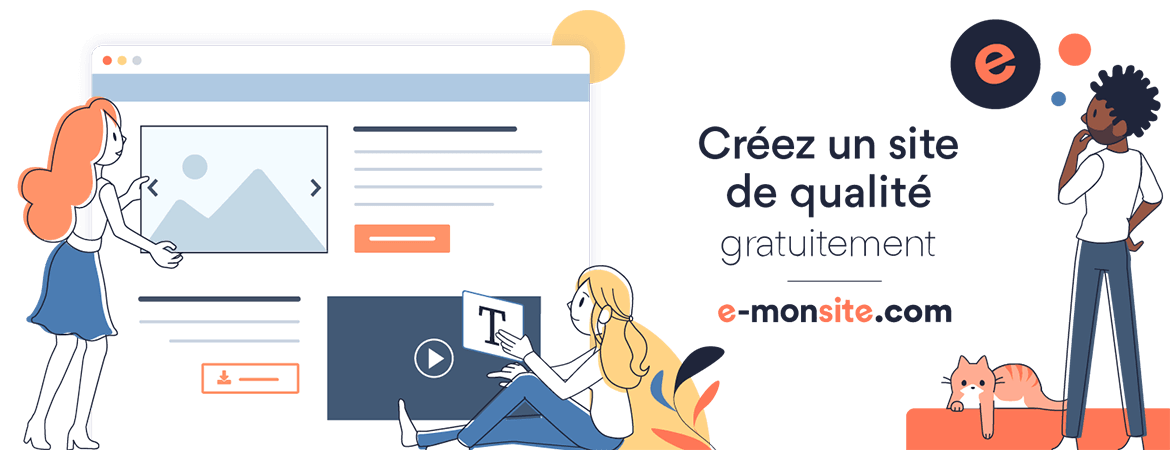
Ajouter un commentaire