- Accueil
- Suggestions de lecture
- Jean CACHIA
Jean CACHIA
Jean CACHIA, Le Créateur de l’univers, Paris, F.-X. de Guibert, 2006, 1 vol. de 235 p.
Il faut savoir gré aux éditions de Guibert de nous offrir la version française d’un ouvrage déjà publié par son auteur en langue anglaise (The Creator of the Universe, London, Minerva Press, 2000). La pratique, en outre, de l’allemand, mais aussi de l’hébreu, du grec et du latin, permet à l’A. d’appuyer son argumentation sur une connaissance directe et de première main des textes qu’il cite, voire de rectifier telle ou telle interprétation due à la complaisance herméneutique de certaines écoles contemporaines.
« La justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Pourtant, malgré le progrès de l’instruction, beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu existe et, de ce fait, ne lui rendent pas le culte qui lui est dû » (p.7). Cet incipit donne une juste idée de la visée, de la teneur, et de la tonalité de l’ouvrage. Les trois se signalent par ce caractère éminemment philosophique qu’est la désinvolture.
Elle conduit tout d’abord à poser et à traiter à nouveau frais une Question osée (ch.I), celle de savoir s’il y a vraiment des raisons d’affirmer que l’existence de Dieu ne saurait être l’objet d’une connaissance rationnelle, mais seulement d’une croyance ou d’une option personnelle. L’audace consiste ici à redonner à la question de l’existence de Dieu le statut logique que la plupart lui dénient aujourd’hui. L’A. explique d’abord comment elle s’est imposée à lui à partir de la formation reçue de Michel Gourinat en classe de khâgne, puis de Claude Tresmontant, à la Sorbonne, à l’époque où l’A. était élève à l’ENS-Ulm, mais trouvait plutôt ailleurs les sources qui lui permirent d’approfondir sa réflexion personnelle. Une citation, en outre, du père M.-J. Le Guillou (p.18) indique discrètement l’importance qu’il eut à cet égard.
Le croisement de ces enseignements, ainsi qu’une lecture approfondie d’Aristote - duquel l’A. a publié aux éditions Ellipses un magistral commentaire du livre IV de la Métaphysique - l’ont conduit à comprendre que c’est seulement comme métaphysique que la philosophie trouve à s’unifier et à se distinguer en tant que science des autres disciplines du savoir, et que « dans la démonstration de la doctrine de la création se trouvait contenue la solution du problème de la nature et de l’unité de la philosophie » (p.11). Ce qui conduit l’A. à rompre d’emblée quelques lances d’une part avec les préjugés scientistes à l’égard de la connaissance métaphysique, d’autre part avec le dogme heideggérien selon lequel le propre des questions authentiquement philosophiques serait de devoir rester sans réponse. D’où le rejet de « l’objection préjudicielle selon laquelle il faudrait s’interroger sur l’homme avant de s’interroger sur l’univers, puisque l’homme est la seule partie de l’univers à s’interroger » (p.19), et l’affirmation de la priorité de la question « de l’existence de Dieu en tant que cause de l’univers » sur « la question de Dieu comme fin ultime de l’homme », et sur celle de savoir « si la cause première est cause libre de l’existence de l’univers » (p.24).
Il s’agit donc pour l’A. de reprendre à son compte le projet qui fut en son temps celui de Thomas d’Aquin, moyennant « une confrontation entre les aspects philosophiques les plus indiscutables de la physique d’Aristote et les aspects expérimentaux les moins contestables de la science contemporaine » (p.11), de manière à éviter l’apparence d’enraciner les conclusions métaphysiques dans une physique périmée. Mais en outre, le premier chapitre laisse attendre d’emblée une confrontation avec des philosophies postérieures à s. Thomas, et qu’il convient d’examiner de la même manière qu’il l’a fait avec les doctrines connues de son temps.
Le chapitre II - Pourquoi ? - est une réactualisation de la preuve de Dieu par la causalité. Aussi expose-t-il une remarquable réhabilitation de cette dernière notion, à partir de son élaboration dans la philosophie antique, jusqu’à la doctrine aristotélicienne des quatre causes, et de l’examen des objections dont elle fut victime dans la pensée moderne, à partir de la critique nominaliste du XIVème siècle. Car l’inférence de la cause première à partir de la connaissance des causalités intramondaines ne fait pas vraiment difficulté, pourvu seulement que la causalité soit considérée comme un aspect du réel, et non pas comme une illusion ou un a priori subjectif.
Ce chapitre, fort dense, a fait nettement ressortir à quel point certaines conceptions tenues pour caractéristiques de notre modernité font plutôt retour à une « vision archaïque de la causalité » (p.29), pour l’essentiel, matérialiste, mécaniste, et casualiste. Ces « thèses préplatoniciennes qu’on appelle modernes depuis le XIVème siècle » (p.132) ne doivent leur succès qu’à l’ignorance de la réfutation vigoureuse et rigoureuse que Platon et Aristote en ont conduite, et au fait que « ce qui a fait crouler la physique aristotélicienne, c’est sa lecture par des nominalistes » (p.45), dont les positions, tant en logique qu’en physique et en métaphysique, sont exposées à partir de textes de Nicolas d’Autrecourt.
L’autre intérêt du chapitre est de montrer la surdétermination du débat philosophique sur la causalité par le débat théologique, ignoré des Anciens, sur la toute-puissance divine et l’efficacité des causes secondes. Sans cette donnée, on ne comprend pas grand-chose à la critique humienne de la causalité, tout inspirée de Malebranche, et à la réaction kantienne qu’elle a entraînée.
L’A. combat ainsi sur tous les fronts que l’histoire a effectivement mêlés, et analyse subtilement le croisement entre la physique et la noétique, ce qui l’amène à conclure dans sa note finale : « il a fallu renverser le concept de causalité pour contester les preuves de l’existence de Dieu, et rejeter la théorie de l’abstraction pour renverser le concept de causalité. Le fait que cet effort de destruction de la philosophie, né à l’intérieur de la théologie chrétienne, ait abouti à la ‘‘mort de Dieu’’, justifie à lui seul le propos de la synthèse thomiste » p.60).
Le chapitre III - Le moteur immobile -, que l’auteur annonce plus difficile que le précédent (p.62), applique à la question du mouvement la même méthode d’examen qu’à celle de la causalité. Le prestige que la physique moderne doit aux succès techniques ne saurait occulter, comme c’est trop souvent le cas, la nécessité d’une compréhension philosophique de la réalité et de la nature de son objet. Or celle-ci trouve ses sources et ses moyens dans le débat ouvert par les arguments de Zénon, et non pas dans le faux sérieux de quelques emprunts d’allure mathématique. L’A. s’en est expliqué dès le premier chapitre : « La lecture d’ouvrages rendant compte des résultats récents en sciences de la nature, si passionnante qu’elle fût et si enrichissante pour ma culture personnelle, n’apportait à l’objet précis de ma réflexion que des questions sans réponses. Questions auxquelles la philosophie avait répondu depuis des siècles, appuyant ses conclusions de preuves irréfutables. C’était donc plutôt le savant qui aurait eu à s’instruire auprès du philosophie, que l’inverse. Non certes que le savant n’eût rien à apprendre au philosophe, au contraire, mais ce qu’il pouvait lui apprendre ne changeait pas fondamentalement les conclusions que la philosophie avait dès longtemps et fermement établies » (p.22).
Comme on le reconnaît de plus en plus aujourd’hui, du fait même des avancées théoriques de la science, le mécanicisme qui a un temps prévalu dans la physique moderne a été une réduction consciente, mais appauvrissante et à vrai dire réactionnaire, du mouvement au déplacement, moyennant l’occultation des questions fondamentales que suscite le fait du changement quant à sa réalité et à sa nature. La réouverture de celles-ci permet au contraire à l’A. d’établir, à travers une critique dialectique des monismes mobilistes (Héraclite, Hegel) et immobilistes (Parménide), le sens et la validité des thèses majeures de la physique aristotélicienne, soit les notions de mobile, de substance, de puissance et d’acte, d’action et de passion, jusqu’à retrouver la nécessité de l’acte pur immobile au principe de tout mouvement.
Ici encore la désinvolture philosophique montre quelle indépendance d’esprit elle assure à l’encontre de toute idolâtrie scientiste : « On ne peut (...) nullement accepter l’idée que le corps en mouvement soit son propre moteur. Sans doute, le principe d’inertie est-il une grande découverte de la physique - mais prétendre expliquer par là le mouvement global de l’univers, c’est oublier que ce principe n’explique que le mouvement rectiligne uniforme, lequel n’existe pas dans la nature » (p.83).
Sous le titre L’abolition du savoir, le chapitre IV expose la confrontation avec la critique kantienne des preuves de l’existence de Dieu, confrontation aussi attendue qu’elle est négligée aujourd’hui dans la tradition universitaire française. Ici encore, le philosophe fait retour à l’essence originelle de la philosophie, à savoir la contestation de certains dogmes qui ne se maintiennent que moyennant l’inclination devant une autorité tout humaine, fût-elle celle de quelqu'un qui est réputé grand philosophe.
On ne peut que renvoyer à ce remarquable examen en règle des soi-disant réfutations kantiennes, qui s’accorde momentanément l’humour de pasticher leur auteur en présentant, tel Kant exposant les prétendues antinomies de la raison pure, l’analyse sur la page de gauche et la réfutation sur la page de droite (pp.110-125). Il résulte de cet examen que les incongruités logiques apparaissent inhérentes à l’argumentation kantienne, et non pas aux preuves qu’elle est censée avoir définitivement réfutées.
La fin du chapitre a l’intérêt d’une part de replacer la critique des preuves de l’existence de Dieu dans le cadre du débat entre « idéalisme et réalisme » (p.127), d’autre part de faire transition vers une « lecture anthropologique de Kant » (p.129), qui fait l’objet du chapitre suivant. L’A. peut ainsi conclure avec profondeur en distinguant « deux lectures possibles de Kant » : l’une, « philosophique, (...) voit dans le kantisme un effort pour découvrir l’aspect subjectif et anthropologique des problèmes métaphysiques. Chercher dans l’homme le désir de Dieu ou les moyens de le satisfaire, même s’ils apparaissent comme insuffisants par rapport à ce désir. En ce sens, Kant appartient à la grande tradition augustinienne, bien qu’il n’en soit, hélas, pas le plus authentique représentant. L’autre lecture est inévitablement sophistique. En faisant de l’homme le critère ultime du vrai et du bien, on fait une révolution dans le sens d’un retour au point de départ » (p.132).
« S’interroger sur l’existence de Dieu du point de vue anthropologique, c’est se demander s’il existe un Souverain Bien, non plus pour expliquer le cours des astres, mais pour combler les aspirations de l’homme » (p.134). Le chapitre V - Que puis-je espérer ? -, sans doute le plus passionnant, et à vrai dire impossible à résumer, expose la confrontation, non moins attendue que la précédente, avec Heidegger : il témoigne d’une lecture directe et d’une compréhension en profondeur des thèses du philosophe de la Forêt Noire, compréhension que facilite rarement la surenchère interprétative, souvent aussi obscure que bavarde, dont elles font couramment l'objet.
Les 11 premiers §§ articulent lumineusement les éléments d’une doctrine qui vise à présenter « l’homme comme citoyen du monde » (p.134), c’est-à-dire abandonné à une finitude qui le condamne à donner du sens à l’étant, lequel n’en comporte aucun qui préexiste aux intentions de l’homme. L’A. montre finement comment la caractérisation de l’homme comme être du souci et « être-pour-la-mort » s’enracine dans une conception de la vérité qui tout à la fois pose le problème de l’accès aux choses qu’ignore l’idéalisme moderne, et y répond en identifiant l’être au sens que l’homme confère à l’étant, à travers l’ensemble de ses comportements à son égard. Selon Heidegger, qui cite Kant : « Le plus important objet dans le monde, auquel l’homme puisse appliquer tous les progrès de la civilisation, est l’homme, parce qu'il est sa propre fin dernière » (p.145).
L’A. avoue la difficulté qu’il y a à réfuter un tel athéisme qui ne se présente jamais comme tel : « Rejeter la pensée de Heidegger n’est pas (...) facile, car il ne s’agit pas de réfuter par des arguments logiques une affirmation philosophique fausse (l’homme est l’origine du sens), mais de repousser un style de pensée qui se refuse à procéder logiquement, sous prétexte que la vérité n’est pas circonscriptible par nos affirmations » (p.166). La conception de l’homme comme Dasein, soit la distinction heideggérienne de l’étant et de l’être – ou du point de vue ontique et du point de vue ontologique – implique en effet un rejet des règles logiques, lesquelles présupposent une antériorité de l’intelligibilité des choses par rapport à la pensée et au discours humains, intelligibilité qui ne s’explique elle-même, comme s. Thomas le soulignait avec force, que si elle a sa source dans l’intellect de Dieu, et non pas dans celui de l’homme.
Précisément, l’inévitable illogisme des thèses de Heidegger les condamne, ce qui conduit l’A. à trouver dans l’anthropologie heideggérienne une « preuve par l’absurde de l’existence de Dieu » (p.168), et à souligner qu’en sens contraire, « en identifiant l’intelligence organisatrice de l’univers au souverain bien que l’homme poursuit, Platon et Aristote ont donné la plus forte justification rationnelle qui soit de la confiance que l’homme peut mettre en Dieu, car il est plus facile à la Terre de s’arrêter et de repartir en sens inverse qu’au souverain bien de jamais devenir méchant » (p.177). On ne saurait mieux faire valoir l’incidence existentielle de la connaissance métaphysique.
C’est sur ce terrain existentiel que poursuit le chapitre VI en posant la question : Dieu est-il humain ?, titre qui fait écho à celui d’un livre bien connu du Père Bernard Bro, o.p., et reprend un sujet de philosophie donné au concours d’entrée de l’ENS-Ulm. Il s’agit ici de la « philanthropie » divine professée par la foi chrétienne, mais en vue de demander si elle peut être l’objet d’une connaissance philosophique. Un trait caractéristique de l’athéisme moderne est en effet d’avoir annulé cette notion, en réinterprétant le dogme de l’Incarnation d’une manière qui le dénaturait totalement, soit en professant une unité des natures divine et humaine qui signifie que la première n’est rien d’autre que la perfection de la seconde.
L’A. fait d’abord apparaître que l’humanisme athée issu de la métaphysique hégélienne est empreint de l’anthropomorphisme qu’il reproche à la religion, ensuite que la notion biblique du Dieu créateur, avec laquelle converge, sur le point considéré, le monothéisme philosophique de Platon et d’Aristote, est précisément à l’opposé de tout anthropomorphisme, et même la première critique fondamentale de celui-ci.
À partir de là, l’A. montre profondément et subtilement comment cette « impossibilité de réduire Dieu à l’humain » (p.189) fonde la possibilité de comprendre « le jugement de Dieu comme expression de sa ‘‘philanthropie’’ » (p.193), jusques et y compris dans la permission du mal.
Il revient au dernier chapitre - Peut-on penser la création ?- de montrer que Dieu est non seulement la cause première de l’univers, mais qu’il est la cause libre de son existence, et que c’est cette dernière affirmation qui permet pleinement de le considérer comme le Souverain bien qui donne son sens à toute chose, et à la vie humaine en particulier : « dire que la doctrine juive est un instrument d’exploitation, qu’elle exprime la névrose, la lâcheté ou le ressentiment qui caractérisent ses adeptes, c’est une intéressante contribution à l’arsenal de la propagande antisémite, mais non une preuve que cette doctrine soit fausse » (p.199).
Pour montrer que « la doctrine de la création » est « philosophiquement pensable » (p.202), contrairement à ce qu’affirment le néoplatonisme et toutes les formes modernes du panthéisme issu de l’idéalisme allemand, l’A. entreprend l’examen critique des positions de Spinoza. La réfutation conduit à un jugement profond qui montre le lien essentiel entre panthéisme, univocisme, et idéalisme : « Tout panthéisme admet en fait comme présupposé l’unité absolue de l’être. Le multiple est alors soit, pour les philosophes, une simple apparence, soit, dans la version gnostique et mythique du panthéisme, le résultat d’une scission provisoire à l’intérieur du divin. Hegel a réussi ce tour de force, de passer pour rationaliste en instaurant dans la raison cette scission que ses prédécesseurs gnostiques ont toujours présentée sous un mode mythique. On peut toutefois examiner le problème sous l’angle gnoséologique. Tout panthéisme est idéaliste, à la fois parce qu’il fait de l’expérience une réalité illusoire et parce qu'il implique une méthode de connaissance purement conceptuelle » (p.209).
Il convient alors de montrer que la doctrine de l’analogie de l’être est la solution logique qui rend la création pensable, en même temps que celle-ci donne à ladite analogie son fondement réel : « Car l’analogie n’est pas une proportion entre des sens divers et équivalents de la notion d’être, mais une subordination de différents sens à un sens premier. Or, ultimement, les différents sens de l’être se subordonnent à l’être de Dieu et la doctrine de la création constitue alors le contenu intelligible du concept d’être en y introduisant, non point une indétermination absolue, mais au contraire une structure hiérarchique, elle-même fondée sur la liberté créatrice » (p.219).
C’est à prouver cette dernière que s’emploie la fin du chapitre : l’affirmation que l’existence créée est un don gratuit fait par amour est en fait la solution rationnelle des contradictions du panthéisme.
Qu’on permette à cette recension de s’épargner la coquetterie, coutumière dans ce genre d’exercice, qui consiste à supposer que des réserves critiques sont indispensables pour valider une approbation générale. Ce livre est un véritable livre de philosophie, à une époque où celle-ci renonce souvent à elle-même au profit de l’érudition historiciste. Un livre exigeant de par l’attention qu’il requiert et la portée de ses conclusions, vivifiant aussi puisqu’il atteste que la raison peut être un authentique soutien de l’espérance. On regrette seulement, comme Platon dans sa 7ème Lettre, de ne pas avoir l’auteur devant soi pour lui demander de suppléer à la concision souvent très grande de son propos, et d’expliciter totalement ses démarches de lecture et sa compréhension si lucide, si profonde, et surtout si libre, des doctrines qu’il affronte et confronte – comme peuvent le faire les étudiants qui sont les heureux bénéficiaires de son enseignement.
Michel Nodé-Langlois
Toulouse – 2006
Publié dans la Revue Thomiste.
Jean CACHIA, Vivre selon la raison – Saint-Léger éditions, septembre 2015, 326 p.
C’est ici l’œuvre non pas de toute une vie, encore et toujours féconde, mais de toute une carrière, qui n’a pris fin que récemment.
Cette Introduction à la philosophie morale (sous-titre du livre) est en effet le fruit et la synthèse de près de quarante ans d’enseignement de la philosophie, auprès d’innombrables élèves de terminale ou de classes préparatoires aux grandes écoles. L’auteur peut se prévaloir d’une solide et profonde formation philosophique, auprès de maîtres qu’il cite (Michel Gourinat, Claude Tresmontant), laquelle l’a fait accéder à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, puis au concours d’agrégation. L’acquisition de plus d’une langue étrangère, hébreu compris, lui permet de lire dans le texte la plupart des philosophes qu’il cite, de Platon à Heidegger, en passant par Augustin, Thomas et Kant. Ces références sont donc toujours de première main.
Tous ces acquis auraient pu avoir pour résultat le seul étalage d’une érudition écrasante. L’intérêt et l’originalité du livre résident plutôt dans le fait qu’il déploie le contenu d’un véritable enseignement, peaufiné à l’usage d’élèves débutants ou déjà initiés, lesquels ne manquent jamais d’imposer des exigences d’intelligibilité dont profitent l’enseignant autant que l’enseigné. La clarté pédagogique n’est pas le moindre mérite de l’ouvrage, lequel s’est en outre forgé à l’école d’une pratique dialectique de la philosophie. Cet héritage de la sagesse antique et médiévale est sans doute ce qu’il reste de meilleur dans notre enseignement philosophique scolaire et universitaire. Il comporte le grand avantage d’éviter toute forme de didactisme historiciste autant que de dogmatisme : il s’agit à tout moment de chercher réponse à des problèmes, et non pas de s’enquérir de l’opinion des philosophes auxquels on se réfère, moyennant néanmoins une compréhension en profondeur de leur pensée, et, à tout le moins, une attention très rigoureuse à l’exact contenu de leurs textes.
Le projet de l’auteur était manifestement de faire porter à un enseignement scolaire de la philosophie tout le fruit dont il est capable, à l’extérieur autant qu’à l’intérieur de la classe. Il renoue ainsi avec l’antique conception de la sagesse, soit de la philosophie en tant que genre de vie, manière d’exister, au-dedans comme au-dehors, pour le plus grand profit – disons d’entrée de jeu : pour le bonheur – de la personne et, par rebond, de tous ceux avec qui elle entre en relation, volontairement ou non.
Tel est l’objet du premier chapitre, qui mobilise et articule les deux aspects de la raison mentionnée par le titre : l’appel à celle-ci n’a ici de sens que parce que la raison est capable du vrai, et d’une vérité qui ne se limite pas aux acquisitions réputées scientifiques auxquelles le scientisme contemporain voudrait la confiner. Autant dire que l’ouvrage s’engage d’emblée – le premier terme de la première phrase est le nom de Kant – dans une controverse avec les doctrines qui, tant dans l’Antiquité qu’aux Temps modernes, tendent à creuser un abîme entre la vérité théoriquement accessible et les principes susceptibles de régler la conduite humaine d’une manière conforme à la raison. La conception de la sagesse morale ici exposée et défendue reconnaît à la raison une capacité, solidement étayée par ailleurs [voir, du même, Le Créateur de l’univers, Paris, F.X. de Guibert, 2006, 235 p.], de connaissance métaphysique, sans laquelle la philosophie ne se distinguerait des autres disciplines théoriques que comme une sorte de littérature s’arrogeant fallacieusement le caractère de science. Il y a tout lieu de chercher à vivre selon la vérité – soit selon une connaissance vraie du bien – dès lors qu’il y a une vérité accessible à la raison humaine par-delà ses acquisitions dans le domaine des mathématiques, ou des sciences de la nature.
C’est en effet seulement d’une telle vérité que l’on peut attendre une réponse à la question du sens de la vie, objet du deuxième chapitre. L’auteur s’y confronte à l’opposition entre l’être et la valeur, héritage kantien qui reste prégnant dans les formes contemporaines de l’existentialisme, et dans toutes les pensées selon lesquelles le domaine axiologique n’est pas celui d’une vérité connaissable. Ce dernier devient dès lors l’empire d’un volontarisme radical, et les efforts de Kant pour donner à celui-ci l’allure d’un rationalisme pratique n’ont pu empêcher, et ont plutôt favorisé, à un siècle de distance, la dérive nihiliste du volontarisme moderne. Preuve par l’absurde que la destitution de la métaphysique théorique par la philosophie critique a été, contrairement aux intentions de Kant, tout sauf l’unique moyen de sauver la morale contre ses mises en question matérialiste et athée. Seule la connaissance métaphysique permet de savoir que le souverain bien de l’homme, toujours visé sous le nom de bonheur, réside avant tout, comme Platon l’enseignait, dans le bien subsistant qu’est l’absolu divin. Faute d’une telle référence en pratique comme en théorie, la conduite de la vie morale, personnelle et collective, cherche désespérément à se suspendre dans le vide.
Un mérite insigne du livre est à cet égard de ne pas en rester à la discussion métaphysique, inévitablement fort abstraite, des principes d’ordre ontologique qui constituent un horizon de pensée permettant d’espérer une réponse aux questions morales fondamentales et décisives, ou, comme nous disons, « existentielles ». Bien plutôt s’enfonce-t-il dès le chapitre III dans ce qui, conformément à la leçon d’Aristote, est beaucoup plus important d’un point de vue moral que la connaissance formelle des préceptes, ou celle des fondements métaphysiques qui leur donnent sens. Ce chapitre porte en effet sur la « formation de la personnalité » (p.79), soit sur ce qui est susceptible d’ordonner en pratique l’existence de chacun à la vérité reconnue qui lui apporte son sens ultime. Qu’on ne se méprenne pas : il ne s’agit pas ici de « psychologie » au sens moderne du terme dans le classement des disciplines. Il s’agit de cette connaissance philosophique de l’âme humaine qui s’est déployée, depuis l’Éthique à Nicomaque, dans une doctrine des vertus reposant sur l’affirmation, expérience à l’appui, que la personne humaine est « principe de ses actions », et à cet égard « cause de soi », moyennant cette capacité que la tradition philosophique, depuis le Stoïcisme, a dénommée libre arbitre. La confrontation avec Kant et ses héritiers fait donc place ici à une discussion du spinozisme, dont on sait qu’il a professé une dénégation du libre arbitre à l’homme comme à Dieu, position à laquelle beaucoup aujourd’hui s’accrochent qui ne manquent pas par ailleurs de revendiquer haut et fort des libertés de choix publiquement reconnues : si je veux, quand je veux… On vérifie ici encore que la connaissance métaphysique de la liberté humaine – et non seulement sa postulation à la manière kantienne – est ce qui donne à l’humanisme moral une cohérence qu’il perd lorsqu’il prétend s’adosser à une ontologie ou une « science » qui l’ignorent.
La doctrine des vertus, d’inspiration profondément aristotélicienne, a en outre l’intérêt de montrer, à l’encontre de dichotomies caractéristiques de notre modernité, comment chacun peut acquérir la conscience d’être l’artisan de son propre bonheur. La vertu n’est pas ce qui rend la vie difficile et déplaisante, mais au contraire, une fois surmontée la difficulté qu’il y a effectivement à l’acquérir, ce qui rend la vie plus facile et plus plaisante.
La teneur propre du chapitre III explique pourquoi c’est seulement ensuite qu’est prise en considération la notion à laquelle souvent la problématique de la philosophie morale se trouve fâcheusement réduite. Quel sens y aurait-il en effet à réfléchir sur la « conscience morale » si le seul fondement qui donne un sens à cette notion – la liberté – était réputé inexistant (Spinoza) ou inconnaissable (Kant) ? Le chapitre IV n’en traite pas moins d’une question qui reste fort prégnante dans la réflexion contemporaine, au point d’avoir suscité il n’y a pas si longtemps une encyclique papale. Il s’agit en effet du rôle de la conscience – du jugement sur ce qui est à faire, soit sur une action à considérer comme bonne – dans la détermination du caractère moral d’une conduite. Ce qui est mis ici en discussion, c’est « l’infaillibilité de la conscience » (p.124), telle que la revendiquent les formes contemporaines du subjectivisme permissif, lequel comporte le paradoxe d’en appeler à la conscience pour valider en dernière instance la conduite, tout en la rendant incapable de fonder la moindre obligation : celle-ci ne peut différer d’une exigence arbitraire qu’à la condition d’être fondée sur la connaissance d’un bien objectif, laquelle peut assurément donner lieu à erreur. L’auteur est ainsi amené à discuter la conception rousseauiste de l’infaillibilité de la conscience – « instinct divin » – et à rouvrir le débat sur le caractère obligatoire de la « conscience erronée » (p.143). Appel est fait ici, pour traiter de ce point, aux références majeures que sont Aristote, Thomas d’Aquin, Pascal et Hegel.
On pourrait s’étonner de n’aborder qu’au chapitre V la notion qui paraît pourtant présupposée dès le départ, comme l’alpha et l’oméga de la réflexion morale. On pourrait voir hâtivement une faiblesse de l’ouvrage dans le fait que l’ordre de ses chapitres ou la logique de cet ordre ne paraissent pas immédiatement intelligibles. On peut aussi juger que, s’il y a là un sujet d’étonnement, ce n’est pas forcément au détriment de la quête philosophique de la vérité, puisqu’il est reconnu et souligné depuis Platon que celui-là est le père de celle-ci. L’étonnement est le point de départ de la dialectique parce qu’il n’est rien d’autre que le sens du problème. Ici, c’est la nature dialectique du propos qui permet de saisir le sens de son ordre, fût-ce après-coup.
C’est en effet le contenu du chapitre consacré à l’essence de la personne qui permet de comprendre sa place dans l’ensemble. Nul ne contestera que cette notion soit la pierre d’angle de toute réflexion en matière de morale et de droit, en politique comme en éthique, la première étant ici valablement conçue comme déploiement et mise en œuvre de la seconde. Les droits humains que la modernité se flatte d’avoir déclarés n’ont de sens qu’à être fondés sur la dignité inaliénable que les personnes humaines tiennent de leur commune appartenance à l’espèce humaine, soit à une communauté de nature qui est une vérité de fait et n’est à la discrétion de personne. Pour autant, le chapitre V entreprend la défense d’une conception réaliste et objectiviste – il faut même dire : substantialiste – de la personne, à l’encontre des tentatives modernes pour définir celle-ci en référence à la seule conscience, envisagée soit au sens général de la subjectivité pensante (Descartes), soit au sens de la conscience morale (Kant). On voit que cette mise en discussion de certaines formes contemporaines de l’humanisme personnaliste supposait les acquis des chapitres précédents quant à la réalité du libre arbitre et à la conscience morale. Mais on saluera aussi la désinvolture - au meilleur sens (italien) du terme - dont l’auteur fait preuve, d’une manière on ne peut mieux argumentée, à l’égard des diverses formes du subjectivisme et de l’idéalisme modernes, et d’auteurs trop souvent invoqués comme des statues du Commandeur dont on ne saurait contester l’autorité.
La conquête dialectique d’une définition cohérente de la personne et de sa dignité morale conduit, tout naturellement cette fois, à l’étude des relations interpersonnelles, qui sont l’objet même de la moralité, mis à part ce qui concerne le développement de la personnalité. La transition est donnée par deux paragraphes fort représentatifs de la volonté comme de l’art de l’auteur de ne pas en rester aux abstractions ontologiques ou axiologiques : « ‘‘La personne est un bien à l’égard duquel seul l’amour constitue l’attitude appropriée et valable’’. Karol Wojtyła réinterprète ainsi l’impératif catégorique de Kant sous la forme du commandement de l’amour. En tant que la personne est capable de choisir le bien, on doit reconnaître cette richesse en voulant son bien, c’est-à-dire en l’aimant. Mais l’amour porte sur la personne et non sur l’espèce. De même que la personne, sujet de droits et de devoirs, est un être individuel concret, une substance, et non un universel, de même la personne à qui le respect, l’amour est dû, n’est pas l’humanité mais l’individu humain. [§] Ce commandement définit en général l’amour du prochain comme le résumé de la moralité, mais il explique aussi dans une acception plus particulière du mot ‘‘amour’’ tout le sens de la chasteté : d’un point de vue psychologique, celle-ci se présente en effet comme la fixation du désir sexuel sur un individu. La chasteté consiste donc dans la règle qui veut que le désir sexuel porte sur la personne aimée et non sur l’animal de l’autre sexe spécifiquement pris. Ce point de vue sera développé dans le prochain chapitre » (p.170-171).
On comprend alors que le chapitre consacré aux relations interpersonnelles porte moins sur l’obligation et le devoir que sur l’« amour » et l’« amitié » (p.173). On retrouve ici ce qui fut la fraîcheur de l’Éthique à Nicomaque, et de ce qui en est resté, Thoma mediante, chez les grands spirituels tels que François de Sales, assez loin des aridités du formalisme et du rigorisme kantiens. La dialectique philosophique apparaît comme le moyen savoureux d’attester que le mariage est la véritable forme de « l’amour libre » (p.184), et comment Thomas d’Aquin a trouvé chez Aristote les ingrédients permettant de penser la charité comme « amitié avec Dieu » (p.207).
Non moins intéressant paraîtra le chapitre suivant, consacré à la politique et à ses relations avec la morale : examen dialectique de ce qu’il reste convenu d’appeler le « réalisme » d’inspiration machiavélienne, examen qui conduit à reconnaître dans les diverses formes du totalitarisme l’aboutissement sinistre d’une prétention à affranchir la politique de la morale. Le marxisme-léninisme est longuement discuté (p.227-235), tout autant que la conception classique du pouvoir absolu (p.217-223). Appuyé sur le personnalisme de Jacques Maritain dans Humanisme intégral, l’auteur analyse la prégnance de la gnose dans la pensée et l’action politiques modernes (p.237-249).
Un intérêt particulier de ce chapitre tient à l’audace de l’auteur à faire descendre la philosophie morale dans l’arène de la géopolitique, en toute conscience des risques de l’entreprise, eu égard à l’incertitude qu’un aristotélicien ne manque jamais d’avouer dès lors qu’il s’agit de juger dans l’ordre des singularités historiques, et non plus dans celui des universels conceptuels. Ces pages (249-253) présentent pourtant une belle acuité, nourrie d’une connaissance puisée à bonnes sources de l’histoire contemporaine.
Quant au dernier chapitre (VIII), il est lui aussi de nature à convaincre qu’une dialectique philosophique ancrée dans les auteurs les plus classiques est encore à même d’apporter des éléments d’analyse et de réponse aux questions qui sont les nôtres. On ne saurait en fait reprocher à l’auteur de ne guère citer, tout comme son maître Gourinat, les auteurs contemporains, car il en cite au besoin d’encore vivants, même s’il ne fait pas grand place à des auteurs à la mode, l’intempestivité étant après tout, comme Nietzsche le reconnaissait si longtemps après Platon, un caractère inamissible du philosophe digne de ce nom.
Le livre n’a pas non plus pour but d’entrer dans le détail technique des débats qui ont agité la théologie morale des derniers siècles, sur le tutiorisme et le probabiliorisme par exemple, mais de donner à qui le lira les moyens philosophiques d’acquérir, intellectuellement autant que pratiquement, sa propre sagesse, et d’avoir une vie sensée même si le monde refuse de l’être.
Son dernier chapitre porte sur la religion, donc plus précisément sur la place de la religion dans la morale et dans la politique, à partir de la question de savoir si « toute religion implique (…) une révélation » (p.257). Cicéron, comme Aristote, classait la religion parmi les vertus morales, conception que beaucoup aujourd’hui considèrent comme surannée. Pourtant, la recherche d’une juste conception de ce que nous appelons laïcité de l’État ne peut être conduite sérieusement en faisant bon marché de la distinction classique entre religion naturelle et religion révélée – le fond du problème étant là encore la question de la connaissance métaphysique rationnelle de la divinité. Qu’il puisse exister quelque chose comme une « obligation de croire » (p.298) en fera bondir plus d’un, mais on n’en trouvera pas moins d’intérêt à découvrir que toute religion ne suppose pas une révélation, et qu’au contraire « la révélation suppose la religion » (p.294).
Comme d’habitude, je m’abstiens d’égrener un petit catalogue de réserves plus propres à attester la pénétration du recenseur que l’intérêt de ce qu’il recense, faute duquel il n’y aurait pas travaillé. Je n’ai pas non plus prétendu résumer l’ouvrage pour dispenser de le lire, mais voulu bien plutôt inviter à cette lecture, comme un Guide vert dit qu’un lieu « vaut le voyage » ou, à tout le moins, « le détour ». La dernière proposition citée le suggère : ce livre a entre autres l’intérêt de bousculer, comme il sied à la philosophie, pas mal d’idées reçues. L’intérêt aussi de produire une philosophie qui, si scolaires soient les moyens qu’elle se donne, n’est pas une philosophie d’école, mais une réelle quête de sagesse, dont plus d’un étudiant a reconnu avoir tiré bénéfice, bien au-delà de la seule réussite universitaire.
Michel Nodé-Langlois
Publié dans le Bulletin de Littérature Ecclésiastique de l'Institut Catholique de Toulouse.
Jean CACHIA, Le Gai savoir, Quarante esquisses pour découvrir les philosophes et la philosophie, Chouzé-zur-Loire, Saint-Léger éditions, 2017, 197 p.
Que l’on ne s’y trompe pas : le titre de l’ouvrage ne nous promet pas un effort désespéré de type nietzschéen pour échapper au nihilisme, mais bien une réjouissante promenade au pays de la sagesse la plus authentiquement capable d’en prémunir. Promenade guidée par un Provençal qui ne pouvait manquer de laisser paraître sa nostalgie du Gai-Sabé des troubadours, en écrivant des poèmes d’amour de la vérité, sous la forme classique aussi exigeante qu’efficace du sonnet : exigeante de par la concision qu’elle impose, efficace de par le pouvoir mnémotechnique de la versification régulière.
Aussi bien l’A. souligne-t-il lui-même le but et le caractère pédagogiques de son ouvrage, lesquels n’ôtent rien à ce qu’il offre de réjouissant pour l’œil, l’oreille, et l’esprit. Ce petit livre a quelque chose d’unique dans l’édition philosophique contemporaine : fruit de toute une carrière face à des élèves ou des étudiants, il entreprend de leur donner un avant-goût de la sagesse qu’ils peuvent espérer recevoir d’une découverte de la philosophie en classe terminale. Le terme de sagesse retrouve ainsi le sens originel de la sapientia, puisque le verbe sapere signifie « savourer » : le vrai savoir ne va pas sans saveur.
C’est donc le programme de ladite classe qui a sous-tendu l’écriture de ces quarante poèmes : ils esquissent avec finesse, humour et bonheur la présentation de 12 auteurs (Platon, Aristote, Augustin, Thomas, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Rousseau, Kant, Hegel, Heidegger) et de 27 notions, de l’amour à la violence, en passant par le concept, l’inconscient, la mort, la substance, et la Justice de Dieu.
C’était assurément une gageure que de donner une idée juste des uns et des autres en si peu de lignes, même en assortissant chaque poème d’une présentation stimulante et parfois fulgurante. Aussi bien, de l’aveu même de l’A., son but a-t-il été, plutôt que d’offrir à ses lecteurs un enseignement avec toutes les justifications argumentées que celui-ci requiert, de les inviter à poser les problèmes majeurs qui ont suscité la quête philosophique – qui la suscitent encore, mais à partir de l’histoire à laquelle elle a donné naissance – et d’entreprendre d’y chercher réponse.
Michel NODÉ-LANGLOIS
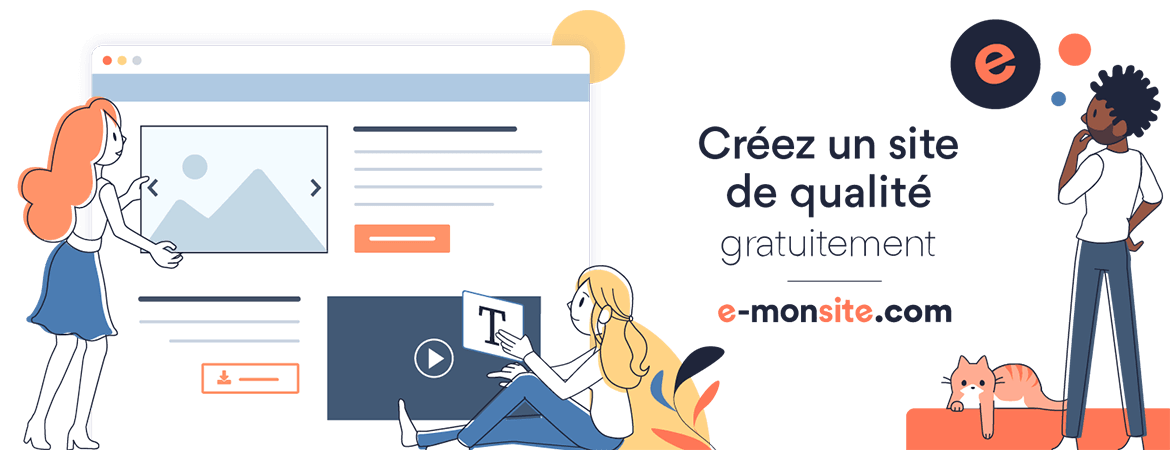




Ajouter un commentaire